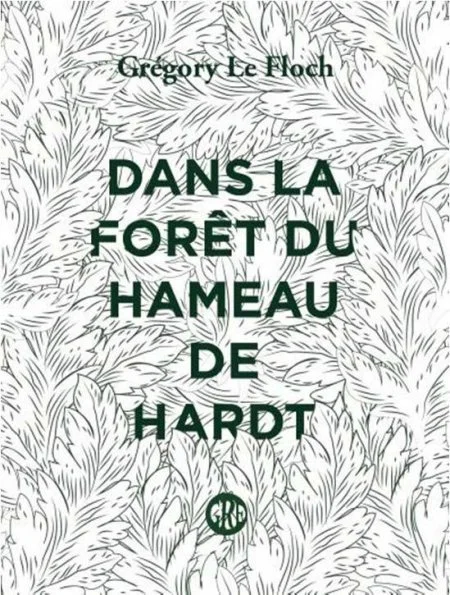Le phrasé somptueux du cauchemar forestier de Grégory Le Floch
Fuite circulaire et affrontement de la vérité d’un traumatisme : une magie incantatoire entre Forêt-Noire et Calabre. Un somptueux tour de force narratif qui explore comme rarement on l’a fait les méandres des frontières de la folie et de la raison, du souvenir et de la menace, de la culpabilité et de la confusion.
La crise me jeta hors de chez moi, dit-il, alors que, depuis le matin, je marchais à grandes enjambées à travers les pièces du rez-de-chaussée, ne sachant quoi faire pour apaiser cette crise qui me venait, pourtant identique à toutes ces autres crises qui m’étaient déjà venues et qui s’étaient toujours annoncées par ce même état d’affolement et d’étouffement, me rendant incapable de rester tranquille, si bien que je marchais à grandes enjambées à travers les pièces du rez-de-chaussée de la maison que j’occupais alors, aux abords de cette forêt – la plus grande forêt du pays – dont je voyais, depuis chacune des fenêtres de la maison, l’orée si noire que je la soupçonnais, certains jours, non pas de provoquer la crise – car de cette crise, toujours identique depuis des années, je connaissais parfaitement l’origine, même si j’étais alors incapable de l’exprimer clairement à ceux qui m’entouraient – mais de la fortifier, de la vivifier au point de me jeter hors de chez moi tandis que, depuis la veille, je sentais monter cette crise qui allait me faire marcher à grandes enjambées, dès le lendemain, à travers les pièces du rez-de-chaussée de la maison, du salon jusqu’à la cuisine, scrutant avec inquiétude la forêt si noire sous ce ciel si bas, car ici le ciel est toujours bas, gris et sombre, avec en tête l’idée que mon corps, ou mon esprit, était, somme toute et malgré cette apparente et flagrante perturbation, réglé comme une horloge, comme on dit, car je parvenais à identifier plusieurs heures avant son apparition réelle les symptômes de la crise – difficulté respiratoire, agitation des mains, sueurs, agacement, voire exaspération, à propos de choses qui n’en valaient pas la peine -, symptômes qui s’abattaient sur moi, pour enclencher, dans un tic-tac qui finissait par m’étouffer, un compte à rebours au terme duquel je n’entrevoyais plus d’autre solution que celle de quitter ma maison, littéralement jeté hors de chez moi, pour tenter, encore une fois, de trouver de l’aide chez Richter, l’homme qui habitait l’une des maisons du hameau de Hardt, et chez qui je me précipitais chaque fois que la crise atteignait son point culminant.
Réfugié dans un hameau allemand de la Forêt-Noire pour échapper tant bien que mal à de mystérieux poursuivants et à de terribles obsessions, le narrateur est foncièrement intranquille. Ayant repris, sans parvenir à les concrétiser, ses travaux de jeunesse sur Thomas Mann, « l’écrivain suprême », pour échapper à ses fantômes, et gravissant à chaque crise d’angoisse plus marquée sa propre montagne magique pour chercher en haut du hameau le secours silencieux de l’homme « le plus bienveillant du monde », Richter, avec son épouse et ses deux fillettes, il nous fait partager son soliloque désespéré, multipliant les litanies et les rituels conjuratoires plus ou moins conscients, sans jamais parvenir à affronter les mots et les images dont le désenfouissement le délivrerait peut-être de son trouble de stress post-traumatique un peu particulier. Jusqu’au jour où…
La Forêt-Noire en été
Impatient d’arriver au sommet de cette route qui montait vers la maison de Richter, la maison du hameau de Hardt la plus en hauteur, j’enfouis plus profondément encore mes mains dans mes poches, sentant passer dans mes poumons un air de moins en moins lourd et de moins en moins poisseux, comme si là-haut, du fait de l’altitude et d’une pression atmosphérique différentes de celles de là où j’habitais, en contrebas du hameau de Hardt, l’air, devenu plus pur, se bonifiait sous l’effet de quelque conjoncture climatique, me faisant échapper, pour le temps de ma fuite chez Richter, à l’horrible climat auquel je ne m’étais, malgré les années, jamais habitué et que je subissais comme le plus terrible des châtiments de ce qui s’était passé et qui m’avait amené à chercher ici un refuge à l’atrocité des hommes, ou du moins de certains d’entre eux, qui m’avaient pourchassé sans relâche depuis ce qui s’était passé, là-bas, en Calabre, événement que je ne parvenais pas à oublier et qui me jetait hors de chez moi, littéralement, quand le souvenir de ce qui s’était passé se changeait en crise et qu’il n’y avait plus d’autre solution, malgré toutes les dispositions que j’avais prises en me sauvant de Paris et en quittant la France – et de fait ceux qui, peu nombreux après ce qui s’était passé en Calabre, acceptaient encore d’être vus en ma compagnie, devenue insupportable aux autres – pour m’installer dans ce hameau de Hardt, dont la géographie isolée et le peu d’infrastructure routière m’avaient semblé le cadre idéal pour un fugitif en quête de paix et d’anonymat.
Les 140 pages du premier roman de Grégory Le Floch, publié en janvier 2019 aux éditions de l’Ogre, offrent à la lectrice ou au lecteur une inquiétante et tonique litanie, une mélopée intérieure de l’enfermement inexpiable dans un passé qui ne veut pas passer – ne voulant même pas être nommé ou raconté. Il faut beaucoup de ruse et de rigueur dans l’écriture pour parvenir à faire partager ainsi, de l’intérieur, les volutes embrumées de ce qui ne sort pas, les charmes vénéneux d’une poétique fantastique de la procrastination désespérée, et d’organiser un trajet narratif qui rend les scènes cathartiques finales (qu’il est hors de question de dévoiler ici) beaucoup plus oniriques, malgré leur réalisme volontariste et brutal, que les rêves fiévreux et les conjurations éparses qui les ont pourtant longuement et soigneusement précédées. Et une question finale résonne dans les interstices béants que laisse apparaître l’auteur dans les derniers mètres : peut-on impunément vivre aussi longtemps avec un traumatisme sans qu’il vous façonne définitivement ? Y a-t-il une vie possible après avoir conçu un tel système de survie à la folie pure ? Grégory Le Floch se garde bien de répondre, et laisse sa phrase somptueuse envelopper nos consciences tandis que le narrateur s’éloigne doucement, ayant fini par déposer son fardeau empoisonné devant nous. Un somptueux tour de force narratif qui explore comme rarement on l’a fait les méandres des frontières de la folie et de la raison, du souvenir et de la menace, de la culpabilité et de la confusion.
Dehors, les cris continuaient et, alors que je compris qu’ils allaient me rendre définitivement fou, le courage de me suicider ayant disparu sous le vacarme, et que la croise avait fini par transformer mon corps en bombe de chair et de nerfs qui ne demandait qu’à exploser, je mis mes chaussures, les mains tremblantes, en regrettant de ne pas les mettre pour me rendre chez Maeva, et en n’osant pas les mettre pour retourner chez Richter-le-Bienveillant, lesquels, Maeva et Richter, auraient pu tous deux, à leur manière, me sauver à cet instant précis et calmer la crise qui s’aggravait et l’endiguer, car Maeva et Richter étaient les deux seules personnes au monde mues à mon égard par d’autres sentiments que la haine et la domination, mais, ce soir-là, les hurleurs, dehors, me firent perdre toute prudence et, croyant reconnaître des cris similaires à ceux que j’aurais pu crier moi-même, si j’avais pu crier, je finis de lacer mes chaussures et mis un manteau pour sortir et fermai la porte à clef et descendis les marches du perron pour non pas emprunter la route qui montait chez Richter et qui, comme une digue, protégeait le hameau de Hardt de cette horrible forêt, marquée partout ailleurs par la main de l’homme mais qui, ici et uniquement ici, dans cette portion de forêt qui jouxtait le hameau de Hardt, était abandonnée à son état le plus sauvage et le plus hostile à toute forme d’intelligence, et dans laquelle je pénétrai par un acte désespéré, le corps secoué de soubresauts et de frissons qu’on aurait pu attribuer à la fièvre, mais je n’avais pas de fièvre, j’avais même froid dans cette forêt glaciale et humide qui, même l’été, ne se réchauffait pas, et qui, l’hiver, donnait l’impression de se baigner dans un bain d’eau glacée.
Grégory Le Floch
Dans la forêt du hameau de Hardt de Grégory Le Floch, éditions de l’Ogre
Hugues Robert le 15/01/19
l’acheter ici