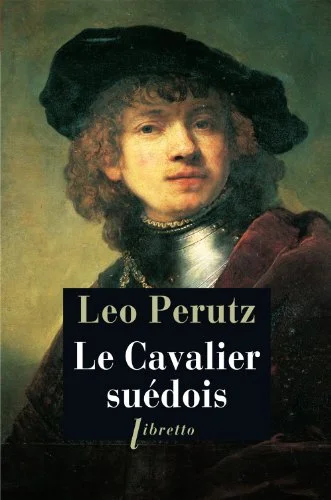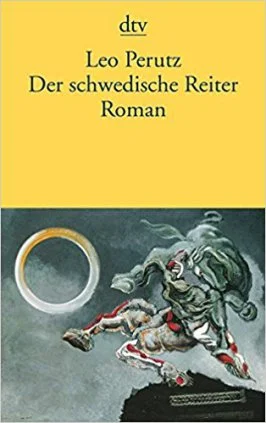Conte cruel et fantastique au XVIIIe siècle par Leo Perutz
Le dernier roman de Leo Perutz, et l’un de ses plus beaux contes cruels.
Maria Christine von Blohme avait vu le jour en Silésie, au domaine de ses parents. Toute la noblesse des environs était venue saluer sa naissance. De son père, le « Cavalier suédois », elle ne conservait qu’une image floue. « Il avait des yeux redoutables, dit-elle, mais lorsqu’il me regardait, le ciel s’ouvrait au-dessus de moi. »
Lorsqu’elle eut six ou sept ans, son père quitta le domaine pour se rendre en Russie, « sous les funestes bannières de Charles XII, le roi de Suède », dont la gloire emplissait le monde en ce temps-là. « Mon père était d’origine suédoise, écrit-elle, aussi les larmes et les supplications de ma mère ne purent-elles le retenir. »
Mais avant qu’il ne saute en selle, l’enfant cousit en secret un petit sac de sel et de terre dans la doublure de sa redingote : elle avait agi sur le conseil d’un des deux palefreniers de son père, qui lui avait assuré que c’était là un moyen infaillible pour lier à jamais deux êtres.
Plus loin, le livre mentionne à nouveau ces deux palefreniers de messire von Tornefeld : Maria Christine von Blohme racontent qu’ils lui apprirent à jurer et à jouer de la guimbarde, cette seconde pratique ne lui ayant été, au demeurant, d’aucune utilité dans la vie.
Ce roman tardif (1936) de Leo Perutz, le dernier publié de son vivant, a été le premier que j’ai lu de l’auteur, il y a maintenant fort longtemps, et il demeure, peut-être plus encore à la relecture, l’un de mes préférés de ce maître du récit frontalier, où le fantastique frappe souvent discrètement à la porte, pour mieux se glisser ailleurs par la fenêtre. Il serait dommage de trahir ici le fil des destinées entrelacées d’un voleur professionnel et d’un frêle gentilhomme se rencontrant un hiver du début du XVIIIème siècle, tous deux glacés et faméliques, sur un cruel chemin de Silésie – et ce qu’il advint d’eux lorsque furent échangés, peut-être bien à leur insu, quelques pactes faustiens réels ou imaginaires, le soir de leur rencontre et de leur quête commune de l’abri d’un moulin abandonné. Broyant finement son matériau historique, se coulant avec grâce dans le rôle d’un conteur au coin du feu, qu’il évoque les travaux de la ferme ou les ruses des brigands et autres détrousseurs, qu’il examine la vengeance d’une femme ou l’acharnement d’un colonel de dragons, Leo Perutz excelle à installer ce précieux climat de doute et d’angoisse toujours résiduelle, jamais apaisée, qui caractérise un certain fantastique de la discrétion et de la malice, d’un jeu jamais satisfait avec les heurs et les malheurs du monde tel qu’il allait alors (et certainement, métaphoriquement, tel qu’il allait de moins en moins bien en 1936 en Autriche, pays natal de l’auteur, à l’approche de l’Anschluss).
– Je préfère six gredins à un imbécile. Que t’importe le roi ?
– J’ai fait mon devoir de Suédois, de soldat et de gentilhomme, répondit Tornefeld.
Le voleur eut la tentation de le planter là et de filer. Mais en entendant ces paroles, il lui vint à l’esprit que lui aussi avait son honneur, celui des vagants, et que cet enfant couché à même le sol gelé n’était plus un gentilhomme, en dépit de toutes ses grandes phrases, mais, au même titre que lui, un membre de la vaste confrérie des indigents. Il eût manqué à son honneur en l’abandonnant. À nouveau, il tenta de lui faire entendre raison :
– Lève-toi, frère, au nom du ciel, lève-toi ! Les dragons sont à nos trousses, ils te recherchent. Pour l’amour de Jésus, veux-tu nous conduire tous deux au gibet ! Songe au prévôt, songe à la bastonnade ! Songe que dans l’armée impériale on pend les déserteurs après les avoir fait courir neuf fois autour du bois de justice, sous une volée de coups.
Tornefeld se releva et regarda autour de lui d’un air égaré. À l’est, le vent avait déchiré le pan de brouillard et l’horizon se dessinait. Le voleur vit alors qu’il était sur le bon chemin et touchait à son but.
Traduit d’abord par Frédérique Daber chez Seghers en 1982, puis par Martine Keyser chez Phébus (et chez 10/18 en poche – c’est ce texte-là que j’ai lu et relu) en 1987, « Le cavalier suédois », s’il n’est sans doute pas aussi purement surnaturel que certains autres romans de Leo Perutz (si l’on pense par exemple à « La troisième balle » ou au « Marquis de Bolibar »), s’il n’est pas non plus aussi complexe dans ses méandres que « Le Judas de Léonard », atteint peut-être bien une sorte de plénitude narrative portant la marque d’un auteur alors au sommet de son art d’écrire, deux ans avant son départ de Vienne pour Tel-Aviv et pour quinze ans sans production littéraire de sa part.
Le voleur réfléchit. Pour atteindre le village de Lancken, il lui fallait revenir sur ses pas pendant quelques trois milles. Qui sait si les champs mal entretenus qu’ils avaient traversés n’appartenaient pas au noble cousin de son compagnon d’infortune ? Il aurait bien aimé connaître l’homme qui se laissait escroquer de la sorte par son intendant, ses teneurs de livres, ses bergers et ses valets.
Le chemin était périlleux, il le savait. S’il tombait entre les mains des dragons, c’était la corde à coup sûr, car les gibets ne manquaient pas à la croisée des chemins. Mais il était accoutumé au danger. Plus d’une fois le destin l’avait placé devant cette alternative : mourir de faim ou mourir pendu. À présent qu’il était résolu à mettre un terme à sa vie d’errant, à troquer sa liberté contre le gîte et le couvert, voilà qu’il se sentait envahi, une fois de plus, du désir impérieux de braver le vent âpre du dehors, d’inviter une dernière fois la mort à danser la courante.
Leo Perutz
Leo Perutz - Le Cavalier suédois - éditions Libretto
Charybde2 le 30/05/18
l'acheter chez Charybde ici