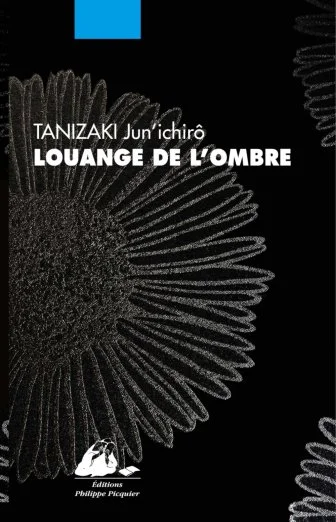Encore la Moitié du Fourbi… et en noir de jais qui plus est
Un cinquième numéro de La moitié/du fourbi sous le puissant signe du noir à facettes de Guillevic, du Black Power, de Nick Cave, et de bien d’autres ombres surprenantes.
Je t’écris d’un pays où il fait noir
Et ce n’est pas la nuit.
Je t’écris
Parce qu’il fait noir.
Je t’écris sur le mur
Qui est au fond du noir.
Eugène Guillevic
Le cinquième numéro de la passionnante revue « La moitié du fourbi », publié en mars 2017, après « Écrire petit », « Trahir », « Visage » et « Lieux artificiels », est placé sous le signe de ce vers et de ces quelques syllabes, arrachés au recueil « Sphère » d’Eugène Guillevic (1907-1997), qui servent aussi d’exergue à l’ensemble de cette livraison, ouvrant l’hommage à l’homme de Carnac composé sous diverses formes poétiques par Pierrick de Chermont (« Vers la lumière inguérissable »), Sylvie-E. Saliceti (« Menhir d’encre »), Sylvie Fabre G. (« Lettre du pays des sources »), Angèle Paoli (« Glane »), Anne-Lise Blanchard (« Veille »), Nolwenn Euzen (« Noir perméable ») et Thomas Vinau (« Une pierre »). L’art de la poésie, en prose ou en vers, conçue en réponse à une autre poésie, surtout pleinement consacrée, est délicat entre tous, et chaque contributeur, qu’il s’adresse directement à Eugène Guillevic et à ses mots, ou plus indirectement à ses résonances et à ses atmosphères, a su trouver une belle et déroutante justesse. Comme il y a peu de choses plus personnelles que la réaction à la poésie, j’ai sans doute été encore plus sensible, encore plus percuté et ému par la perméabilité de Nolwenn Euzen et par le roc de Thomas Vinau.
Qu’importe après cela
Qu’il reste encore du soir
Dans la grande couleur,
Au fond de la couleur,
Puisque nous serons là
Pour tâtonner ensemble
Et que je t’écrirai
Avec mes rêves sur ta main.
En attendant j’écris
Sur la vitre qui doit être au fond du soir :
« Je saisis tes promesses,
« Je pense au jour
« Où sous mes doigts elles parleront
« Comme font les messages
« Avec plus de raison.
Et nous irions
Vers une couleur perméable.
(Nolwenn Euzen)
Il y a une pierre quelque part
dans chaque ventre qui se tait
un enfant trop solitaire
parfois vient s’y cacher
tenir la main de quelque chose
la balancer contre le verre
des vitres éternellement glacées
Il y a une pierre quelque part
qui t’écoute et qui t’invente
sa mousse est une barbe blanche
son sourire une larme effritée
c’est un petit diable modeste
une fleur d’espace un gentil monstre
sur lequel tu pourras compter
lorsque la nuit hurlent les bêtes.
(Thomas Vinau)
Mélikah Abdelmoumen nous offre ensuite une formidable plongée dans les poings levés, gantés de noir, et dans les Panthères noires, en questionnant puissamment tous les vides de la célébrissime photographie du podium du 200 mètres hommes aux Jeux Olympiques du Mexico, interrogeant les gestes de John Carlos et de Tommie Smith, mais aussi, peut-être surtout, la présence discrète et lancinante du troisième homme, sur « La deuxième marche », l’Australien blanc Peter Norman, et la belle et profonde amitié qui l’unit ensuite aux deux principaux protestataires de ce jour de 1968.
Anthony Poiraudeau nous propose avec bonheur une percée incisive dans l’écriture de Nick Cave, à la jonction des paroles de ses chansons et de la prose de ses romans « Et l’âne vit l’ange » et « Mort de Bunny Monroe », dans l’épaisseur suggérée des deux formes de poésie, et dans les tragiques résonances et prémonitions qu’entretiennent certaines des thématiques de prédilection de l’immense rocker australien avec les accidents de sa propre vie.
Mais tout cela, l’ensemble que forme sa vie récente et sa vie passée, Nick Cave considère aussi qu’il s’agit d’une fiction : non que ce soit faux, mais c’est une construction, un assemblage d’artifices, de contingences et de décisions qui forment au fur et à mesure une vie qu’on peut isoler du chaos et de l’obscurité du monde où elle est nécessairement prise, et reconnaître comme la sienne. Pour autant, dit Nick Cave, il n’a pas d’autre vie que celle qu’il s’est construite. Cette fiction est la réalité, et il n’y a rien derrière le masque qu’on s’est forgé : on est véritablement ce masque. (Anthony Poiraudeau, « Un sang d’encre »)
On sait, par le décryptage de plusieurs de ses romans (« Grande ourse » tout particulièrement) ou de ses nouvelles assemblées dans le fascinant « Ravive », que Romain Verger entretient un rapport spécifique à la roche, à la tanière et à l’anfractuosité : le compte rendu de sa visite confidentielle en une grotte célèbre et préservée (« Revenir à Chauvet »), incluant un éventuel clin d’œil, volontaire ou involontaire, à Amélie Lucas-Gary, en est d’autant plus flamboyant, inquiétant, et beau, tout simplement, mêlant avec subtilité le ravissement et la spéculation, l’hallucination et la pétrification.
® French Cockpit http://bloug.frenchcockpit.com
En cinq pages de ces « Chambres noires », Hélène Gaudy réussit l’un de ces assemblages intellectuels et sensibles percutants qui frappent au cœur la lectrice ou le lecteur : en convoquant aussi bien le fictif artiste Carlos Wieder de Roberto Bolaño (« Étoile distante ») que les très réels explorateurs suédois ayant essayé de survoler le pôle Nord en ballon en 1896, ou encore la tentative d’Hervé Guibert dans « L’image fantôme », elle parvient à questionner décisivement le lien dialogué entre la photographie et le texte (à la manière dont les magnifiques travaux des éditions Le Bec en l’Air le pratiquent inlassablement), à s’interroger sur la disparition même de l’artefact porteur d’un témoignage historique (et l’on songera inévitablement ici au Ken Liu de « L’homme qui mit fin à l’histoire »), et à parcourir les déformations chimiques du papier argentique qui hantent par exemple certains travaux de Patrick Imbert.
Sabine Huynh, en s’appuyant sur les dessins diaphanes de Maud Thiria Vinçon, donne corps fantôme à la perte de l’être cher, en rebondissant aussi sur la parole de Guillevic et sur les pas de Jacques Roubaud, d’Anne Sexton, de Sylvia Plath et de Virginia Woolf.
Un matin, je ne sus jamais lequel, mais celui d’un jour lumineux – matin parmi des matins de grande douceur sans doute, puisque le cerisier était en fleurs -, je ne sais comment, je me tenais sur le seuil de la salle de bains, seule – je devais avoir 5 ans – devant un corps inanimé, qui ne ressemblait à rien. Je ne reconnus pas tout de suite ma mère, « maintenant sans ressemblance ». En fait, je dus mettre des années à la reconnaître, à décanter cette image jusqu’à ce que je pus dire que c’était bien ma mère, gisant là. Peut-être ne l’ai-je jamais reconnue, au fond, ne l’ayant jamais connue. Je dis matin à cause du soleil et du silence qui se répandaient dans la pièce. C’était peut-être un dimanche matin. « Cela ne peut pas être cela », écrit Jacques Roubaud dans Quelque chose noir trente mois après qu’une embolie pulmonaire a emporté sa femme, la photographe Alix Cléo Roubaud ; « je cherche un indice dans le soleil, dans la flaque de soleil couché devant la porte, qui déjà se remue, se retire ». (Sabine Huynh, « La main, le soleil et la mort »)
La conversation entretenue par Zoé Balthus avec Ryoko Sekiguchi, à propos de Tanizaki Junichirô, dont la poétesse et cuisinière franco-japonaise vient de nous offrir (en collaboration avec Patrick Honnoré) une nouvelle traduction de sa « Louange de l’ombre », chez Picquier, est captivante, évoquant aussi bien le maître et sa subtile critique en creux de l’Occident que les regards posés sur le Japon, le rôle des clichés interculturels que ceux de l’humour, du silence et de l’ombre. Nous aurons un immense plaisir à les retrouver le jeudi 4 mai prochain, à partir de 19 h 30, sur ce thème, à la librairie Charybde (129 rue de Charenton 75012 Paris).
Dans « Les boîtes noires », Vincent Bontems nous invite dans les coulisses de l’écriture de son récent « Idées noires de la physique », avec Roland Lehoucq, envers d’un décor fort sérieux de la science dans lequel on voit tout à coup surgir André Franquin, Gaston Bachelard, Tonino Benacquista, Fred Hoyle et Eric Solomon, qui s’entrelacent joliment avec le ciel noir, le corps noir, le trou noir, la matière noire et l’énergie noire.
Caroline Boidé adresse une très poétique et très poignante lettre à la défunte Grisélidis Réal, y mêlant habilement extraits biographiques réagencés, professions de foi littéraire et regard sur le monde délivré de ses noirceurs les plus évidentes (« Lettre à Grisélidis »), tandis qu’Adrien Absolu, s’infiltrant sous la peau d’un critique gastronomique et mondain impitoyable, démonte le ridicule, les approximations, les significations et leurs absences, et peut-être bien la malhonnêteté de l’expérience sensorielle et gustative « unique » proposée par le restaurant parisien « Dans le Noir ? », où il est question de dîner dans le noir absolu, servi par des aveugles spécialement entraînés (« Circulez, y a rien à voir »).
Frédéric Fiolof réussit une pièce éblouissante sur un sujet explosif entre tous : quelle peut donc être la nature de la beauté noire qu’un individu normalement constitué, humaniste et dépourvu d’attaches et d’hérédités dans le monde de l’afición peut trouver dans la corrida, dans ses subtilités, dans ses mystères et dans ses cruautés ? Un texte superbe, intime et poignant, peut-être même surtout pour la lectrice ou le lecteur qui détesterait la tauromachie.
Tu voulais creuser la question noire mais tu l’as contournée. Peut-être parce que, comme René Pons, tu es finalement incapable d’y répondre. Alors tu pourrais en amoindrir la portée. Te dédouaner, en quelque sorte. Le procès de la corrida ne date pas d’aujourd’hui et ses défenseurs ont développé des arguments informés et cohérents qui touchent aussi bien à la philosophie et à l’éthique qu’à l’écologie et à la physiologie. Tu les connais mais tu n’as pas envie de t’y réfugier. Et quoi qu’il en soit, même si l’on peut objectivement trouver que le sort du taureau de combat et le respect qui lui est accordé bien plus enviables que ceux réservés aux animaux d’abattage, même si le spectacle de la souffrance n’est absolument jamais une source de plaisir pour un aficionado, même si la sensibilité ne laisse présager de rien, tu sais qu’au-delà de tous ces apurements, la corrida demeure un spectacle trouble. Probablement le plus trouble de tous. C’est cette zone d’ombre que tu décides, que tu acceptes d’accepter. L’ombre, ici, désigne deux choses : ce lieu curieux, saisissant, peut-être scandaleux – les arènes -, où la beauté joue pour de vrai avec la mort dans une obscure lumière ; et puis cette part de toi-mêmeque tu connais mal (en quête d’emphase ? blessée ? résiliente ?), qui s’y accorde avec autant d’émotion. Une émotion à chaque fois renouvelée, et qu’à peu près seule la littérature (dont la corrida est peut-être une forme en acte et périssable) est ailleurs capable de te procurer. (Frédéric Fiolof, « Une question noire »)
« Noctem virumque cano », de Hugues Leroy, est l’un de ces textes formidables et déroutants dont il nous montre le secret depuis le premier numéro de la revue. Saisissant un épisode particulièrement ardu de la guerre cryptographique entre Français et Allemands durant la première guerre mondiale, épisode dont le paléontologue polytechnicien Georges Painvin est le principal héros, il nous entraîne dans l’atmosphère fiévreuse et maladive de ces courses insensées contre la montre, à la manière du grand Neal Stephenson dans son fleuve « Cryptonomicon », à propos, lui, de codes de la deuxième guerre mondiale et d’algorithmes contemporains.
Il pourrait se dire qu’il s’est trompé du tout au tout : mais Painvin a la foi des cryptologues. Il sait que derrière la grande nuit de la guerre, il y a des hommes ; et il sait que les hommes tachent la nuit, car les hommes sont créatures de sens. Le sens coule de leurs actes, quand bien même ils voudraient l’empêcher : il coule et tache la nuit, comme coule leur sang durant l’assaut. Le sens est la malédiction des hommes. (Hugues Leroy, « Noctem virumque cano »)
Avec « Urphänomen », Nolwenn Brod nous offre un étonnant portfolio de 6 pages, somptueux et assorti de son explication du « phénomène primitif », issu du « Traité des couleurs » (1810) de Goethe, par lequel la lumière et l’obscurité s’associent pour permettre la naissance des couleurs, et appliqué ici photographiquement à de très contemporains terrils, tandis que Véronique Béland rend compte en quatre images de la folle expérience que fut l’installation multimédia « This is Major Tom to Ground Control », et de la performance et du livre qui y furent associés, transformant les ondes cosmiques captées par un radiotélescope de l’Observatoire de Paris en textes aux règles de composition élaborées.
Ian Monk, oulipien depuis 1998, et dont l’on aime tant sur ce blog les jouissifs et déroutants « Plouk Town » et « Là », assure la présence inamovible dans La moitié du fourbi de « L’œil de l’Oulipo », en nous lançant sur les traces (quitte à devoir improviser in fine) de fort paradoxaux « sonnets alexandrinistes » grâce à Jacques Roubaud, Jean Queval, Raymond Queneau et Jacques Jouet. (« La nuit traversée »)
Stéphane Vanderhaeghe décrypte une habitude intime d’écrivain et y cherche sa part emblématique, creusant le rapport de la luminosité à la page blanche et aux caractères qui viendront éventuellement l’habiter – et suscitant alors les apparitions fantomatiques de Maurice Blanchot.
Alors, il ajoute un dernier mot, une dernière phrase tout en repensant à ses lectures de Blanchot pour qui l’écriture consistait à rompre le lien avec une parole efficace et mondaine ; pour qui écrire, c’était « retirer le langage du cours du monde, le dessaisir de ce qui fait de lui un pouvoir par lequel, si je parle, c’est le monde qui se parle, c’est le jour qui s’édifie par le travail, l’action et le temps. » Et il se dit alors que le noir n’est jamais assez noir, jamais assez profond, jamais assez silencieux. Le dessaisissement jamais assez complet. Sans doute est-ce pour ça, du moins en partie, qu’écrire est toujours en soi un échec. Qu’il faut y revenir en permanence. Récrire dans le noir. Noircir l’écran, et la page de plus belle.
Charles Robinson, enfin, achève cet excellent numéro de la revue, qui prouve une cinquième fois que l’on peut aujourd’hui être ambitieux au plan littéraire, subtil et politique, avec son terrifiant recensement d’écrasements et de morts, sur le mode – détourné et trafiqué – du fait divers journalistique, qui frappent déclassés, sans domicile fixe, travailleurs pauvres, déboutés du droit d’asile et autres laissés pour compte d’une société qui, sinon, va bien, merci – et aime à le faire savoir dans ses luxueuses célébrations périodiques.
La politique sociale, en France, aujourd’hui, est une fosse ténébreuse. Un trou dans le sol, bétonné, sans margelle, et ce n’est pas la nuit, c’est 24/24. (Charles Robinson, « 351 »)
Revue La moitié du fourbi – 5 : « Noir, et ce n’est pas la nuit»
Coup de cœur de Charybde2 le 11/04/17
L'acheter chez Charybde, ici