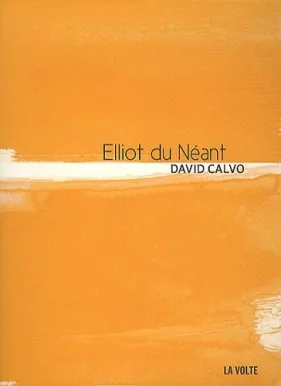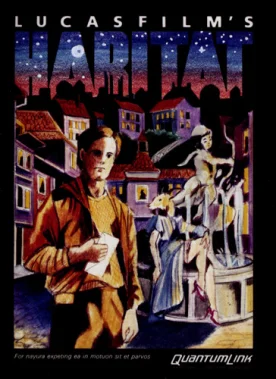Elliot du néant : fin de partie avec macareux
Entre saga islandaise ancestrale, jeu vidéo contemporain et exégèse mallarméenne, une très beckettienne fin de partie poétique.
Je ne rêve pas. Pour être plus précis : j’ai conscience du rien. Si le sommeil est un canevas de ténèbres sur lequel nous brodons des merveilles, pour moi ce noir, cette absence de tout, est déjà texture. Une terreur ; toutes les nuits, il faut compter les secondes qui me séparent du réveil. Je ferme les yeux puis je m’éteins, sans batteries, sans plus de souffle. Je saisis chaque mesure du temps. Je préfère parfois rester debout, attendre que le temps s’écoule. Tout le monde rêve, à ce qu’on dit. Il suffit juste d’apprendre à se souvenir, il existe des solutions. J’ai essayé. J’ai laissé un verre d’eau près de mon lit. J’ai roulé pour retrouver cette place sur le matelas, dans la vallée de l’oreiller où, passé l’écrin du souvenir, les rêves s’incarnent. J’ai placé des mobiles de planètes, des fleurs séchées dont les pétales souillaient les draps. J’ai bu tous les breuvages de sorcières, avalé tous les séminaires, mangé des runes. J’ai modélisé le tunnel que les rêveurs ont l’habitude d’emprunter pour sortir de l’autre côté, dans le rêve. Mais moi, Bracken, moi, je ne sors jamais. Pour être plus précis : il n’y a pas de tunnel.
Publié en 2012 à La Volte, le septième roman de David Calvo venait à point nommé rappeler à la lectrice ou au lecteur à quel point l’auteur de « Wonderful » (2001) ou de « Atomic Bomb » (2002), ou encore des nouvelles de « Acide organique » (2005), compte parmi les talents les plus inventifs et les plus aigus de la littérature française contemporaine – lorsque la conception et création de jeux vidéo consent à relâcher son emprise sur l’auteur pour lui permettre d’écrire ces textes résolument inclassables, et nettement délectables, mélangeant profondément des produits chimiques à haute teneur habituellement conservés soigneusement séparés.
Un besoin s’installe, comme on entre dans des chaussons moelleux, depuis longtemps pelés. Me mettre en mouvement, avant que mon corps ne sèche. Prendre ma vie en main, cesser de mourir tous les matins. Avancer, sortir du lit, mettre un pied devant l’autre et agir. Depuis ma démission de l’école, j’ai l’impression de patienter dans la salle d’attente de mon destin. Étranger chez moi, de passage, entre parenthèses, toute une vie comme un paquet-cadeau. Mon futon moisi, ces chaussettes, ces livres, ces bibelots, nouveaux objets technologiques aux formes blanches, mon intimité dans le marbre mou des draps. Qui viendra fouiller ces ruines fragiles pour savoir de quoi ma vie était faite ?
Pour des raisons que l’on apprendra en temps utile, mais qui pourraient contenir une part d’ignominie justifiant désormais une solide misanthropie, Bracken a dû quitter l’école islandaise où il enseignait le dessin, et se résoudre à l’inaction. Jusqu’au jour où Fink, le vieux surveillant général, affolé, vient le chercher en catastrophe et demander son aide : la veille de la kermesse de l’école, alors que rien n’est encore prêt et qu’un grand concert de Nick Kershaw (nous sommes en 1986) doit avoir lieu à cette occasion, Elliot, le vieillissant et réputé autiste homme à tout faire de l’école, particulièrement habile dans l’entretien des canalisations épuisées, manque à l’appel. Considéré depuis longtemps par le proviseur Plouffe – par ailleurs spécialistes de poésie symboliste française – comme son fils, le concierge apprécié de tous s’est enfermé dans sa chambre et ne répond plus.
Elliot vit ici depuis toujours, placé par l’État pour entretenir les canalisations de l’école. Il est si vieux, il a pu mener mille existences. Un environnement stable lui avait probablement permis de prendre conscience de sa condition dès son jeune âge, mais il était resté confiné dans un monde d’ordre obscur, voué à des tâches d’entretien pacifiques. L’école a des tubes parfaits. Quand j’avais constaté sa précision, je l’avais autorisé à participer à mes cours d’éveil avec les plus petits, pensant que cela aiderait tout le monde de le voir dessiner des petits monstres. Elliot se passionnait pour les catalogues, les escaliers et les macareux. Il aimait par-dessus tout dessiner la mer, les animaux marins, les tortues, les baleines, les hippocampes, les anémones entre les rochers, les algues dans le ressac. Son monde était un vivier où chaque espèce était un sujet d’émerveillement.
Une fois forcée la porte de la chambre, il faut constater l’évidence : Elliot ne s’y trouve pas, ou ne s’y trouve plus. Cet apparent mystère de chambre close crépusculaire, dans cette école où la décrépitude rampe derrière les cuivres astiqués, donnant aux silhouettes rejoignant le drame qui se noue un air de « Fin de partie » digne de Samuel Beckett, est le véritable point de départ d’une quête extraordinaire, épique et inquiétante, folle et feutrée, dont l’enjeu n’est peut-être rien de moins que la saisie de l’essence du Néant – qui n’est pas sans doute ce que le sens commun croit deviner. Morses et macareux, tortues souffrant logiquement d’amnésie antérograde comme les héros de Gene Wolfe (« Soldat des brumes », 1986) et d’Antoine Bello (« Enquête sur la disparition d’Émilie Brunet », 2010), faute de quoi leurs commentaires de la partie en cours auraient certainement rejoint ceux des taupes de Malvina Majoux dans « Temps additionnel » (2012), chœurs antiques ayant aussi puissamment que discrètement muté, jeux vidéo en réseau au nom – neutre ou non – d’Habitat, dont le lag vers les serveurs ne sera jamais innocent, mythologies nordiques du peuple des fées – soigneusement mâtinées des créations propres aux pulp magazines chers au Dustin Long de « Icelander » (2006) -, tesseracts putatifs et papiers peints interstitiels – où rôderaient les constructions impensables de Mark Z. Danielewski et de sa « Maison des feuilles » (2000) -, lentilles réticulées ouvrant sur des paysages insoupçonnés – dont rêverait volontiers à son tour le « Cugel » de Jack Vance -, encres sympathiques issues d’algues fort peu innocentes, les devinettes potentiellement partie intégrante de tubes pop écrits en yaourt, les réminiscences insidieuses d’épisodes oubliés de « La Quatrième Dimension », et bien d’autres facteurs en apparence tout aussi surprenants, y compris une simple paire de moufles : tout cela joue un rôle ici.
Quelque chose d’immense bascule en moi, de lourd, d’infiniment douloureux. Je sais que je suis coincé ici, sur ce bout de sable au bout de nulle part. Je sais que ma seule chance de m’en sortir, c’est de rejoindre cette tour, là-bas, quelque part.
– Je ne peux pas attendre dix ans, Hinrik.
– Si vous voulez devenir Maître, il le faudra.
Dressé sur ses pattes, le macareux me regarde.
Il déploie ses ailes pour me faire un câlin.
Si le rythme halluciné du récit et une bonne partie de sa mécanique apparente évoqueront irrésistiblement le jeu vidéo (dont le méta-imaginaire hante certainement « Elliot du Néant ») et si l’on se surprendra ainsi plus d’une fois, en pensée, à passer la souris sur la page, en espérant ainsi y voir apparaître les objets et passages indétectables à l’œil nu, si familiers au jeu d’aventure sur ordinateur ou console, c’est néanmoins sans doute avant tout de langage qu’il est question ici, d’onirisme assumé et de puissance performative des rêves décryptés. Joueuse et précise, imagée et trompeuse, la langue de David Calvo se déploie comme une membrane invisible, à même d’envelopper la lectrice ou le lecteur et de les incorporer à ce récit à quadruple fond.
Dans le vaste évier en aluminium de la cantine déserte, remplir un vase rond, vider le sachet dans le bocal. En le manipulant, je me rends compte que je n’ai pas retiré mes moufles depuis mon retour. Elles font partie de moi. Leur maladresse me donne l’assurance de rester ici sans partir en hurlant. Si je les enlevais, j’aurais peur de ne plus y trouver mes mains.
Si la figure de Stéphane Mallarmé émerge progressivement des tours et des détours de ce jeu singulier, en surprenant boss potentiel de la dernière pièce, on trouvera aussi des échos captivants de l’Ursula K. Le Guin de « Terremer » dans cette quête poétique et philosophique empruntant des décors et des masques si inattendus, pour permettre à David Calvo de nous offrir une magnifique et déroutante prouesse, crépusculaire et poignante, déterminée pourtant à forcer le destin de l’extinction de la poésie et de la subversion du néant politique.
– Il nous sera très difficile de décoder cette fresque. Et je ne vois pas ce qui pourrait nous tenir lieu de pierre de Rosette. Il s’agit d’un langage primitif. Comme celui des nouveau-nés. Pour nos anciens, le monde autour d’eux était le langage. Toute chose avait un nom, et le nom devenait verbe. Rien n’était inventé, tout était lié aux référents, le signifiant et le signifié ne faisaient qu’un. Ce n’est qu’avec le temps que nous avons appris à donner des sens différents aux mots, puis les cultures ont achevé de désintégrer les relations entre le monde et le mot. Puis le mot devient un verbe, comme le font les enfants et les primitifs. Il rend le monde actif.
David Calvo
David Calvo - Elliot du Néant - éditions La Volte
coup de cœur de Charybde2
l'acheter chez Charybde, ici