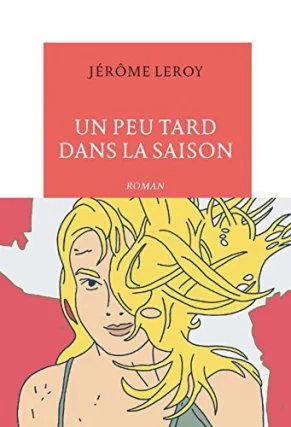Jérôme Leroy déroule la romance des éclipsés
Fuir, là-bas fuir… Retour énigmatique sur une tendre apocalypse.
Quand j’ai su qui il était et que je l’ai retrouvé, c’était peu de temps avant les attentats, dans les derniers jours de décembre 2014. Pendant les Fêtes, comme on dit. Il habitait dans un bel appartement, au dernier étage, square Henri-Delormel, dans le XIVe, depuis une quinzaine d’années, date de son arrivée à Paris. On était dix-huit mois avant que le colonel ne me parle de la nouvelle grande peur du pouvoir, l’Eclipse, et de ceux qu’on appelait dans le Service et dans certains cercles du pouvoir les éclipsés, faute de mieux.
L’appartement, il le louait pour une somme dérisoire à sa mécène. Je l’ai appelée comme ça dès que j’ai connu son existence. Je ne voyais pas d’autre mot. Mère maquerelle aurait manqué d’exactitude et aurait sans doute par trop trahi mon a priori défavorable. Ce qui était sûr, c’est que ce n’était pas avec ses droits d’auteur, ses piges et sa participation à quelques scénarios qu’il aurait pu vivre là, avec vue sur la jolie cour et ses immeubles 1930.
La première fois, je suis restée à regarder ses fenêtres assez longtemps, depuis la rue Ernest-Cresson. Je n’avais pas encore d’idée précise de ce que je voulais faire. Ou si, en fait. Mais je ne l’avais pas formulée clairement. L’inconscient : ce genre de choses auxquelles ne croyaient pas les militaires qui ne s’en portaient pas plus mal. Et encore moins les espions.
Alors quand on cumulait, comme moi…
Jadis capitaine dans les services spéciaux français, Agnès Delvaux observe sa fille Ada, dans un décor presque champêtre d’après la dissolution de la civilisation traditionnelle, dix-sept ans plus tôt, tout en couchant sur le papier, pour qu’Ada le lise un jour ou non, son compte-rendu subjectif de ce qui s’est passé à l’époque, alors qu’elle traquait comme son ombre un écrivain appelé Guillaume Trimbert, pour diverses raisons qui apparaîtront au fil du récit, entrecoupant sa propre narration de bribes de confidences et de pensées de l’écrivain en question, vraisemblablement volées à ses carnets intimes, qu’elle fut amenée à abondamment consulter durant cette longue mission d’espionnage à son encontre.
Depuis plusieurs années, Jérôme Leroy cultive pour notre plus grand plaisir – du cœur comme du cerveau – un impressionnant tissu de motifs obsessionnels, qu’il réagence et enrichit au fil des ouvrages pour nous offrir, successivement appréhendée depuis des angles de vue différents, une singulière symphonie temporelle de notre présent, entrecroisant le souvenir de jours enfuis – ceux d’un monde d’avant qui n’a peut-être pas complètement existé – et l’invention d’années à venir – dont il n’est peut-être pas, malgré tout, définitivement impossible de conjurer la venue, même si les espoirs objectifs semblent en mincir à vue d’œil. Si « Le Bloc » (2011) ou « L’Ange gardien » (2014) composent à partir de matériaux personnels la toile noire et serrée d’une politique cynique et rugissante terriblement proche de celle que nous connaissons, c’est du côté de « Monnaie bleue » (1997), de « Big Sister » (2000) et surtout de « La minute prescrite pour l’assaut » (2008) que l’on trouve sans doute exprimées le plus directement les diverses apocalypses potentiellement en gestation dans notre capitalisme tardif contemporain et dans sa ligne de fuite suicidaire à moyen terme.
Tavaniello/Quadruppani
Mais ce n’était pas Tavaniello qui m’intéressait, ou en tout cas pas encore. Celui qui m’intéressait, c’était lui. Seulement lui.
Pour tout dire, je soupçonnais à la lecture de ces premières données une certaine part d’histrionisme, mêlée à un sentiment d’égarement. Voilà, il était un égaré. En attendant, comme tant d’autres, de s’effacer, de laisser tomber, de faire un pas de côté et non plus en avant.
En attendant d’être un éclipsé.
Ses fenêtres étaient allumées. Ce n’était pas souvent. Il faisait partie de ces écrivains itinérants qui vivaient de rencontres dans les médiathèques les plus improbables dans la banlieue d’Arras ou au cœur de l’Ariège, de résidences d’écriture au fin fond de la Creuse ou du pays d’Auge, de salons consacrés au roman noir, à la littérature jeunesse ou à la poésie.
Il ne devait pas vouloir dépendre exclusivement de ce que lui donnait la mécène. Les hommes de son âge aimaient se mentir. Le problème, c’est qu’ils se mentaient mal et qu’un jour ils ne se mentaient plus. Alors, au choix, ils buvaient trop, se suicidaient ou, dans les derniers temps, ils s’étaient éclipsés.
Dans ce « Un peu tard pour la saison », Jérôme Leroy a pris grand soin de brouiller encore un peu plus les pistes, mobilisant plus encore qu’à l’accoutumée chez son protagoniste écrivain des traits d’existence empruntés à ce que son blog ou ses billets journalistiques dévoilent du véritable Jérôme Leroy (jusqu’à certains de ses propres amis auteurs, dont le pseudonymes n’empêcheront pas la DCRI d’obtenir les photographies – voir les crédits en fin d’article) – car, comme il le déclarait en 2014 à nos amis de Culturopoing, à propos de « L’Ange gardien » : « On peut toujours s’amuser à ça (NDLR : voir partout de l’autobiographie) mais moi, ce qui m’intéresse et ce qui intéresse les écrivains en général, c’est de mettre de soi dans tous les personnages. Un écrivain, pour moi, il doit être capable de se mettre dans la peau d’un fasciste, d’une fille de 17 ans ou d’un chien. » Ce qui compte ici n’est évidemment pas de décrypter les vraies-fausses clefs offertes ainsi à l’amusement (ou à la paranoïa) et au goût du détail « qui sonne juste » de la lectrice ou du lecteur, mais bien, sans doute, de saisir la nature de l’ éclipse décrite comme le phénomène venant mettre fin à une certaine ex-civilisation.
Sébastien Lapaque
Une des conséquences secondaires du téléphone portable, par exemple, est une dévaluation de la parole donnée, ou de l’engagement. Il est tellement facile de se décommander que cela devient presque le moyen de se prouver sa propre importance. Le dernier. Car soyons lucides, nous ne sommes plus très importants. Pour personne. Ce n’est pas plus mal, en ce qui me concerne. J’ai hâte de m’effacer. Une journée sans appel m’angoissait, il n’y a pas encore longtemps. Aujourd’hui, quand cela arrive, j’éprouve le soir une manière d’euphorie, un sentiment de victoire éphémère dans une vie qui a ce goût de défaite depuis si longtemps. (…)
L’absence ou l’éloignement étaient une ordalie pour les amants. N’importe quel soldat en opération extérieure, n’importe quel marin au long cours attendait le courrier remis par le vaguemestre ou la poste restante à la prochaine escale. Parfois, c’était triste parce que l’histoire ne tenait pas mais si elle tenait, c’était pour la vie. Aujourd’hui, c’est à peine si le marsouin engagé au Mali qui s’apprête à lancer une grenade dans une grotte des Iforas n’est pas dérangé par un SMS amoureux ou grognon de sa petite amie qui hésite sur la jupe qu’elle va mettre pour sortir.
Derrière la chanson nostalgique et critique, derrière le regret d’une époque révolue qui sut fugitivement être plus douce que celle d’aujourd’hui, ivre de ses crispations jusqu’au-boutistes, de sa marchandisation devenue folle, de son cynisme halluciné, de ses marottes plongées dans le divertissement industriel et le culte de la vitesse inutile, alors que la toile de fond sécuritaire de « La politique de la peur » de Simon Tavaniello, pardon, de Serge Quadruppani, étend son emprise, il y a ici à l’œuvre une douce et pourtant acérée musique spéculative, réorganisant de manière poignante les motifs essentiels du Jérôme Leroy que l’on croit toujours connaître – et qui nous surprend ainsi derechef – pour pousser dans leurs retranchements (et dans leurs conséquences de masse à l’échelle d’une société) le « I would prefer not to » du Bartleby de Melville ou le « Rêve général » de Nathalie Peyrebonne, effacement dans le détachement, au sens de Michel Serres, contre lequel l’État, même aussi « profond » que nous l’aurait révélé le Berthet de « L’Ange gardien », ne peut décidément rien – et doit à son tour abdiquer, après un cynique baroud d’honneur de ses éléments les plus aguerris – ou les moins affectables par l’émotion et la pulsion de retrait qui sourdent peu à peu de partout – et qui précipitent les paysages ruraux et même balnéaires si chers au narrateur vers une toile résonnant d’abord aussi avec celle, par exemple, des « Événements » de Jean Rolin.
Patrice Normand
Chez lui comme chez les futurs éclipsés, cela a dû commencer de manière imperceptible. Des signes, des petits faits qui se sont succédé et qui l’ont amené à franchir le pas. Il a mis un peu moins de deux ans à le faire, à rejoindre sans le savoir la foule invisible qui a signalé le commencement de la fin. Le colonel avait eu raison. L’effondrement a été complet en à peine une décennie. (…)
Mais c’était un sacré taiseux, au fond, pour quelqu’un qui a tellement écrit. Sans grand succès, d’ailleurs… Il y avait bien ces notes sur des carnets, des fragments dans son Mac, mais c’était tout. Et il ne donnait pas l’impression de chercher à en faire un livre. C’était dommage : j’aurais pu convaincre le colonel qu’un écrivain qui racontait sans le savoir ce qui était sur le point de se passer méritait un traitement particulier. Les choses auraient été plus simples.
Mais non, il continuait de publier ses romans noirs dans une veine très politique qui n’effleurait même pas cette question. Ou alors, mais je me dis que c’est une illusion rétrospective, dans sa poésie : d’autres que moi, y compris dans le Service, auraient peut-être pu discerner ce qui était en train de couver dans certains de ses poèmes. Mais qui lisait de la poésie, en ce temps-là ? Dans le Service, on avait bien un département informel qui surveillait la fiction dans la littérature, à la télé ou au cinéma, mais rien pour la poésie. Quelle erreur quand on y songe…
Paradoxalement toujours aussi percutant dans un roman à la mélancolie terminale et soignée, matoisement énigmatique, que dans des thrillers échevelés se condensant en quelques heures d’action, ou que dans des nouvelles vives et des poésies faussement douces, Jérôme Leroy s’impose à nous comme un rare condensé du don d’observation tous azimuts, de l’imagination fertile, de la référence franche ou insidieuse, et du sens aigu de ce qu’il faut écrire pour faire ressentir et partager la tendresse d’une fatigue apparemment sans issue (ou justement, pour pouvoir y réagir – car il n’est après tout pas certain qu’il soit trop tard dans la saison).
Photos (tous droits réservés DGSI) : Guillaume Trimbert, l’ami Tavianello et l’ami Cénabre.
Ce qu’en dit joliment Jean-Marc Lahérrère sur son blog Actu du Noir est ici.
Jérôme Leroy - Un peu tard dans la saison - éditions de La Table Ronde
Coup de cœur de Charybde2
l'acheter ici