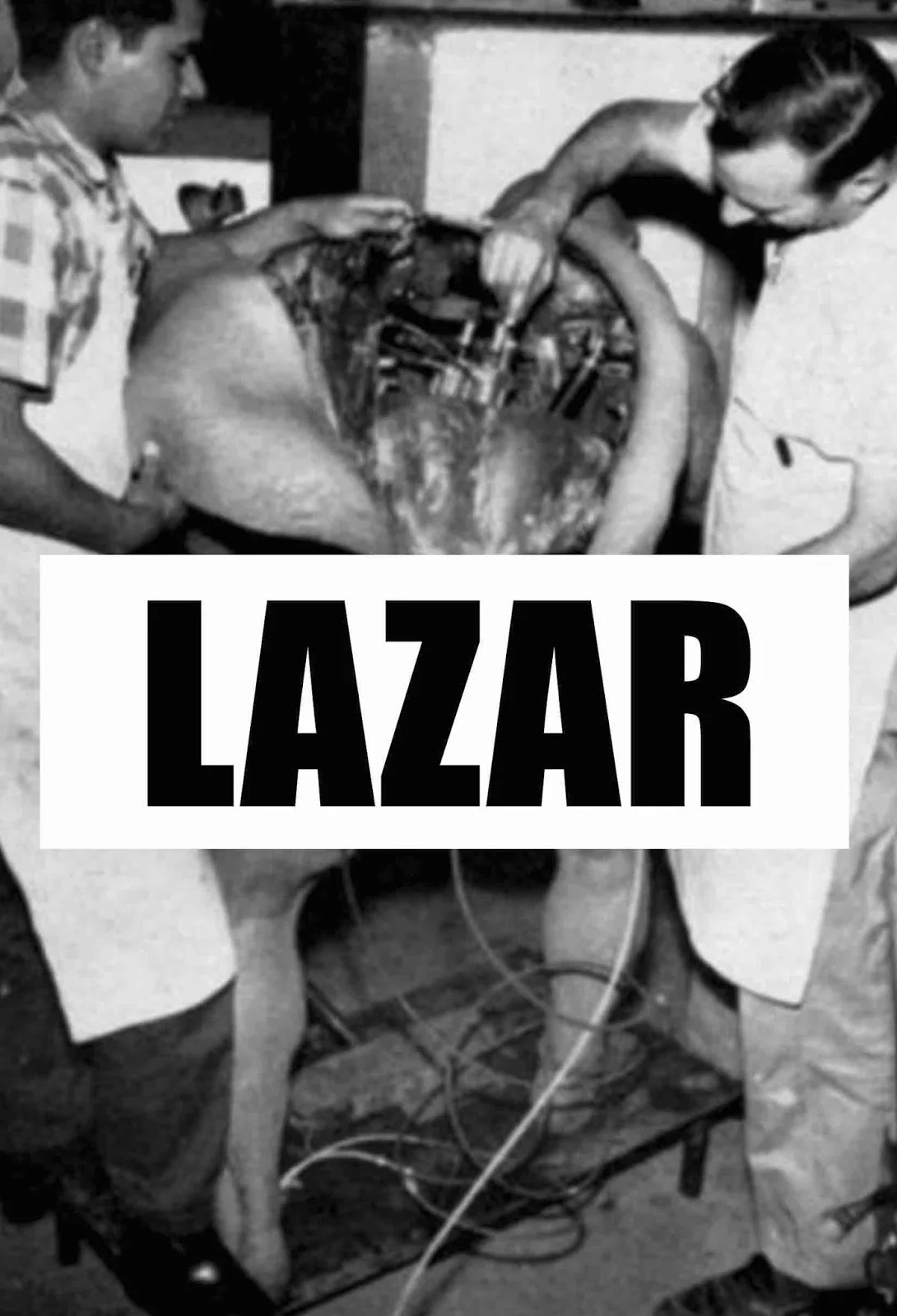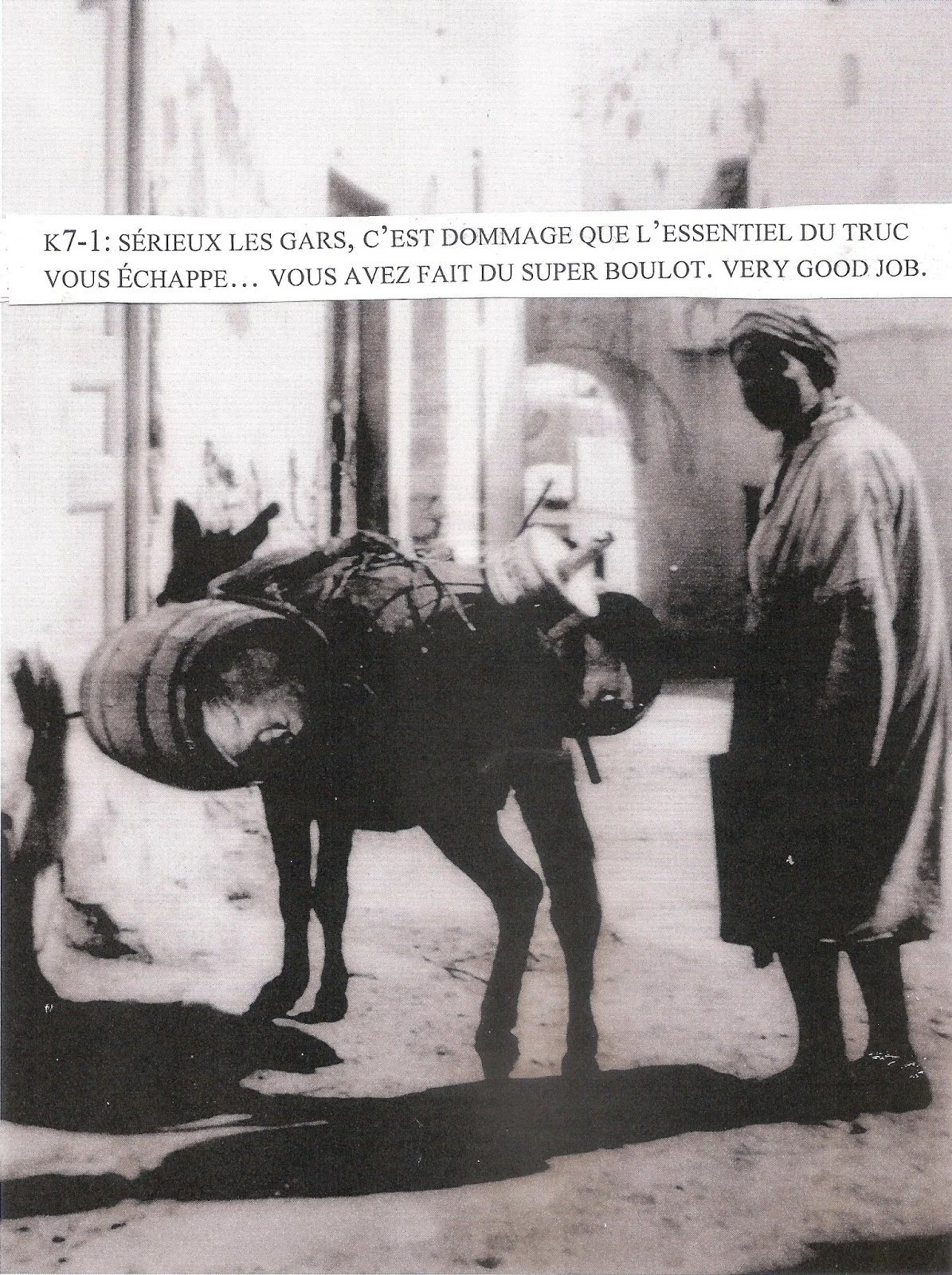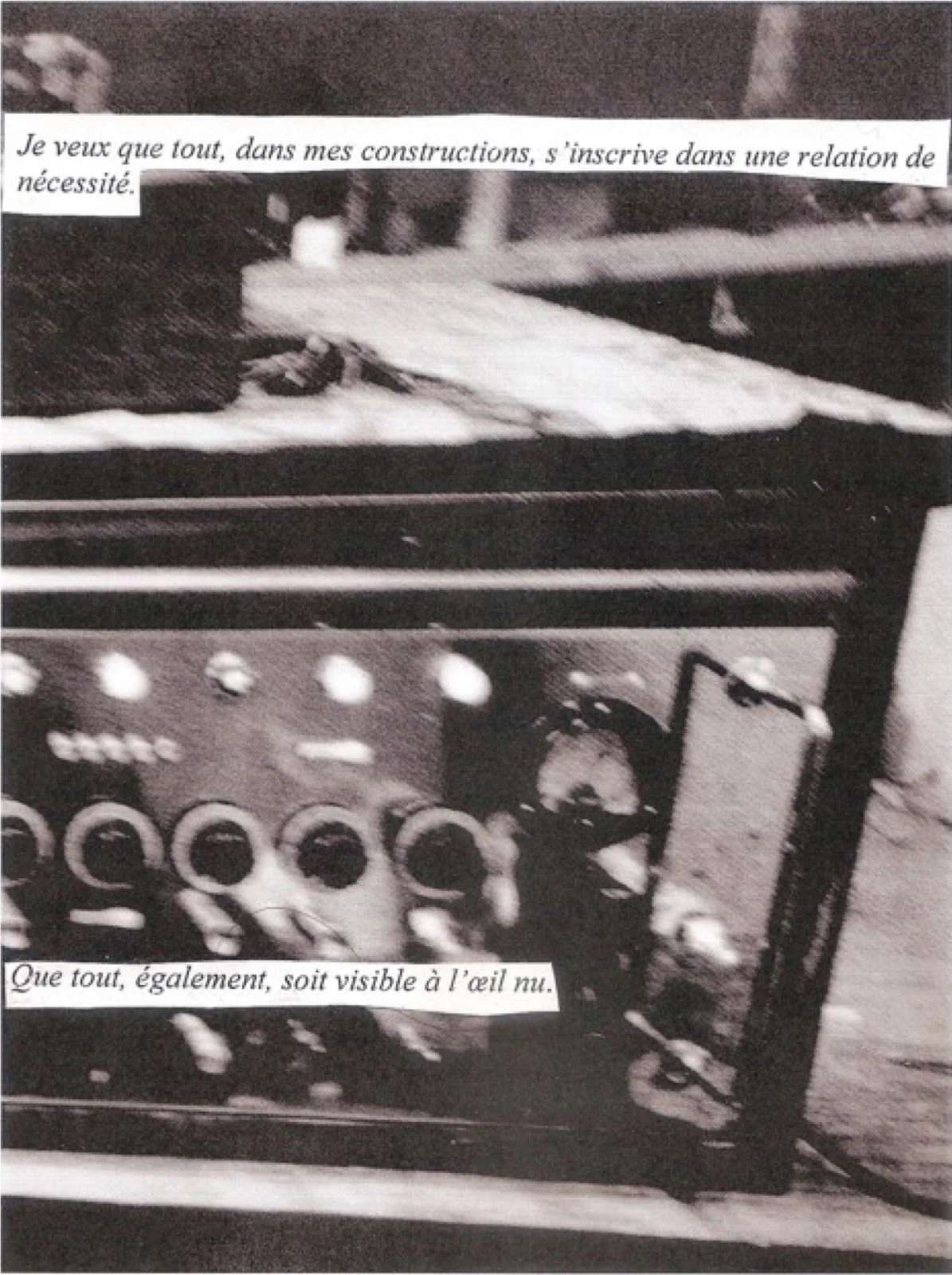"Lazar" : un objet littéraire nanti d’une force redoutable
Publié en mars 2016 chez l’éditeur singulier – qui mérite à cet égard parfaitement son nom -, le quatrième roman d’Olivier Benyahya s’impose comme objet littéraire particulièrement étonnant, nanti d’une force redoutable.
Saisir, très partiellement sans doute, de quoi il retourne suppose ici de s’appuyer sur deux sources inhabituelles, là où le sens commun les discrédite le plus souvent en première intention : la présentation éditoriale du projet par l’auteur, et la copieuse (et captivante) bibliographie proposée en annexe n’ayant rien de secondaire. Pour évoquer, donc, le rapport Goldstone (officiellement : « le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le conflit à Gaza ») de 2009, et beaucoup plus spécifiquement, le revirement du juge sud-africain Richard Goldstone en 2011 vis-à-vis des conclusions du dit rapport (qui, grosso modo, mettait en cause les violations des forces israéliennes aussi bien que celles du Hamas, avant que le juge Goldstone n’en vienne à regretter, seul contre les trois autres responsables du rapport, qu’Israël n’y ait pas été davantage blanchi), l’auteur a imaginé un parcours à la fois complexe et curieusement réjouissant.
Minutieusement et paradoxalement évoqués plutôt qu’établis (car l’objet souterrain essentiel de ce roman a sans doute bien à voir avec le fact-checking, avec la question des sources, de leur profondeur et de leur fiabilité lorsqu’il s’agit de se faire une opinion, quel que soit le sujet ou presque – et on pensera peut-être alors au John d’Agata de « Yucca Mountain » et de « Que faire de ce corps qui tombe »), les faits mettent en jeu un groupe de personnages de l’ombre, spécialistes ès manœuvres délicates et discrètes, d’autant plus flous qu’ils excellent ici visiblement à apparaître en plein jour sans éveiller attention ou soupçon. Nommés, surnommés ou pseudo-nommés Lazar, Lewis, Betsy, Hilda, Natalia ou Turkov, évoluant entre l’Hôtel Central, l’hôpital (et sa morgue), le Speakeasy, le musée d’histoire naturelle, l’entrepôt partiellement désaffecté ou l’immeuble presque abandonné, lieux qui prennent au fil des pages une coloration quasiment post-exotique, ils ont enlevé Gruner et l’ont interrogé jusqu’au bout. Ils pourraient être, par leur modus operandi, de subtiles transmutations des commandos du Mossad imaginés par Éric Rochant dans son film « Les patriotes » (1994), et tout particulièrement de l’impressionnante interprétation presque mutique d’Yvan Attal (« Ariel »). Ils pourraient être tout autre chose.
« Les patriotes » (1993), Éric Rochant
Il est difficile, aujourd’hui, de comprendre les incertitudes de l’époque. Nous étions tous déçus. Beaucoup estimaient que s’ils voulaient survivre, un changement devait s’opérer. Quelques années après les troubles, Lazar consacra plusieurs jours à la relecture de ses notes. Il fut étonné de l’écart entre la conception qu’il se faisait désormais de son passé et les événements de son passé réel, rapportés aussi fidèlement que possible de sa propre écriture. C’est peut-être que,se dit-il, à la longue, tout ce qui est arrivé à l’un est arrivé à l’autre. Il y a des gens qui racontent leur vie, et ils la racontent toujours de la même manière. Cela signifie que le souvenir a disparu. Seule reste une histoire que l’on récite par coeur. La conviction s’imposa à Lazar qu’il fallait aborder chacun de ces moments sans préjugés, les isoler des systèmes explicatifs construits autour d’eux.
On pouvait reprocher un certain nombre de choses à Lazar. Oublieux des gens qui l’entouraient, capable de se montrer insultant, grave : c’était l’image que le temps avait contribué à forger. Tous les témoins, cependant, auraient dû s’accorder sur le fait que Lazar constituait une unité plutôt accueillante et activement disjointe. Beaucoup de ceux qui éprouvaient de la méfiance à son égard diront que je me suis trompé. Peut-être produiront-ils des preuves pour contredire ma version des faits, mais toute histoire présente de multiples faces. Lazar pensait simplement que les phénomènes de l’esprit étaient pareils aux autres – des phénomènes qui n’avaient rien d’inviolable et que nous ne devions pas renoncer prématurément à comprendre – même si une meilleure compréhension de leur essence était susceptible de troubler ce que nous considérions comme le pluspersonnel dans ce qui fait de nous les personnes que nous sommes persuadés d’être. Je me rappelle être allé avec lui dans une boutique crasseuse au fond d’une cour. L’homme qui tenait cette boutique avait une armoire remplie de souvenirs nazis. Il développait une mythologie originale et parfois extrêmement artificielle, construite à partir d’échafaudages sophistiqués. En vérité, presque toutes ses citations étaient apocryphes et n’apparaissent nulle part dans les textes originaux. Murs, sol, plafond. Autour de nous, tout était nazi. Et cet homme construisait des choses. Il avait un liquide qu’on pouvait se verser sur le corps et enflammer sans que la peau se mette à brûler.
Ce soir-là, Lazar a prié avec nous. Il avait dîné quelque part, pas en notre compagnie. À la fin du shabbat, je l’ai aperçu de nouveau, à l’écart, recueilli. Ses doigts s’étiraient de manière délicate, des cils étrangement longs donnaient à ses yeux une expression lointaine.
Les enjeux de cet interrogatoire tragique – dont les méandres et le caractère englobant évoqueront aussi la fabuleuse « Biographie comparée de Jorian Murgrave » d’Antoine Volodine – mobilisent nécessairement la bibliographie, dont les textes, loin d’être de simples enjolivures ou justifications, sont comme autant d’ergots et de goupilles indispensables au fonctionnement correct de cette serrure. Olivier Benyahya précise d’ailleurs, entre le texte et les sources, que (faut-il le croire ?) : « Lazar est composé pour partie d’emprunts. Le type de police, les parenthèses, tirets, guillemets, ne portent pas d’indication quant à la nature – empruntés ou non – des mots. Un certain nombre ont été modifiés. ». C’est ainsi que « La persécution et l’art d’écrire » de Leo Strauss, « Une terre et deux peuples » de Martin Buber, « Le juge et l’historien » de Carlo Ginzburg, « Mars » de Fritz Zorn, « Figures du Palestinien » d’Elias Sanbar, « Fêtes sanglantes et mauvais goût » deLester Bangs, « Le livre des violences » de William T. Vollmann, « Robert Musil. L’homme probable, le hasard, la moyenne et l’escargot de l’histoire » de Jacques Bouveresse, « Le cantique des quantiques »de Sven Ortoli et Jean-Pierre Pharabod, ou encore « Les penchants criminels de l’Europe démocratique » de Jean-Claude Milner, pour ne citer que quelques-unes des dizaines de sources ici assemblées, contribuent chacune à éclairer, expliquer, ou au contraire enfumer, une partie de la mécanique ondulatoire mise en œuvre dans « Lazar ».
Les ruptures de rythme et les scansions, les alternances entre incursions dans le passé des protagonistes et photographies arrachées aux dossiers à charge et à décharge, assorties de commentaires lapidaires ou potentiellement ésotériques, jouent également un rôle essentiel : dans cette forêt de symboles envahie par le storytelling qu’est devenue le langage, désormais soumis presque par essence à manipulation, la possibilité même d’une pensée et d’un jugement devient la seule illusion valant encore de se battre, peut-être. Et « Lazar » est ici un guide vertigineux et vital.
Le magistrat avait vu des choses durant sa marche de l’après-midi, et ces choses, telles que rapportées par le langage qu’il tentait d’assimiler à travers les exposés des commentateurs,ces choses n’étaient pas ces choses. L’ascenseur ne fonctionnait plus lorsqu’il était revenu chez lui, et il avait monté l’escalier à la hâte, sans prendre garde à une fenêtre ouverte dont le verre s’incrusta dans sa tête. Sur l’écran, le Ministre s’exprimait face à des journalistes. Ses traits, son expression, avaient gagné cette souplesse, cette « paix » qui n’appartient qu’à ceux chez qui le renoncement a été totalement métabolisé. Il faut toujours se garder de scruter le visage d’un homme en ayant fait à l’avance son procès. Assis devant l’écran, le Magistrat songea : le meurtre du langage. Il aurait pu, pensa-t-il, regarder vingt ou cent vidéos sur lesquelles le Ministre s’exprimait, et, c’était peut-être ce qui le troublait le plus, il ne trouvait pour ne pas juger cet homme que cette carapace que le Ministre s’était forgée – au prix de quels efforts ? – et qui ne laissait transparaître qu’une chose : le souci de ne rien dire qui puisse l’amener un jour à ne plus avoir sa place au sein du vide. Son évidage de la langue avait si bien fonctionné qu’il n’était plus possible de blâmer cet homme pour une seule conviction au cours de ses décennies au sommet de l’Etat : dans sa bouche, aucune conviction n’en était une à proprement parler. Une conviction, dans la bouche de cet homme, semblait être, précisément, une série de mots agencés de telle sorte qu’aucune réalité ne puisse y être associée, et, de ce fait, lui être imputée. Si les choses tournaient comme il l’avait escompté, cette série de mots serait revendiquée comme porteuse d’une vision. Si elles tournaient autrement, les mots n’auraient qu’à être entendus que comme ils avaient été prononcés, circonstanciels et aléatoires. Voilà comment le magistrat se figurait celui dont on retrouverait le corps sur la chaussée. Un homme qui avait consacré son existence à désarmer le langage.
Un excellent entretien avec l’auteur à propos de «Lazar» est disponible dans D-Fiction, ici.
Charybde 2
Pour acheter le livre, c’est ici.
Photo ® JewPop