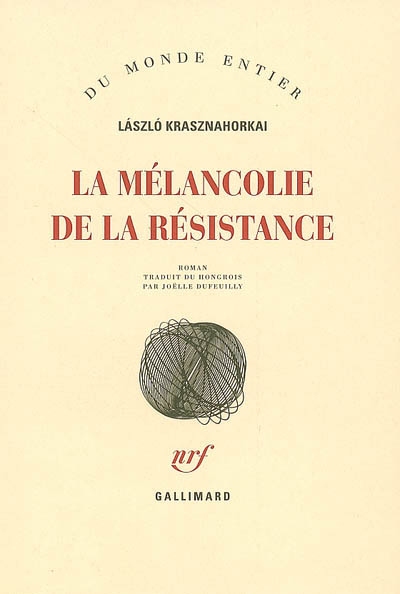László Krasznahorkai : la mélancolie de la résistance
Le sublime concerto quasiment fantastique d’une déliquescence hongroise ouvrant la voie à l’avidité opportuniste.
Publié en 1989, traduit en français en 2006 par Joëlle Dufeuilly chez Gallimard, le deuxième roman du Hongrois László Krasznahorkai, quatre ans après son très impressionnant « Tango de Satan », montrait avec éclat que le coup de maître initial de l’auteur ne devait rien au hasard éphémère. Ode redoutable et subtile à l’essence même de la déliquescence d’un monde, comme son prédécesseur mais par un canal bien distinct, « La mélancolie de la résistance » métaphorise les fins de règne, fins de système, fins d’époque en un concerto explosif pour instruments affûtés, dans lesquels les plus opportunistes et les plus retors des protagonistes gagnent, fatalement.
Dans cette petite ville provinciale de Hongrie, la partition – car, comme chez le Gabriel Josipovici de « Goldberg : Variations » (2002), la composition est ici avant tout musicale, boucles et volutes très précisément agencées pour un effet maximal – sera exécutée principalement par deux solistes, le musicologue obsessionnel qu’est M. Eszter et le curieux handicapé mental – mais l’est-il tant que cela ? – qu’est Valuska, l’ouverture et la conclusion étant confiée à la mère de ce dernier, Mme Pflaum, la maîtrise et l’orchestration de l’ensemble revenant à la femme du musicien, Mme Eszter, séparée de son mari depuis quelque temps au moment des faits.
Oui, tout cela aurait pu être un mauvais rêve, puisqu’elle, elle dont la vie était depuis de nombreuses années rythmée par les conserves en automne, le grand nettoyage au printemps, les travaux d’aiguille l’après-midi, et les joies et petits soucis occasionnés par sa passion des plantes, avait pris l’habitude d’observer avec la distance respectable de ce refuge la folie tourbillonnante du monde extérieur, un monde si étranger à cet univers intime qu’il n’apparaissait que sous forme de brumeuse incertitude, buée informe, et maintenant – alors qu’elle pouvait à nouveau respirer tranquillement derrière l’irréprochable rempart d’une porte verrouillée, comme ayant tourné la clé sur le monde – les horribles péripéties de son voyage perdaient peu à peu de leur vraisemblance, comme si un voile opaque s’était abaissé devant elle, et elle ne distinguait plus que très vaguement les grossiers voyageurs, le regard glacial de l’homme au manteau en drap, la paysanne qui s’affaissait, les ombres penchées au-dessus du malheureux qui se faisait frapper sans bruit dans la nuit, l’étrange cirque était devenu flou, comme les deux larges traits barrant la feuille jaunie de l’indicateur des trains, et encore plus floue était sa propre silhouette éperdue, déambulant comme dans un labyrinthe, pour rentrer chez elle.
White God
© Proton Cinema 2014/Sándor Fegyverneky
C’est Mme Pflaum qui ouvre ce sombre bal tragi-comique, c’est elle qui, revenant en train d’une visite familiale à la campagne, récapitule in petto, dans le wagon surchauffé où elle est soumise à une promiscuité intolérable avec de grossiers prolétaires avinés ou concupiscents, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va plus, tout ce qui se délite dans la ville et dans le pays, avant qu’elle ne puisse rejoindre le havre douillet et barricadé de son confort (tout petit) bourgeois, avant encore, hélas pour elle, d’y être dérangée, en véritable ouverture du roman, par la tornade Mme Eszter, maîtresse femme dont le parti pris de l’action et la vitesse de frappe ne cachent pas la redoutable habileté et l’extrême ambition, même si le mode de narration, tangentant par instants la farce, adopté pour elle par László Krasznahorkai peut un instant nous faire sous-estimer le personnage, ou le renvoyer à une insignifiante pacotille.
Les choses se passèrent et ne pouvaient que se passer autrement, car Mme Eszter savait pertinemment à qui elle avait affaire, c’est pourquoi elle, elle qui – comme son ami, le capitaine de gendarmerie, le lui susurrait à l’oreille chaque soir -, « rien que par son poids et sa hauteur faisait figure de géante… sans parler du reste », avec sa supériorité naturelle et son inébranlable détermination, n’eut aucune peine à écraser cette obstinée de Mme Pflaum ; après lui avoir proclamé d’une voix tonitruante de virilité, épicée de quelques ronflants « ma chérie », que certes, elle était parfaitement au courant de l’heure tardive mais qu’elle devait impérativement et immédiatement l’entretenir d’une « affaire privée ne souffrant aucun délai », elle profita de la stupéfaction prévisible de Mme Pflaum pour pousser celle-ci en même temps que la porte d’entrée, escalader les marches d’escalier puis, en penchant comme à son habitude la tête sur le côté (« je n’ai pas envie de me cogner quelque part… »), entrer par la porte restée ouverte dans le salon où, afin d’éviter d’aborder d’emblée l’objet pressant de sa visite, elle fit, après avoir d’un coup d’œil rapide – le temps d’accrocher son manteau – jaugé l’ensemble de l’ameublement, de plates observations sur l’ « exposition exceptionnelle » de l’appartement, sur l’ « intéressant motif » du tapis du vestibule et sur son « goût exquis digne d’envie », tout en se disant « quelle vulgarité ! ». Prétendre que « faire diversion » exprimât la véritable nature de ses intentions – à savoir : compte tenu de l’urgence de l’affaire, passer aujourd’hui un petit quart d’heure avec la mère de Valuska pour pouvoir le lendemain matin, si elle le rencontrait, mentionner cette visite – serait exagéré et, pour dire la vérité, n’importe quel sujet aurait fait l’affaire : elle ne choisit pas pour autant la facilité (c’est-à-dire : s’installer immédiatement sur l’un des immondes fauteuils et orienter la conversation sur la soif de renouveau général, perceptible à travers tout le pays, et, s’inscrivant dans ce contexte, sur l’énergie à tout rompre du Comité des Femmes de la ville et son enthousiasme débordant…) car, bien qu’elle s’y fût préparée, ce « sale petit nid » de veule conformisme, d’oisiveté suffocante, de sirupeuse fadeur la prit si violemment à la gorge que, tout en dissimulant adroitement sa répulsion, c’est avec la plus grande prudence qu’elle dut contrôler tout l’arsenal de son hôte.
Alors que la déliquescence omniprésente rôde sur la ville, où les ordures s’entassent sans plus guère de ramassage, où rôdent sans doute des dangers inexprimés, où l’ordre social se fait tremblant peu à peu, un cirque gentiment (mais en est-on sûr ?) improbable vient échouer là, prétendant exhiber sur la grand-place la « plus grosse baleine du monde », plus ou moins empaillée comme il se doit, mais provoquant peut-être, par sa seule irruption, la coagulation de bandes, vagabondes ou pauvres, de mauvais aloi en tout cas, qui envahissent à la tombée de la nuit les lieux publics dès lors dérobés à cette jouissance en bon père de famille qui semble à tout un chacun, partie prenante de l’ordre constitué, un objectif vital et digne.
Autour des prémices du chaos menaçant, qui s’amoncellent à présent à toute allure, c’est le complexe ballet élaboré entre M. Eszter, sagace et plus vif qu’il n’y paraît, mais perdu dans ses rêves musicaux, et le jeune Valuska qui nous permettra de participer à la véritable veillée d’armes, à l’explosion et aux retombées de cette bouffée de fièvre d’une société agonisante où, cependant, des places sont à prendre, des prébendes à obtenir, des avantages à empoigner, une fois la poussière et la peur retombées, pour les plus avides et les plus habiles – même s’ils demeurent, comme l’ensemble des protagonistes à part les deux « fous », désespérément et immuablement mesquins.
Il dut batailler, en raison de la foule se déversant par vagues successives vers la place du marché, pour faire le trajet aller retour de la gare jusqu’au centre de tri, contraint, pour éviter de heurter les passants sur l’étroit trottoir, de ralentir sans cesse son pas habitué à une vive cadence, mais il n’y prêta aucune attention, comme si battre le pavé au milieu de cette sombre marée humaine en songeant à quelque grandiose splendeur était la chose la plus naturelle au monde, et c’est à peine s’il remarqua cette soudaine et inhabituelle multitude tant il était absorbé par ce qui représentait pour lui un instant suprême, l’instant où le minuscule habitant de la terre qu’il était se tournait vers le soleil, et son exaltation était si intense que, en rejoignant enfin la bifurcation vers la place du marché (avec dans sa sacoche une cinquantaine de journaux de la veille car la presse du jour était encore restée bloquée Dieu sait où), il faillit hurler à tous ces hommes d’oublier un instant la baleine et de regarder le ciel…
Davantage encore peut-être que dans « Tango de Satan », László Krasznahorkai utilise ici toutes les ressources d’une langue bien à lui (que la traduction semble rendre avec justesse, autant que je puisse en juger ne connaissant pas le hongrois), construisant des phrases d’une longueur impressionnante, badines ou retorses, surinformatives ou noyant quelque poisson égaré, chaque fois que nécessaire – c’est-à-dire en permanence, pour rendre compte de ces flux sociaux simultanés renvoyant à une dissolution des liens collectifs, à un endormissement généralisé, à un embourgeoisement individualiste aux airs de terre promise, et à la folie opportuniste du pouvoir qui guette sur chaque barreau d’une échelle, dérisoire ou non, rythmée et scandée par les mots magiques de l’apparence démocratique et de l’avidité forcenée, détruisant tout sur leur passage après avoir instrumentalisé tout le reste.
Comme le premier roman de l’auteur, « La mélancolie de la résistance » a été adapté à l’écran par Béla Tarr sous le titre « Les harmonies Werckmeister » (son neuvième film, en 2001), dont les trente-neuf scènes en noir et blanc (seule la scène ferroviaire initiale a réellement disparu) correspondent plutôt fidèlement, semble-t-il, au découpage rigoureux des longues phrases de László Krasznahorkai.
Tous deux portaient de véritables vestes de gendarme ; sur le plus jeune, la veste traînait par terre, et sur l’autre, elle lui arrivait aux genoux, et si l’effet était assez comique puisque – comme dit l’expression – on aurait pu en mettre deux comme eux à l’intérieur, elles étaient si bien coupées, les proportions étaient si bien respectées qu’il ne leur restait plus qu’à grandir à l’intérieur. « Ah oui… ça alors… », remarqua-t-il admiratif avant de s’apprêter à sortir, mais le cadet sortit de derrière son dos une boîte et en l’observant à la dérobée lui dit : « Regarde ! » Il fut donc contraint de s’extasier devant une tige en fer biseautée qui servait, apprit-il, à « crever les yeux des ennemis », après quoi il dut admettre que la lame de rasoir suédoise était la meilleure pour « égorger l’ennemi », pour enfin concéder qu’il suffisait de mettre quelques éclats de verre broyés dans la boisson des ennemis pour les « liquider ».
En (c)ouverture, un photogramme du film "Damnation", de Bela Tarr
Ce qu’en dit Thierry Cecille dans le Matricule des Anges est ici, ce qu’en dit François Maillot sur le blog de La Procure est ici, ce qu’en dit Claire Devarrieux dans Libération est ici.
La Mélancolie de la résistance de László Krasznahorkai aux éditions Folio
Charybde2
Pour l'acheter c'est ici
White God © Proton Cinema 2014/Sándor Fegyverneky, film hongrois sur un soulèvement spartakiste des chiens esclaves contre leurs maîtres.