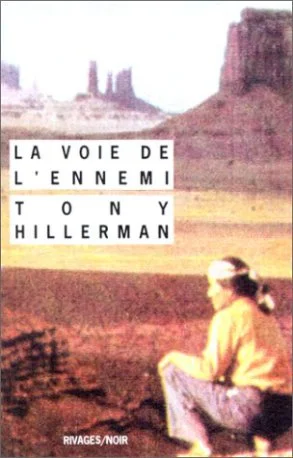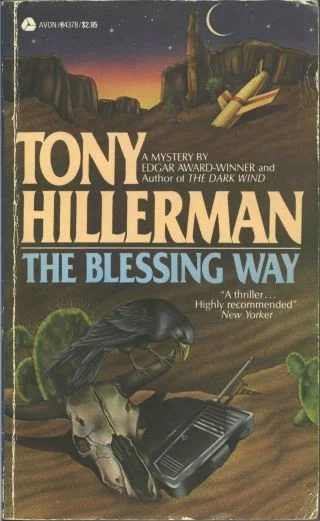Entrée en littérature noire du navajo Joe Leaphorn
Sorcellerie et avidité en pays navajo : la première enquête publiée de Joe Leaphorn.
Publié en 1970, traduit en français en 1990 chez Rivages par Daniel et Pierre Bondil, le premier roman de Tony Hillerman donnait le coup d’envoi, après quelques hésitations initiales (« The Fly on the Wall », publié l’année suivante, mettait en scène l’univers professionnel du journaliste politique que fut longtemps l’auteur, deux ans à peine avant le Watergate), à l’une des plus belles sagas littéraires contemporaines (d’après moi), mélange particulièrement réussi de narration, de polar et d’anthropologie, qui vaudra à son concepteur une reconnaissance mondiale, de nombreux prix nationaux et internationaux (notamment en France, son deuxième pays en nombre de lecteurs – ce qu’il mettra toujours résolument au crédit de son éditeur et de son traducteur français), et la reconnaissance éternelle de la nation Navajo.
Les dix-huit volumes écrits dans ce cadre par Tony Hillerman (depuis son décès en 2008, sa fille Anne a pris le relais avec déjà deux nouveaux volumes) prennent en effet pour décor principal la réserve navajo contemporaine, située dans les quarts nord-ouest de l’Arizona et nord-est du Nouveau-Mexique (avec une modeste excroissance en Utah, au niveau de la région des « Four Corners », chère à Edward Abbey, en y ajoutant, au Nouveau-Mexique, la portion séparée jadis appelée « Checkerboard Reservation »), et pour personnages principaux deux officiers de la Navajo Tribal Police, Joe Leaphorn, le plus âgé, et Jim Chee, le plus jeune, qui rejoindra le cycle après quelques volumes.
Il se glissa hors de sa paillasse, enfila son pantalon et sa chemise, se déplaçant silencieusement dans l’obscurité pour éviter de réveiller sa femme ainsi que ses deux fils qui dormaient de l’autre côté du hogan. Il évita leurs pieds avec ce soin inconscient qu’apportent les Navajos à ne pas enjamber un autre être humain, puis se pencha pour franchir la porte. Ses bottes, oubliées sous l’abri de broussailles, n’étaient que légèrement humides. Il les enfila tout en faisant chauffer de l’eau pour se préparer une tasse de café.
C’était un homme de petite taille au visage arrondi et au torse en forme de tonneau caractéristique du mélange sanguin navajo-pueblo ; il appartenait à un clan qui avait capturé jadis des jeunes femmes pueblos, et par là-même la structure osseuse plus courte et plus lourde des indiens Keres. Il versa le café dans une tasse et le but à petites gorgées tout en mangeant une tranche de mouton séché. La pluie avait été légère, une brève averse, mais c’était un bon présage.
Il savait que Ceux-qui-Appellent-les-Nuages avaient œuvré sur les réserves hopi et zuni et que, le long du Rio Grande, loin vers l’est, les indiens Pueblos exécutaient leurs danses de la pluie. La magie des habitants des pueblos avait toujours été forte, elle était plus ancienne que la médecine des Navajos et plus puissante. Il était un petit peu tôt pour cette première averse et Begay savait que c’était prometteur.
Il acheva son café avant de laisser ses pensées s’orienter vers la raison qu’il avait de se lever tôt. Dans quelques petites heures il allait voir sa fille, elle qu’il n’avait pas vue depuis l’été précédent. Il allait se rendre à l’arrêt du car de Ganado, le car s’arrêterait, il mettrait les valises de sa fille et ses paquets dans le pick-up truck et reviendrait avec elle au hogan. Elle resterait tout l’été avec eux. Begay avait délibérément repoussé le moment d’y penser parce que la Voie Navajo était la Voie du Milieu qui évitait tous les excès, même de joie. L’averse de minuit, l’odeur de la terre et la beauté du matin avaient été suffisants. Mais il y pensait maintenant en faisant démarrer son pick-up truck et en s’engageant en seconde sur la piste cahoteuse qui traversait la mesa. Et, tout en conduisant, il chantait un chant que son grand-oncle lui avait appris.
Tony Hillerman a bien souvent expliqué – et notamment dans le livre d’entretiens qui lui a été consacré par Ernie Bulow (« Talking Mysteries », 1991) – la dette formidable qu’il doit à Arthur Upfield, dont le détective Napoléon Bonaparte (sic), métis aborigène australien, fut confronté, de 1929 à 1964, à presque trente enquêtes jouant finement de l’écart entre la société australienne occidentalisée et le bush originel. Dans le décor exceptionnel de la réserve navajo et de ses abords, des principales bourgades que sont Shiprock, Window Rock ou Tuba City jusqu’aux confins les plus reculés, des bords du lac Powell et de la Monument Valley jusqu’au canyon de Chelly et aux sommets des grandes mesas, c’est bien cette confrontation entre un monde traditionnel qui disparaît – mais qui s’accroche aux éléments, aussi ténus soient-ils, dont il dispose – et un autre qui l’a vaincu, écrasé, et qui ne sait plus ou ne veut plus remédier aux dégâts causés, tant d’années après, que l’auteur va patiemment mettre en scène. Le constat de base est le même que celui dressé en 1968 par Edward Abbey au détour de son premier récit-essai, « Désert solitaire », mais Tony Hillerman ne développera jamais la rage et la gouaille du chantre rusé de l’éco-sabotage, lui préférant de loin les subtilités des rapports sociaux et personnels conduits à demi-mot, ou moins encore, par les tenants de la voie navajo.
Le corps gisait juste à côté de la piste et les phares éclairèrent d’abord la semelle des chaussures. Avant qu’il ne puisse s’arrêter, le camion était presque à sa hauteur. Joseph Begay passa au point mort et laissa le moteur tourner. Il déboutonna sa chemise et en sortit une petite bourse de cuir qui pendait à son cou par une lanière. La bourse contenait un petit morceau de silex noir ayant grossièrement la forme d’un ours et une trentaine de grammes de pollen jaune. Il plongea son pouce dans le pollen puis le frotta contre sa poitrine. Il entonna :
Partout où je vais, moi-même
Puissé-je avoir de la chance
Partout où mes proches parents vont
Puissent-ils avoir la chance avec eux.
Le fantôme était parti… au moins pour le moment. Il l’avait vu remonter Teastah Wash à tire-d’aile. Il mit pied à terre et se tint à côté du corps. C’était un homme jeune vêtu d’un jean et d’une chemise rouge, qui portait des chaussures de ville. Le corps était allongé sur le dos, les jambes légèrement écartées, le bras droit tendu, le gauche replié sur la poitrine avec le poignet et la main qui dépassaient de manière étrange dans leur rigidité. Il n’y avait pas de sang visible mais les vêtements étaient humides à cause de la pluie.
Tout en parcourant les quinze derniers mètres de la piste cahoteuse qui le séparaient de la grand-route, conduisant plus vite qu’il ne l’aurait dû, il se disait qu’il allait devoir signaler ce cadavre à la Loi et l’Ordre avant de se rendre à l’arrêt du car. Il essayait de ne pas penser à l’expression figée sur les traits de ce jeune homme, à ses yeux exorbités et à ses lèvres retroussées dans un rictus de terreur pure.
Canyon de Chelly (Edward S. Curtis, 1904)
Tout est loin d’être parfait chez Tony Hillerman, particulièrement dans ce premier roman. Comme beaucoup le lui ont fait remarquer, parfois cruellement, et comme il l’acceptait généralement avec bonhomie, ses connaissances anthropologiques concernant le peuple navajo étaient à l’époque encore relativement rudimentaires, et les petites erreurs abondent dans « La voie de l’ennemi ». Mais elles sont normalement invisibles au profane, et l’auteur s’est toujours défendu, à bon droit, de chercher à rédiger des traités savants. Sa construction narrative est alors encore hésitante, voire légèrement pataude : si dix-sept ans de journalisme donnent à ce débutant de 38 ans une réelle facilité pour enchâsser brillamment scènes et anecdotes dans son récit d’ensemble, l’intrigue flotte encore, et les coutures se voient par endroits. L’auteur racontera d’ailleurs sans fard (à nouveau dans « Talking Mysteries ») à quel point il ne sera jamais capable ni de « planifier » son scénario qui, même tard dans sa carrière, continuera à jaillir directement de l’écriture des trois ou quatre premiers chapitres, ni de réussir d’emblée son premier chapitre, qu’il sera toujours amené à réécrire et changer, encore et encore, jusqu’à six ou sept fois, sans que cette malédiction ne le lâche jamais. Le style lui-même a toujours eu ses détracteurs, lui reprochant souvent sa sécheresse parfois extrême. Ce point en revanche semble tout à fait volontaire : formé et déformé à la concision des articles toujours trop longs pour l’espace disponible, dans la presse, Tony Hillerman, qui, en dehors d’Arthur Upfield, a toujours professé sa profonde admiration pour Eric Ambler, pour Raymond Chandler et pour Graham Greene, revendique une écriture dépouillée : « Je me répète mille fois : si tu utilises un adverbe, c’est que tu n’as pas trouvé le bon verbe ; si tu utilises un adjectif, c’est que tu as besoin d’un nom différent ».
– Le capitaine veut savoir si vous pouvez passer prendre le coroner et donner le feu vert pour enlever le corps.
– Pourquoi ne s’en occupent-ils pas à la sous-agence de Chinle ? s’enquit Leaphorn. Ils sont cent cinquante kilomètres plus près.
– On l’a trouvé du côté de Ganado. Vous êtes censé prendre le coroner là-bas.
– Ganado ? répéta Leaphorn qui paraissait incrédule. De quoi est-il mort ? C’est un suicide ?
– Apparemment de cause naturelle. Excès d’alcool. Mais personne ne l’a encore regardé de près.
– Ganado, dit encore Leaphorn. Comment diable est-il descendu jusque là ?
Il fallait quarante-cinq minutes pour se rendre à Ganado et il les passa à ennuyer McKee en ressassant son erreur.
– Félicitations, lui dit celui-ci. Tu as quarante ans et tu viens de te tromper pour la première fois.
– Ce n’est pas ça. C’est juste que ça ne tient pas debout.
Dès « La voie de l’ennemi » (qui, au passage, était bien le titre original voulu par l’auteur, rétabli en français après que le premier éditeur américain ait insisté pour utiliser « La voie de la bénédiction », un autre rituel de soin navajo qui n’a rien à voir avec l’intrigue du roman), l’un des deux grands points forts de Tony Hillerman s’affirme nettement du côté de ses personnages : nourri de centaines d’observations recueillies au fil des milliers de kilomètres parcourus dans la Réserve, de rassemblement religieux en rodéo, de foire en rencontre sportive, l’auteur a accumulé un impressionnant matériau lui permettant de matérialiser très vite les protagonistes, même très secondaires, dont son intrigue et son atmosphère ont besoin ; pour les personnages principaux, s’ils sont encore relativement rudimentaires ici – malgré de grands traits spectaculaires, leur épaisseur va s’affirmer de roman en roman, créant sans doute l’une des plus durables empathies avec la lectrice ou le lecteur qu’une longue série policière soit parvenue à réaliser.
L’autre point fort indéniable de Tony Hillerman, dès ce premier roman, est son étonnante capacité à extraire toute une atmosphère de la description d’un « simple » paysage, sans jamais donner dans l’accumulation de matériel qui caractérisera souvent un Edward Abbey (à l’écriture par ailleurs sensiblement plus complexe). Il a confessé à plusieurs reprises que les nombreux arpentages de la Réserve, à pied ou en voiture, lui sont réellement indispensables, à chaque roman, pour s’imprégner encore et encore du caractère spécifique des lieux qu’il va mettre en scène, pour véhiculer, en quelques phrases, ce qui donne sa saveur particulière à telle ou telle mesa, à tel ou tel canyon, à un arroyo du bassin de la San Juan ou à un trading post du plateau de Kaibito.
C’est sans doute ce charme très spécial, transformant en permanence cette région désolée, pauvre et résolument peu hospitalière, en personnage à part entière qui explique la véritable passion créée en moi, dès 1990 et ce premier roman lu en français. S’il n’y avait ainsi eu le véritable plaisir d’une nouvelle relecture, cette note aurait sans doute dû se trouver dans la rubrique « Je me souviens » de ce blog, tant l’impact personnel du cycle « Navajo Police » a été important pour moi : c’est directement de là qu’est née l’envie de visiter cette région bien à part, et d’y retourner le plus régulièrement possible, même si c’est, à date, seulement pour un peu plus de trois semaines en cumulé, passées à fouler le sol du canyon de Chelly, à éprouver le vide ordinaire et pourtant si spécial de Tuba City, à emprunter quelque piste défoncée du côté de Mexican Hat, à regarder, l’œil (presque) humide, le poste de police de Shiprock, ou à supporter sans broncher le soleil écrasant de Monument Valley.
Il était facile de voir pourquoi Yazzie avait érigé son hogan à cet endroit. Derrière les habitations, les falaises de grès d’une butte se dressaient à l’à-pic au nord et à l’ouest : cent siècles d’éboulis à leur base puis une pierre rougeâtre, lisse et abrupte, avec des traînées aux endroits où la couleur était devenue sombre par suite du suintement des eaux, suivie d’une couche de perlite grise plus malléable, creusée et criblée de grottes et de cavités, coiffée tout au sommet par l’avancée en surplomb d’une roche ignée noire et dure. Cela offrait aux hogans un abri contre les vents de sud-ouest et de l’ombre contre le soleil de fin d’après-midi. Au nord et à l’est, le paysage était un enchevêtrement fabuleux de formes colossales érodées dominées par une autre butte imposante au sommet aplati. Toutes les couleurs du spectre sont là, pensa McKee. Toutes à l’exception du vert pur. Le peu d’herbe qu’il y avait était hors de vue, caché dans des replis où la terre pouvait s’amasser et retenir les racines, et où les eaux qui ruisselaient de cette immensité rocheuse pouvaient être retenues et absorbées. Il avait dépassé plusieurs de ces endroits herbeux en empruntant la piste à chariots qui menait jusqu’à ce lieu. Certains, avait-il remarqué, avaient été sérieusement broutés par les moutons. Mais pas la majorité. Yazzie avait dû ressentir une belle frayeur pour emmener son troupeau en tournant le dos à cette herbe.
Ce qu’en dit très justement Nébal sur son blog est ici. La remarquable analyse conduite, à propos de l’ensemble des premiers romans du cycle, par le blog Le Vent Sombre est ici.
Tony Hillerman La voie de l'ennemi éditions Rivages Noir
Coup de cœur de Charybde2
Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.