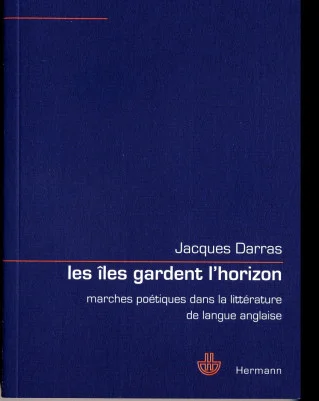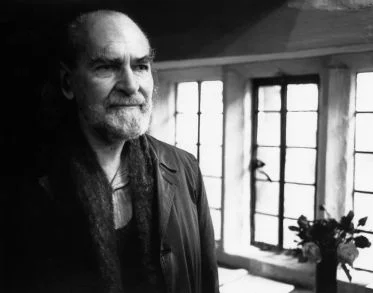Jacques Darras : les îles gardent l'horizon
Un exceptionnel parcours en écriture et poésie britanniques, du cœur caché îlien et écossais aux ramifications américaines.
Publié en 2006 aux éditions Hermann, cet essai (ou plutôt cette série d’essais) du poète Jacques Darras, acquis un peu par hasard, sur la foi de son titre, alors que je cherchais des textes parlant d’écriture aux confins océaniques européens, s’inscrit avec éclat parmi ces lumineuses révélations, peu fréquentes in fine, que sont les essais critiques écrits eux-mêmes avec une vive poésie (l’exemple central en étant pour moi celui du « Cannibale lecteur » de Claro).
L’auteur propose d’abord un robuste propos liminaire et une remarquable introduction intitulée « Sous l’invocation de Saint Valery », qui fait bien davantage qu’esquisser à la fois la résonance poétique personnelle, pour Jacques Darras, des auteurs qui vont apparaître ensuite, et la correspondance – et ses absences – entre lignes de force poétique britanniques, françaises et américaines.
Il consacre ensuite soixante pages à un passionnant parcours britannique intitulé « L’Angleterre à contre-courant », sous le signe de la relative méconnaissance qu’en conserve la critique française, même inspirée par ailleurs, en ancrant son parcours dans une histoire pas uniquement littéraire, où l’attitude face à la notion de révolution joue un rôle central. De Beowulf à Frankenstein, de J.R.R. Tolkien à John Donne, Jacques Darras nous éclaire de son écriture alerte et dense sur de nombreuses filiations plus ou moins dissimulées au sein du flot littéraire britannique.
ALIEN, TOLKIEN & Co
Le fantastique tient en effet de l’étranger neutre, alien, qui ne prend pas en compte le partage des sexes. Cela procède, d’ailleurs, d’un reliquat d’animisme comme de l’opération la plus abstraite. Lorsque l’expressionniste Kandinsky entame ses Compositions ou ses Improvisations, il articule à la fois la légèreté de l’abstrait et la force du neutre qui laissent le spectateur français sans mots et sans voix pour dire l’efficacité de sa démarche. Dans cet « autre » communiquent et s’échangent les ordres matériels et spirituels. L’hybride est alors incarnation de l’incertain que les philosophes de la transcendance projettent en âme du monde ou oversoul. Cette nomination du neutre dans la langue et par la langue, à laquelle les catégories féériques nordiques et celtiques prêtent toutes les tailles de corps d’elfes, de leprechauns, de nains ou de gremlins, comporte des vertus sémantiques de reproduction, de multiplication, d’hybridation et d’exploration. On ne doit pas s’étonner que le plus grand phénomène contemporain de la littérature anglaise, Tolkien, ait conçu une microcosmogonie héritière du merveilleux ancestral, des poèmes héroïques médiévaux, de la légende arthurienne, de l’ironie relativiste d’un Swift tout à la fois. Les composantes de l’imaginaire s’offrant, en Angleterre, dans la superposition et la continuité, conservent leurs vertus interagissantes. Point besoin, par conséquent, d’invoquer l’archaïque sous forme de la lenteur. L’Angleterre ne possède pas ce que procurerait aussi bien la Chine confucéenne, mais dispose au contraire d’une espèce de folie d’autant plus trompeuse qu’elle donne les apparences de la domesticité. Le fantastique, ainsi que le montre l’un des plus beaux et des plus denses textes de Freud (« L’inquiétante étrangeté »)), commence en effet aux seuils. Rien ne ferme jamais si étroitement dans l’hermétisme anglais qu’une invasion de signes ne puisse tout à coup faire exploser.
John Donne (1572-1631)
En une puissante incursion du côté des racines celtiques et des fusions intervenues jusqu’au XIXe siècle, il nous emmène ensuite, dans le même premier essai du recueil, visiter au pas de course et en beauté William Blake et William Shakespeare, méditer sur le rôle de la prairie, de l’herbe et du gazon avec Edmund Burke, William Wordsworth, et même Lewis Carroll., passer chez Horace Walpole, Evelyn Waugh (et ses prolongements chez Ivy Compton-Burnett), ou encore chez Mervyn Peake et Alan Silitoe (en un bref mais intense hommage, aussi, aux angry young men), avant de confronter et d’ajuster, choc magnifique, Malcolm Lowry et James Joyce., et de les faire subtilement résonner avec Joseph Conrad, Graham Greene, William Golding, Muriel Spark et John Le Carré. Cette « force dissidente du roman » conserve toute sa puissance en s’étendant à John Cowper Powys (les lignes consacrées par Jacques Darras à « Wolf Solent » sont ici éblouissantes), et en opérant un détour rusé par Salman Rushdie et par Jean Rhys, pour finir en une étonnante imbrication de l’ensemble dans le travail du poète contemporain Tony Harrison.
Les communautés gaéliques d’Irlande, d’Écosse ou du Pays de Galles n’ont pas su seulement se maintenir dans une « fixité » mythique, mais se sont servi des mythes mêmes pour se rétablir politiquement. Par une sorte de « grâce » historique, ces mythes se sont d’ailleurs étendus à l’ensemble de l’archipel britannique qui les adoptés et transmis au monde entier. Mythes de la quête du pouvoir, de la navigation dans les terres d’outre-monde, de l’affrontement du Bien et du Mal qu’il serait extrêmement naïf de prétendre confiner à l’usage de l’enfance.
(…)
Les vertus exploratrices du gothique moderne ont ceci de particulier chez Mervyn Peake qu’elles concilient le relativisme swiftien et l’imaginaire romantique. Titus voit dans la nuit, comme les Hobbits ou autre Wargs inventés par Tolkien. La société de l’anneau introduit l’homme à un espace qu’il ne peut plus éprouver par ses seuls sens. Il semble qu’en place du divorce consommé au tournant des dix-septième et dix-huitième siècles entre la lumière de Newton et la nuit puritaine de l’imaginaire, entre les cultures du jour et de l’obscur, Tolkien et Peake nous apprennent à voir dans la cécité même. L’appel au merveilleux n’est plus alors seulement recours à l’évasion mais propédeutique à des comportements nouveaux.
(…)
Une correspondance étonnante unit en effet les deux chefs d’œuvre que sont Under the Volcano et Finnegans Wake comme la christianisation rapprocha au septième siècle les populations celtes et anglo-saxonnes, chacune suivant le style de ses enluminures. On a très souvent comparé l’œuvre ultime de Joyce à l’écriture du livre de Kells, superbe exemplaire de l’art des volutes d’Iona. Finnegans Wake ne parle de rien d’autre que d’instabilité lui aussi, mais à la différence de Lowry, en parle dans l’épaisseur de la pâte linguistique. La phrase de Lowry découpe des unités sémantiques minimales qu’elle organise selon une syntaxe des pauses, des dépendances relatives et conjonctives. Tout cohère par attraction et répulsion, de sorte que la loi de physique magnétique qui préside à la structuration de ce monde est sans doute plus moderne, en dépit des apparences, que la grammaire agglutinative de Finnegans Wake.
Basil Bunting
Le deuxième essai, « Le poème vers le Nord et les Borders », en cinquante pages, s’ouvrant par un vertigineux « Petit exercice de vitesse poétique », qui introduit Philip Larkin, Basil Bunting, Geoffrey Hill, et enfin, l’un des grands préférés de l’auteur, l’Écossais Hugh MacDiarmid, et ses approches révolutionnaires du langage – et de la politique qui s’y dissimule si volontiers pour l’oreille et l’œil attentifs.
Participer de la pierre, de la mort qui est en la pierre en cette demeure de la sérénité suprême qu’est le désert, voilà ce que MacDiarmid établit avec la certitude rigoureuse, inébranlable des ermites irlandais du sixième siècle. La porte de l’espace s’ouvre avec lui sur une méditation de la limite, non plus du seul déplacement. Ici les voyages sont de l’esprit, dans la soumission humble et renouvelée aux choses et la transgression législatrice des frontières. Trouve-t-on ce poème trop rude, d’ailleurs, qu’on pourra fonde avec les neiges de Direadh III (1943) beaucoup plus tard et se précipiter torrent d’eau claire, d’eau cascadante et bouillonnante aux pentes des Cullins.
Poursuivant avec le Gallois David Jones et avec, plus proche de nous, Jeremy Prynne, puis, presque paradoxalement, Ted Hughes (l’époux de Sylvia Plath), Jacques Darras esquisse les contours d’une poésie des frontières maritimes et des audaces patientes, qui culmine peut-être, pour lui, avec les îles Orcades de George Mackay Brown (l’un des auteurs dont la poésie m’avait initialement porté vers ce recueil critique).
George Mackay Brown(Photo : Gordon Wright)
Ici, tout ou presque est réservé au silence, qui se confond avec la grande débauche d’espace inutile. Que peut-on dire qui importe, qui compte ? La communauté a ses rites, son pittoresque, sa langue dont les nouvelles et les romans traduisent la texture mais le poète est aussi celui dont la fenêtre regarde sur le large, sans crainte. Il est difficile, cependant de veiller la mer, d’inventer des berceuses qui l’endorment. On ne parle sans doute le mieux d’elle qu’avec des rochers, des amers. Les poèmes de Mackay Brown sont des pierres levées, jointes maladroitement, en apparence, l’une à l’autre. La vie moyenne d’un homme ne compte pas plus de cinq pierres, cinq vers qui la résument :
Il est rentré de la ville
Avec la nouvelle
Qu’on se battait en Russie
Des espèces de patates rouges
Des lunettes à deux sous –
Il avait des yeux gros comme ceux d’un bœuf.
Le Japon n’est désormais plus très loin dirait Kenneth White mais ce haïku nordique de Mackay Brown recèle une sérénité ironiquement gagnée sur l’information qu’elle comporte.
Ce deuxième essai approfondit aussi énormément les esquisses que comportait le premier quant aux écritures des Borders, en consacrant quinze pages décisives à David Jones, et quinze autres de la même densité à Basil Bunting.
Je me faisais cette réflexion l’autre semaine à Londres, vaquant sur les traces de David Jones et vérifiant en somme ce que la fréquentation, déjà, de Basil Bunting et de son œuvre précédemmenttraduite, dans la même collection, m’avaient enseigné. Certes, Basil, si longtemps hors d’Angleterre et qui n’avait regagné ses latitudes Nord au déclin de son âge que pour mieux moquer les Sudistes ou Southrons, avait lui-même mis son point d’honneur à marquer ses distances. L’Angleterre, pardon, la Grande-Bretagne se découpe en effet suivant un réseau d’invisibles parallèles qui font comme un escalier géographique et spirituel. N’y montent que les courages bien trempés, les amateurs de murs romains, les géologues ou alpinistes qui rêvent un jour de se retrouver sur le toit de l’Everest, les scotophiles monomaniaques, les tasteurs de whisky par la racine, bref, en un seul mot : les poètes. Tenir là-haut, sur une pente, pendant les mois d’hiver, dans le moutonnement sombre des collines et le blanc de zinc des nuages, requiert un sens de la solitude assez aiguisé, quasiment militaire pour tout dire. La poésie de langue anglaise est faite de cet affrontement par celtisme interposé avec les éléments simples. Le roi Lear sur sa lande, depuis toujours, propose le modèle archétypal, poète-roi régnant à Londres, de loin, par une sorte de royauté mythique qui est comme le double de l’autre, l’officielle, faite au contraire de confort et de domesticité hanovrienne-saxonne reposée. Il sera à ce titre intéressant de suivre la gloire posthume des deux poètes Seamus Heaney, l’Irlandais, et Ted Hughes, le lauréat des confins et des moors. Sans doute, leur temps de servitude arthurienne écoulé, regagneront-ils les ombres de leur peuple, s’éloignant d’autant du centre qui gère subtilement les légendes.
Isbister, Whalsay, îles Shetland
Le troisième essai, « Paysages celtes », constituerait quasiment à lui seul une bonne raison de plonger dans ce recueil, avec cette visite poétique âpre et enchantée des îles écossaises, du nord comme de l’ouest.
La géographie passe pour être une science exacte et l’est assurément tant qu’elle se maintient sur la terre ferme. Quand elle arrive au bord de la mer et contemple le large, son assurance change. La mutabilité de l’eau n’est pas seule en cause, la géographie ayant depuis longtemps appris à avoir le pied marin. Non, ce qui la bat en brèche, ce sont les îles. Son pouvoir de dénombrer vacille à leur contact. Et là où la science balbutie, reviennent indéfectiblement le mythe et la légende. (…) Les îles se tiennent à l’horizon. Les îles gardent notre horizon. Et c’est par l’horizon des îles que l’Écosse s’aborde. Toujours au fond du paysage se dessine tel contour, telle forme de puy aux pentes vertes, tel profil de cimes bleutées. Et l’on ne sait jamais, tant que la route n’aura pas conduit jusqu’au pied de ce puy, de cette cime, de ce contour, si la réalité géographique était encore du continent ou bien de la haute mer, s’il n’y avait pas quelque détroit secret, quelque goulet de sable blanc et de vagues courtes pour l’en détacher de la terre. (…) La poésie est naturelle dans cet espace auquel elle est congénitale. Seul mode d’appropriation d’un lieu qui ne se donne qu’en se dérobant, elle crée un lien souple, rythmé, empruntant au clapot de la mer en même temps qu’à la rugosité des montagnes. Gneiss et eau, granite et machait, pluie et feu. Rien n’est plus déstabilisant que d’aborder sur cette plate-forme des lointains, Uist par exemple, où le cheminement des vagues se prolonge parfois par l’écho intime, proche, imprégnant, d’un loch dans la bruyère, de sorte que l’on se prend à rêver de légendes d’îles balayées par une vague un peu plus forte.
North Uist, Hébrides extérieures
C’est par un détour rare par la fort méconnue poésie de Walter Scott, et par l’ancrage écossais d’Herman Melville, que Jacques Darras nous propose de l’accompagner ce périple multiple et archipélagique. Sur le chemin liquide, la lectrice ou le lecteur croiseront aussi Jules Verne et son rayon vert, prendront le temps de mieux saisir la beauté à facettes de Hugh MacDiarmid, beaucoup plus en détail que dans le deuxième essai, et de la comparer à celle de Sorley MacLean, l’autre héraut retenu ici par l’auteur.
C’est pourquoi de tous les grands poètes du vingtième siècle,, Hugh MacDiarmid est sans conteste l’un des plus estimables. L’homme frappe par l’angularité de son parcours. Engagements puis ruptures, dans la vie affective personnelle comme dans les contrats politiques, jalonnent sa route. La philosophie qu’il en donna dans son plus étonnant poème, L’Homme ivre regarde le chardon (A Drunkman Looks at the Thistle) porte le nom barbare d’antisyzygy, c’est-à-dire une danse dialectique où sont co-présents les contraires. Au siècle des totalitarismes, on ne pouvait concevoir vision plus ample du pacte démocratique. Car si MacDiarmid porte au fond de lui l’héritage révolutionnaire d’un Robert Burns avec son impatience des conventions politiques et religieuses, il n’est pas moins l’héritier des dissidents puritains, ces « non-conformistes » qui ne cessaient d’interroger la Bible et le Ciel pour connaître leur destin. Par son histoire, l’Écosse est individualiste jusqu’à l’anarchisme, tout au moins farouchement anti-catholique. Marie Stuart, c’est-à-dire Marie de Guise, en sut quelque chose qui croyait trouver un appui solidaire contre la reine Élisabeth parmi ses sujets. Dans cette alliance des contraires – cette antisyzygie – il n’y a pas place pour une souveraineté traditionnelle. Au fond de son ivresse pleinement due au whisky, le héros de MacDiarmid rejoint l’ivresse métaphysique et les spéculations les plus tourbillonnantes. Rien de semblable ni d’approchant dans la sage poésie anglaise. Il faut cheminer jusqu’aux landes de King Lear pour trouver dans la personne du vieux souverain gallois un délire aussi vertigineux que celui de l’Écossais. Cela explique sans doute pourquoi ce poème de près de quatre-vingt pages, dont le rythme change sans cesse d’allure, dont la langue passe tour à tour de l’apostrophe alcoolisée à la prose la plus lucide puis au lyrisme le plus tendre, est resté inexploité et inexploré par la tradition britannique contemporaine. Comparez cette écriture avec celle de T.S. Eliot ou de W.H. Auden ! Une fois que vous aurez franchi l’enchardonnement de la langue dialectale, vous vous retrouverez en paysage totalement inconnu. L’Homme ivre est une espèce de saga norvégienne d’un seul, Eric le Rouge attardé qui aurait manqué les côtes du Vinland – l’Amérique – pour continuer dans une navigation boréale au-delà des frontières humaines connues.
Hugh MacDiarmid
Le dernier essai explore d’autres côtes, bien réelles ou extrêmement métaphoriques, en franchissant d’un bond, audacieux mais logique, l’Atlantique, à la découverte d’un autre rivage d’où nous démarrons avec Henry Thoreau, le romantisme et le transcendantalisme, pour évoquer ensuite fort logiquement Walt Whitman et T.S. Eliot, saisit toute la puissance déterminante pour l’ensemble du champ de William Carlos Williams, tenter patiemment de détourer l’énigme tragique que constitue à bien des égards Ezra Pound, pour aborder ensuite les rivages à la fois plus sereins et pourtant subtilement chaotiques de Wallace Stevens, de Gertrude Stein, de Charles Olson (dont l’ombre hante de plus d’une manière le Gloucester de « En pleine tempête »), de Louis Zukofsky, de Lorine Niedecker, de Laura Riding, de Robert Creeley, de Sylvia Plath, et enfin de David Antin.
Trois cent pages pour un voyage extraordinaire, dense et alerte, à la fois extrêmement documenté et parfaitement fluide, réussissant cette prouesse rare, tout de même, de toucher du doigt une authentique écriture poétique tout en nous entretenant d’autres auteurs, des liens qui les assemblent dans la complexe toile du réel et de l’imaginaire qui le soutient, nécessairement. Et qui donne envie illico de découvrir et lire bon nombre de ces poètes jusqu’alors inconnus, en ce qui me concerne en tout cas.
Jacques Darras
Les îles gardent l’horizon – Marches poétiques dans la littérature de langue anglaise de Jacques Darras aux éditions Hermann
Charybde2
Hugues Robert/Charybde 2 organise des rencontres de lecteurs avec les écrivains, lit sans cesse et trouve le temps d'écrire des merveilleuses chroniques (parfois de dix feuillets !) pour faire partager ses coups de coeur. On ne sait pas comment il peut arriver à faire aussi bien tout ça, mais nous sommes ravis de laisser des libraires, des éditeurs et des écrivains exprimer comme ils l'entendent dans nos pages leur passion pour la littérature - cela nous change des critiques de profession, et c'est un choix que nous avons fait consciemment. Vous pouvez le retrouver ainsi que ses collègues sur le net à l'adresse Charybde 27 : le Blog ou dans la vraie vie à la Librairie Charybde, 129 rue de Charenton 75012 Paris.