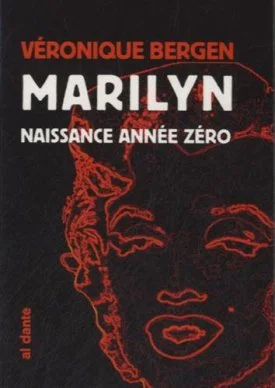Marilyn is a bad bad girl, even naughty !
La vie de Marilyn Monroe en cauchemar lubrique américain. Somptueux tours et détours d’une autre mauvaise fille.
La vie n’est qu’une question de portes à franchir. Chacun a la sienne. Dans la loterie complète des arrivées sur terre, certains la trouvent grande ouverte à leur naissance. D’autres sont condamnés à s’embourber dans un dédale de portes dérobées, de passages impraticables.
Publié en 2014 chez Al Dante, le neuvième roman de Véronique Bergen réussit le tour de force de proposer une lecture résolument originale, et d’une rare puissance, d’une icône de la mythologie contemporaine pourtant copieusement intégrée par la littérature, à savoir Marilyn Monroe.
Pour réussir ce qui prend vite l’allure d’un véritable tour de force, décisif sur un terrain en apparence aussi encombré, l’auteure confie chaque chapitre à une narratrice ou à un narrateur différents (en y incluant éventuellement les plus improbables, depuis les doubles personnalités de l’héroïne, jusqu’à son chien ou sa peluche, en sus des grands témoins « officiels »), dont les monologues intérieurs oppressants, obsessionnels, focalisés ou dérivants, rythment ce vrai-faux documentaire halluciné de leurs cuts, de leurs flash-backs, de leurs affirmations, de leurs spéculations et de leurs délires.
Je recherche des noyades qui s’enchaînent et se combinent jusqu’au paroxysme. Couler à pic dans des flots de Dom Pérignon ne me suffit pas. Je pose Ulysse sur la moquette et l’ouvre au hasard, je relève mes cheveux en chignon pour me préparer au plongeon. C’est entre les jambes de Molly Bloom que je veux atterrir. Avec mes lèvres, je tourne les dernières pages, mélange ma salive au grand fleuve de mots que lâche Molly Bloom. Je demande l’hospitalité à Joyce. Pour m’allonger entre ses mots, je dois trouver l’endroit où me glisser. Là où le monologue de Molly tourne fou, là où il piétine Dieu, j’ai une chance de m’infiltrer. Après le mot « chien », je tente de passer mon corps en contrebande mais je suis rejetée. Avant de relire la phrase, je l’embrasse en fermant les yeux, déposant un baiser blond sur chaque mot, ça vaudrait mieux qu’il me le mette dedans par derrière comme Mme Mastiansky me racontait que son mari lui faisait faire comme les chiens et de tirer la langue tant qu’elle pouvait. La fabuleuse orgie de mots sans ponctuation m’a avalée. Un tambourinement timide contre la porte d’entrée. Comment expliquer à Milton Greene que Marilyn ne peut s’extraire de la bouche de Molly Bloom qui crache des bans de mots aquatiques ? Comment lui dire que Marilyn est vingt mille lieues sous la ligne des flots écumeux du champagne ? Comment éviter que mon sexe crie « daddy, daddy » alors que mes lèvres sont cadenassées infibulation orthobuccale ?
Marilyn en 1955, un exégète anonyme de l’avènement du cinéma parlant en 1927 (un an après la naissance de Marilyn), Charlie Chaplin Jr en 1962, le photographe David Conover en 1946, son tout premier chien Tippy (particulièrement prolixe, ici) en 1933, Marilyn à nouveau (alternant presque stroboscopiquement avec Norma Jeane, son double historique et schizoïde) en 1961, le photographe Milton Greene en 1957, Marilyn en 1962 (intervenant depuis cette année fatidique, celle de sa mort, elle prendra 7 fois la parole tout au long de l’ouvrage), Howard Hughes en 1975, Anna Freud en 1956, Norma Jeane (l’alter ego dissimulé dans les plis du rêve) en 1959, Marilyn en 1960, Lee Strasberg en 1957, le père non nommé de l’actrice en 1959, Marilyn en 1958, la psychanalyste Marianne Kris en 1961, Charles Stanley Gifford (reconnu avec une quasi-certitude comme le véritable père de l’actrice) en 1961, Martin Edward Mortenson (le père figurant sur le certificat de naissance de Marilyn) en 1960, Grace McKee (la tutrice légale de Marilyn à partir de 1936) en 1951, le maquilleur de stars Allan « Whitey » Snyder en 1962, le mafieux Sam Giancana en 1962 (qui interviendra une deuxième fois, semble-t-il, presque à la fin du livre), les drogues (prenant la parole collectivement) au XXIe siècle, un observateur anonyme et fort bien informé de la Maison Blanche en 1961, Gladys la mère de Marilyn en 1963, J. Edgar Hoover (fort de ses 48 ans à la tête du FBI) en 1970, John Fiztgerald Kennedy en 1963, la Mort elle-même en 1962, Marilyn en 1954, le docteur Ralph Greenson en 1962, Evelyn Moriarty (la principale doublure de Marilyn au cinéma) en 1962, Eunice Murray (l’ultime gouvernante et infirmière de l’actrice) en 1962 qui reprendra le texte dans les dernières pages aussi, Norma Jeane en 1960, Bobby Kennedy en 1962, un observateur inconnu auprès d’Agnes Flanagan (la coiffeuse de Marilyn) en 1962, un tueur anonyme des services spéciaux en 1962, le sergent de police Jack Clemmons en 1962, le chien Maf (qui eut droit à sa propre biographie, « Vie et opinions de Maf le chien et de son amie Marilyn Monroe », par Andrew O’Hagan en 2010) en 1962, la peluche de tigre offerte à l’actrice quelque jours avant sa mort en 1962, et Norma Jeane en 1962, enfin : Véronique Bergen a ainsi convoqué 39 protagonistes spatio-temporels de toutes natures pour élaborer cette incroyable polyphonie d’une véloce crudité, entre données biographiques (qui continuent à se compléter et s’amender de nos jours) et facettes devenues légendaires et mythologiques depuis bien des années.
En 1946, au moment de son premier contrat avec la Fox.
Les rêves ne croissent bien que dans les déserts. Sur les montagnes de Los Angeles, une poignée d’immigrants érige la tour de Babel des songes. Au milieu des coyotes et des couleuvres, des hyènes et des charognards, ils lâchent des animaux fabuleux, des images animées qui courent à la vitesse de la lumière. À l’emplacement du village indien de Cahuenga, sur les tribus d’esprits morts, ils fondent l’empire onirique d’Hollywood, baraquements de fortune, campements de zinc et de tôle, tout un décor de carton-pâte. Art de la lumière, le cinéma a besoin de l’aveuglant soleil de la côte Ouest. Pour que naisse l’industrie du rêve, que l’autre monde voie le jour, rien de tel que ce ciel obstinément bleu qui descend sur la terre, ce sable californien qui monte au ciel.
Si Véronique Bergen développe bien tout au long de ces 290 pages éruptives un fil conducteur lié aux racines du cinéma et du divertissement de masse, que ne renierait sûrement pas l’Éric Vuillard de « Tristesse de la terre », c’est toutefois bien en un lieu miné et dangereux, quelque part à mi-distance du James Ellroy du « Quatuor de Los Angeles » ou d’ « American Tabloid », de ses complots glauques et de ses névroses fondamentales, et du Mathieu Larnaudie de l’excellent « Notre désir est sans remède », de sa pudeur paradoxale et de son constat terrible sur ce qui gît au fond d’une société, incarné dans sa psychiatrie et dans son sens avide de l’amusement.
En mai 1962, pour son « Happy Birtday Mr. President » au Madison Square Garden.
Sur les terres arides, sur les cendres des Indiens décimés, on tourne des westerns épiques, des comédies à l’eau de rose, des drames burlesques. Se glissant dans les cerveaux, les caméras filment des pensées rocheuses, des pensées mustangs qui filent comme des nuages. La loi théâtrale des enchaînements de scènes vole en éclats, la grammaire des gestes et des conflits, le fil rouge de la chronologie sont percutés par le flash-back, le hors-champ et la voix off, le cinéma libère les fauves qui sommeillent, le cinéma ouvre les boîtes crâniennes, descelle les boîtes de Pandore qui déversent un mélange de guimauve et de venin. La cité de la fête et du crime veut des morts-vivants, des vedettes eucharistiques qu’on immole au Minotaure, des bimbos écervelées, des gominés ténébreux, des rebelles dociles qu’on vampirise à petits feux. Le sang passé au noir de l’excès est d’une élégance folle, rien ne sert d’exister si l’on ne joue pas sa vie à la roulette russe, c’est ce que crient HOLLYWOOD, les neuf lettres immenses qui composent le panneau de pacotille juché sur une colline. Les rôles à distribuer sont limités, il arrive que tout cafouille, que le farouche cow-boy se rêve en blonde idiote tandis que les poupées de celluloïd ont l’âme d’Al Capone et la dégaine de chefs de gang. Il arrive que des starlettes déçues, des prétendants au sacre, des acteurs éconduits, des génies méconnus se hissent sur l’une des lettres du panneau et se jettent dans le vide, maudissant la ville des anges, s’écrasant sans bruit sur une terre habituée à recevoir son lot annuel de suicidés.
Photographiée par Ben Ross en 1953.
Entre polyphonie mortelle et sublime cacophonie, « Marilyn Naissance année zéro », bourré de sexe et de drogues jusqu’aux racines des cheveux blond platine, violent et désespéré, offrant ses bribes hachées et nécessairement mensongères, utilise toutes les ressources des innombrables biographies (certaines très récentes) de la star décédée si mystérieusement, si stupidement ou si tristement dans la nuit du 4 au 5 août 1962, et ne cherche surtout pas à démêler l’avéré du légendaire, mais bien à jeter à la face de la lectrice ou du lecteur le cauchemar nu, brut, sanglant et cru qui vibre sous le strass et les paillettes, sous le glamour forcené et sous la consommation de rêve, sur grand écran ou par voie intraveineuse.
Devant des fuselages d’avion, sur les routes de la Californie, je traque ses secrets, ses parades animales. Sa peau est si fine que la lumière s’y accroche, que sa fragilité passe au travers. Il suffit de mettre le commutateur su « on », d’enfiler clic et reclic pour que Norma Jeane dégage au quart de tour des vibrations sexuelles. Mon Canon braqué sur ses cuisses nues, je suis le chasseur qui lui donne vie. Les paquets de photons que libère l’appareil courent vers mon amante, s’engageant dans un cordon ombilical invisible qui la transfigure en déesse. Mais rien de magique ne se passerait sans le mouvement en sens inverse : de sa chair auréolée d’un halo s’échappent des grains de lumière, un chant d’érotisme que je recueille dans mon boîtier. C’est plus que de la photogénie, c’est une recherche éperdue, une course à travers les images, une façon de ne pas sombrer. L’été 1945, à Death Valley, à Riverside, elle irradie bombe atomique, électrochocs de volupté, elle me jette au visage son corps ouvert, prêt à servir, à être immolé, elle viole l’objectif autant que ce dernier la saute, la pénètre. Consciente de l’impact esthétique de chacune de ses mimiques, de chacune de ses expressions, ma petite ouvrière calcule tout, contrôle tout. Mais ma Baby Blue désaxe ses poses par ses fêlures, un tremblé monte dans l’image, casse le figé, Norma Jeane se retire au sommet de son offrande. Les hommes voient la pute lascive. Son corps pulpeux, ses spasmes d’enfant brillent comme un immense clitoris. Les hommes tapissent leur cervelle de la nouvelle bombe, une vamp encore un peu gauche venue du cloaque de l’Amérique, une Cosette trouvée sur un rayon de Prisunic. Ils ne voient pas la biche aux abois, la sauvagerie de Mowgli dans la playmate qui me déboutonne le pantalon et sort mon membre que ses lèvres brillant d’un rouge sombre avalent, ils ne voient pas les pupilles dilatées d’effroi de la créature haletante qui m’enfourche en bredouillant « papa ».
Sans photos, Norma Jeane est comme une fleur privée d’eau. Perdant l’existence, elle retourne à l’anonymat du tombeau, attendant que l’appareil vienne la déterrer, la somme d’irradier, lui enjoigne d’exhiber sa nudité, son mirage. Amputée du regard des autres, sans la sensation d’être l’objet de tous les désirs, sans la vibration de son corps mordu par la libido de ses admirateurs, elle coule, pantin crevassé, dans le no man’s land des non humains. En deuil d’elle-même.
Ce qui transmute ce texte et le porte au plus haut, c’est néanmoins sa langue, rare. Brutale et torturée, lucide et implacable, rêveuse ou animale, dans l’urgence des ses besoins vitaux et de ses illusions tragiques, celle-ci donne au texte un souffle pénétrant, au sein duquel l’intime et le politique fusionnent en complet et magnifique désespoir.
Marilyn naissance année zéro de Véronique Bergen, éditions Al Dante
Charybde2
l'acheter chez Charybde, ici
Véronique Bergen
Philippe Halsman pour Life