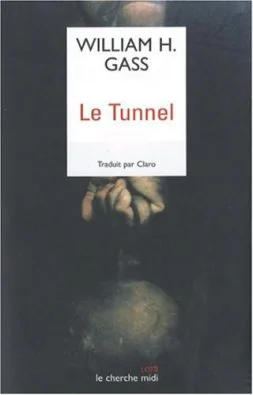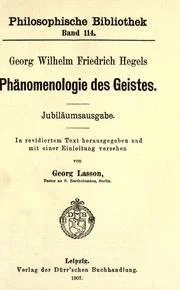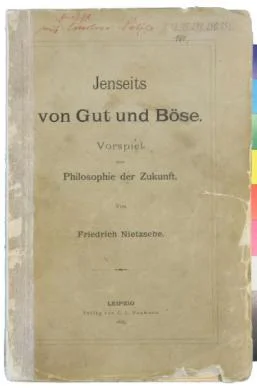Le Tunnel de William H. Gass, noir comme notre époque.
Un professeur d'université creuse un tunnel qui ne vise à déboucher nulle part, mais seulement à descendre toujours plus bas. "Le Tunnel" (1995) est le dernier grand roman du vingtième siècle. A découvrir d'urgence pour comprendre notre époque où les ténèbres se rassemblent.
Le narrateur de ce chef-d’œuvre monstrueux que William Gass mit une trentaine d’années à écrire est William F. Kohler, un universitaire de cinquante ans, un professeur d’histoire qui n’a plus qu’à rédiger l’introduction du livre de sa vie intitulé Culpabilité et innocence dans l’Allemagne de Hitler. Au lieu d’achever son livre, Kohler écrit ses pensées, ses souvenirs d’enfance, évoque sa famille, ses collègues et mille et un autres sujets tout en se mettant à creuser en secret un tunnel dans sa cave, tunnel qui ne doit déboucher nulle part, qui cherche au contraire à s’enfoncer le plus profondément possible dans les entrailles de la terre. Les deux activités sont intimement liées. Ce tunnel s’enfonce dans les méandres de l’âme humaine. Et le fond de l’âme sent la merde. On y trouve la haine, la concupiscence, la douleur, la mesquinerie, etc. Alors si les discours entremêlés de Kohler (qui sont autant de galeries) sont souvent sordides, c’est parce qu’ils se veulent sincères. La sincérité est le fil conducteur, le fil d’Ariane de Kohler qui, tel Thésée, va affronter le Minotaure qui est tapi en chacun de nous, au plus profond de notre être, dans le labyrinthe de nos pensées intimes. La sincérité est d’ailleurs le premier grand thème abordé par Kohler. Si on veut de la sincérité, il faut se débarrasser de tout académisme. La vérité est « fourbe et malsaine », son expression doit donc l’être tout autant. A la cruauté de l’âme doit correspondre une crudité du langage. Pendant cet « interminable hiver de merde pareil à de la neige fondue suintant d’un anus de glace », Kohler crucifie la langue afin de sauver la sincérité, dans toute sa laideur et toute sa vulgarité :
et chacun sait que dans le monde couramment chaotique du langage il est souvent plus facile d’avouer un crime capital, du moment que les verbes chantent et que les noms résonnent, que d’avouer que l’on prend plaisir à se branler dans une bouteille.
Tous les propos de Kohler consistent à tendre vers ce maximum de sincérité, à creuser encore et encore afin de s’en rapprocher le plus possible. Un voyage au bout de la nuit de la sincérité. Il faut creuser, creuser encore, ne pas se contenter de la surface des choses, même si ce que l’on finit par découvrir n’est guère réjouissant :
Ne regardez jamais sous la surface de la vie, parce que sous la surface dans le vie vous ne trouverez pas de jolis bancs de poissons agiles, d’algues se balançant, […], au son d’une musique aquatique, ni même de cigale quelque part dans leur sommeil de sept ans, ou des taupes creusant obstinément leurs gouleyantes galeries ; sous la surface de la vie se trouve la fosse, l’abîme, l’horrible vérité, une vérité avec laquelle on ne peut pas vivre, qu’on ne peut supporter : l’inutilité humaine, notre inutilité, la vôtre, la mienne.
Kohler déteste Hegel. Il a raison. Le but de Hegel est de montrer que l’histoire a un sens, qu’elle est la manifestation progressive de ce qu’il appelle l’Esprit ou la Raison, l’Universel. L’Esprit se réalise peu à peu, de manière dialectique et lorsqu’il finira par se concrétiser, ce sera la fin de l’histoire, le règne du Bien, du Droit, de la Justice. La philosophie de l’histoire de Hegel est une théodicée rationaliste. Selon Hegel, ce sont les grands hommes qui, sans le savoir, permettent la réalisation de la Raison dans l’histoire. La pensée de Hegel est symptomatique de l’insupportable déréliction de l’homme qui ne peut vivre sans sens, qui ne peut accepter l’essentielle absurdité des choses. Kohler a une vision “tragique” de l’histoire, pour lui l’histoire n’a aucun sens et les grands hommes ne sont que les pantins de l’irrationnel. Cette conception an-archiste des choses, Kohler la tient de son maître Magus Tabor, surnommé, en hommage au tableau de Bruegel, Margot la Folle. Celui-ci lui enseignait que tant que l’humanité sera animée par « la vérole de la religion », « la MST de la foi », « la chtouille du commerce », le monde serait un enfer :
Il n’y a pas de fin à la bêtise humaine, Kohler, pas de fin, pas de fin ; nos cœurs noirs sont sans fond, et il n’y a littéralement pas de fin ; il n’y aura pas de fin jusqu’à ce que nous disparaissions tous, et que l’humanité s’élimine elle-même dans un accès de justes déserts.
L’histoire est le symptôme de la bêtise humaine. La Margot de Bruegel, armée de sa batterie de cuisine et de son épée, son trésor sous le bras, règne sur le monde : nulle trace de sens, partout le chaos. Et c’est parce qu’il applique cette conception des choses à la seconde guerre mondiale que Kohler sait que son livre ne sera pas compris, que « des milliers de juifs seront outrés. Quelques-uns, non. » En outre, Kohler qui en a marre des historiens en empathie avec les victimes décide de se mettre à la place des bourreaux, de les comprendre :
il est facile d’être une victime, vous n’avez rien à faire, il suffit de pleurer et de saigner – mais, ah, le tortionnaire, être le tortionnaire n’est pas un rôle dont la facile maîtrise est aisément admissible.
L’objectif de son livre est de montrer que la responsabilité de la Shoah incombe plus au peuple allemand qu’aux bourreaux ou à Hitler. Si l’on s’est focalisé sur ces derniers, Hitler et les bourreaux, ce serait seulement afin de nous sentir moins coupables : les monstres dédouanent les hommes. L’absence d’angélisme heurte. L’angélisme moderne a la figure du rationalisme : il faut expliquer, parce que s’il y a une raison, il y a une excuse. Et la meilleure excuse que l’on ait trouvé pour le nazisme et la Shoah, c’est celle de l’inhumanité. Ne vous inquiétez pas braves gens, cela ne se reproduira plus, parce que nous ne le voulons pas et surtout parce que les Nazis étaient des démons et Hitler, le Diable ! Ouf ! Il n’y a rien de commun entre Hitler et nous parce que rien ne rapproche l’inhumain de l’humain. Alors, quand un film comme La Chute est réalisé, on se scandalise : comment un homme peut-il incarner le Diable ? Hitler n’était pourtant qu’un homme et, comme le dit Kohler, « il fut probablement l’homme le plus sincère de l’histoire. »
Il ne faut pas croire pour autant que Kohler rende un culte à Hitler ; loin de là ! Kohler le méprise profondément et il souligne plusieurs fois sa médiocrité artistique ou intellectuelle. Hitler est « un petit idiot mesquin », un « père fouettard stupide timbré petit péteur insipide chromo en pâte feuilletée ». La seule chose qu’il faut reconnaître à Hitler est donc d’avoir été sincère, c’est-à-dire d’avoir exprimé de manière démesurée sa haine stupide. C’est à partir de ce constat que l’on devine la thèse soutenue par Kohler dans son livre. Il y a différents niveaux de culpabilité :
1. Il y a d’abord Hitler. Bien sûr, Hitler est coupable. Hitler, en tant qu’idéologue, est responsable de la Shoah. Mais de là à faire de lui LE COUPABLE, c’est d’une mauvaise foi évidente : tout seul, Hitler n’aurait été qu’un grotesque bouffon. Hitler a rêvé ses crimes ; il ne les a pas lui-même réalisés.
Ce que je refuse de faire c’est d’accepter l’idée que le rêveur est de fait un type plus détestable que le type qui a balancé le corps dans le fleuve.
Hitler est un pervers « plus malin et plus civilisé » que les tortionnaires qui ont tué à sa place.
2. Sont donc également coupables les tortionnaires. Kohler éprouve une certaine fascination, peut-être même une certaine admiration pour certains d’entre eux et, notamment, pour Susu (sans doute inspirée d’Ilse Koch…), une chanteuse, « putain du commandant» qui fit un jour trancher le pouce à des juifs avant de les faire rôtir et de les dévorer sous leurs yeux… Kohler affirme alors qu’il n’y aurait pas la moindre trace d’antisémitisme chez les bourreaux. La haine est sans objet. Les Juifs ont été ignominieusement massacrés parce que tel était le contexte historique, parce que le racisme de l’époque était dirigé contre eux, mais les bourreaux auraient accompli leur tâche avec le même enthousiasme s’ils avaient eu affaire à des Noirs, des Arabes, des petits, des grands, etc. :
un raciste peut haïr sans que sa haine ait d’objet.
Il n’y a pas le moindre signe d’adhésion à l’idéologie nazie et peut-être même pas la moindre trace de racisme chez Susu qui a d’ailleurs finie par être décapitée sur l’autel du nazisme parce qu’elle avait du sang gitan. Et, à propos de Heydrich, le boucher de Prague, Kohler écrit :
le technicien, ne haïssait pas plus les hommes qu’il assassinait que le pistolet ne hait le suicidé qui suce son canon. […] n’aimait pas plus la femme qu’il baisait que la bite branlée aime son branleur. […] Il ne haïssait pas les juifs. Il aimait juste son boulot.
Les Susu, Heydrich, etc. sont bien d’impardonnables salauds, pires qu’Hitler, mais ce sont des salauds qui fascinent Kohler. Susu est son double inversé : elle agit, il est assis ; elle ose l’abject, il ne fait que le penser. Il l’aime, elle est sa fiancée fantasmatique : « Susu, tu es une traînée verte et visqueuse sur le mur des toilettes. Susu, je t’aborde en rêve. »
3. Les Allemands. Si Kohler décharge les tortionnaires et Hitler lui-même, c’est pour mieux reporter la faute sur la population allemande elle-même. Il faut mettre fin à la comédie de l’innocence. Le peuple allemand dans son ensemble est coupable. C’est pourtant uniquement pour innocenter les Allemands que les historiens stigmatisent le Führer. Kohler dit ainsi de ses collègues historiens :
Ils ôteront une partie de la culpabilité du peuple allemand et en rajouteront sur le bouc émissaire.
Or, sans ceux qui l’ont suivi, sans ceux qui l’ont laissé faire, Hitler n’aurait jamais été celui qu’il est devenu ; il serait resté un misérable taré. Le plus étonnant n’est donc pas qu’il y ait eu un Hitler – il y en a plein ! –, mais qu’il ait été écouté :
Ce qui m’intrigue, ce sont tous ceux qui n’étaient pas des idiots et qui ont voulu ce que Hitler voulait, ceux qui méditaient et planifiaient et organisaient et sacrifiaient afin d’établir le Reich de mille ans, qui revêtaient les uniformes et appuyaient sur la détente et fabriquaient des avions et préparaient les plats et forgeaient ces fameuses chaînes d’ordre, qui inventaient et complotaient et mentaient et volaient et tuaient, parce qu’ils voulaient ce que le petit crétin désirait ; eux, qui idolâtraient une stupide marionnette, qui aimaient les vérités du crétin, qui exécutaient les souhaits d’un fou meurtrier, d’un ignoble rien, d’un raté si insignifiant que l’échec semble une description excessivement élogieuse de lui.
Les Allemands sont plus coupables qu’Hitler lui-même parce qu’ils lui ont permis de réaliser ses projets et qu’ils y ont contribué. Il est bien insuffisant d’évoquer l’attentat manqué de Claus von Stauffenberg pour disculper les Allemands car, comme le rappelle Kohler, cet attentat n’a pas eu lieu en 1936, mais seulement en 1944, lorsque la chute était devenue inévitable. La tentative de von Stauffenberg est tout aussi pitoyable que l’engagement de ces milliers de Français dans la Résistance lorsque la victoire était promise. La lecture d’Uranus de Marcel Aymé devrait être obligatoire…
Nous n’avons pas vécu la vie qui convenait
Kohler ne fait pas que constater, il veut comprendre et comprendre est une tâche bien difficile… Juger, quelle facilité !, c’est considérer l’autre à partir de nos propres principes moraux, mais comprendre, c’est se mettre à la place de l’autre, raisonner comme lui. Kohler va comprendre les Allemands parce qu’il a compris son père. Son père n’est qu’un pauvre type dont la vie n’a été qu’une accumulation de frustrations, d’échecs. Et, toutes ces frustrations, tous ces échecs l’ont conduit à avoir la HAINE. Telle est la définition du sectaire : avoir la haine. Si la haine est apparue, c’est à cause de cet illusoire “droit au bonheur” qui, sans être inscrit dans toutes les constitutions, n’en est pas moins universel. Pourquoi exister si c’est pour ne pas être heureux ? Ne pas être heureux est une injustice ; exister c’est donc être victime et si l’on est victime, c’est qu’il y a un coupable :
Le sectaire est une personne qui a souffert d’une injustice imméritée, d’une injustice qui n’a pas été réparée, et malheur aux autres si jamais il a l’occasion de prendre sa revanche, et de reprendre ce qui a été longtemps à lui – possessions, pouvoirs et honneur – à ceux qui ont calomnié ses principes et méprisé son mode de vie.
Kohler ne finira pas son livre parce qu’il est comme son père. Lui aussi est un sectaire. Il a beau être un intellectuel de premier ordre, sa vie est merdique, à tous les points de vue. Sa famille est une catastrophe : son père est un minable, sa mère, alcoolique, un déchet :
Mon père m’a appris à être un raté. Il m’a appris le sectarisme et l’amertume. Je n’ai jamais acquis son courage, car ma mère m’a refilé le virus de la lâcheté – doux comme du coton – et je suis né avec son oralité désespérée, sa lente et insistante cruauté – tels des sables mouvants – sa vorace passion.
Il déteste Martha, sa femme (« Quand je te regarde, je vois un ragoût figé dans sa graisse ») et méprise ses gosses. Il baise de temps à autre des étudiantes, mais ne se remet toujours pas de sa rupture avec Lou dont il était tombé éperdument amoureux. Les frustrations sont aussi physiques : Kohler déteste son corps adipeux et est obsédé par la petitesse de sa bite (il y a, à ce sujet, des pages superbes) qui est – n’en déplaise à Cicéron – plus que son visage, le miroir de son âme :
Mon kiki était, en fait, le modèle réduit et asticoté de mon âme.
Kohler est comme son père, comme bon nombre d’entre nous : un sectaire. Alors que son père subissait son sectarisme, n’avait aucune prise sur lui, Kohler est conscient. Il imagine alors former un parti politique : le PDP, le Parti des Déçus du Peuple. Et, comme le parti Nazi, le PDP susciterait l’enthousiasme de tous les vaincus de la vie qui y verraient une possibilité de salut. Si Hitler a été suivi, si la pensée fasciste, réactive ou révolutionnaire aura toujours du succès, c’est justement parce qu’elle propose aux vaincus de devenir les vainqueurs. Il y aura nécessairement de nouveaux Hitler et tous les “plus jamais ça” ne sont que de pieuses et de vaines espérances. Kohler peut alors comprendre la réaction des Allemands et avoue que s’il avait vécu à cette époque, il aurait sans doute réagi de la même manière :
Je l’aurais suivi juste pour me venger, juste pour causer la consternation ; juste pour jouir par la bouche en gueulant Heil ! juste pour rejoindre la grande tribu qu’il avait créée, la famille du Führer, un Etat intitulé “riposte”. Je savais qu’il était une mauviette déguisée en loup. Je savais que c’était la somme de nous tous disposés en vastes rangs qui accomplissaient les belles barbaries de Hitler, voulaient ce qu’il désirait, réussissaient pour une fois, baisant ceux qui nous baisaient, torchant les visages de leurs sourires comme de la merde des culs dont ils se faisaient une façade, désespéré parce que j’allais vivre vide de toute façon, parce que nous allions tous mourir inutilement, de toute façon ; alors qu’est-ce que je risquais, vraiment ? que perdrais-je que je n’avais déjà perdu ? et pendant un temps j’appartiendrais à quelque chose, mon corps de bronze chevaucherait une bête de bronze, sentirais les flancs de métal contre mes cuisses de métal, la vie aurait davantage que du sens, l’avenir serait lumineux, les clichés se dresseraient tels des aveugles pour accueillir le matin, et j’aurais une place dans le rang, j’aurais une certaine supériorité, j’aurai aidé une équipe gagnante, je porterais un sacré bel uniforme, je serai un petit doigt, bien sûr, mais dans un gros poing ; avec plein d’autres nous aurions défilé, aidé, conseillé, avancé, remonté une nouvelle avenue, et comme la plupart des ecclésiastiques, la plupart des politiciens, la plupart des menteurs professionnels, nous aurions su ce que nous faisions, et fait des compromis, pris des risques – l’amer avec le doux pour l’amour du doux – pris tout ce qu’on pouvait prendre, pourquoi pas ? pillé, violé, régné sur nos petites régions du Reich à coups de paperasses, puis nous serions rentrés chez nous tout joyeux, quand le soleil de notre chouette et nouvel enfer se serait couché, pour embrasser la Frau, engendrer des enfants, caresser le chat, se faire lécher par le chien, bien manger, portés sur un fleuve de bière vers la félicité, et roupiller tout le dimanche durant sur le divan dominical.
L’idéologie a de l’avenir parce qu’elle est la revanche des faibles, elle leur permet de se sentir forts ; elle donne un sens, même si ce sens est factice et/ou effroyable. Alors où est l’innocence ? Où est la culpabilité ? La culpabilité revêt différentes formes selon que l’on envisage ceux qui pensent l’horreur, ceux qui la mettent directement en place ou ceux qui la permettent ou la favorisent. Ce que veut nous faire comprendre Kohler, c’est que nous sommes essentiellement coupables. Le point de vue n’est pas théologique, il ne s’agit pas d’une culpabilité remontant à une faute originelle : cette culpabilité est inscrite dans l’essence même de l’homme qui, parce que sa nature est mesquine, ne peut s’empêcher d’éprouver une jouissance perverse à faire souffrir ses semblables. Ce n’est pas pour rien que l’événement fondateur de l’histoire occidentale est un génocide : celui de Troie. Malgré le devoir de mémoire, malgré les “plus-jamais-ça”, il y aura toujours des dictateurs et des massacres. Il n’y a que la terminologie qui change, qui s’appauvrit :
Mais si tu veux penser à quelque chose de vraiment drôle, regarde comment les titres des tyrans changent. Nous n’aurons plus d’Empereurs, de Rois, de Tsars, des Shahs, ou des Césars, pour trancher nos membres et incendier nos maisons, petite, souiller nos femmes et enculer nos garçons ; les masses prennent aujourd’hui le relais ; les masses adorent la tyrannie ; elle réclament la tyrannie ; elles dansent au son de la tyrannie ; elles sentent que leurs mains forment le Poing du Premier Citoyen ; nous assassinerons plus modestement à l’avenir : sous les bannières d’Il Duce, Der Führer, du secrétaire général ou du président du parti, le P-DG de quelque chose. Je soupçonne que le premier dictateur de ce pays se fera appeler Coach.
Pourquoi Hitler est-il si intéressant ? Parce qu’il est LE symptôme. Hitler a réussi à accéder au pouvoir parce qu’il a su titiller la Bête qui est en nous, mais il a échoué parce qu’il ne pouvait en être autrement, parce que c’est le destin de toute idéologie. C’est donc bien « la leçon de la catastrophe » que nous donne Hitler qui devrait nous préoccuper. Cette leçon, Kohler la résume en la victoire du Homo homini lupus de Hobbes sur la perfectibilité humaine de Rousseau :
L’humanité ne peut être sauvée.
La perfection est impossible. Les utopies sont stupides. Tous les projets doivent être entrepris en comprenant que les défauts humains risquent de les faire capoter. La notion que l’humanité est susceptible de s’améliorer est aussi stupide qu’une superstition et aussi peu démontrable que la croyance dans le surnaturel. Le seul ennemi de l’homme c’est l’homme.
Hélas, nos sociétés hygiénistes et bien-pensantes ne peuvent pas admettre cette vérité. Le temps qu’a passé Kohler à rédiger ce livre est perdu. Cela d’autant plus que le public réclame une version édulcorée, rationnelle et manichéenne de l’histoire. L’histoire s’est intellectualisée, elle est faite par des universitaires au teint jaune alors qu’elle devrait être l’œuvre des poètes, comme l’étaient Hérodote et Thucydide. La vérité de l’histoire est la violence, la sempiternelle violence que seule l’écriture épique, parce qu’elle ne connaît pas la morale, peut restituer :
Partout désormais plus rien qu’une révocation de la muse. Recalez Clio, révoquez la douce Calliope, car l’Histoire s’est faite sodomiser par l’Idéologie, et lâche ses faits en un nuage odorant, et les poètes n’ont plus le moindre souffle, ils sont dans un autre secteur à présent, où le Parnasse est une pâtisserie, et ils produisent leurs poèmes promptement à la demande tels de zélés cuistots secouant la friture.
Ayant mené « une vie d’assis », Kohler a sombré, comme toute l’humanité, dans « le fascisme du cœur ». S’il y a une issue, elle consisterait donc à retrouver cette innocence originelle, celle de l’enfance, pour laquelle la vie est un jeu qui n’a pas de règles sinon celle qu’elle veut bien lui donner, par-delà le bien et le mal…
Éric Bonnargent
La librairie Charybde (dont les libraires collaborent régulièrement à la section Livres de Nuit & Jour, avec des textes pris dans leur très actif blog de lecture), invitait Gilles Marchand et Éric Bonnargent, auteurs du « Roman de Bolaño », pour une rencontre autour de sept textes qu’ils avaient choisis. Ce texte d'Éric Bonnargent sur "Le Tunnel" a été lu à cette occasion.