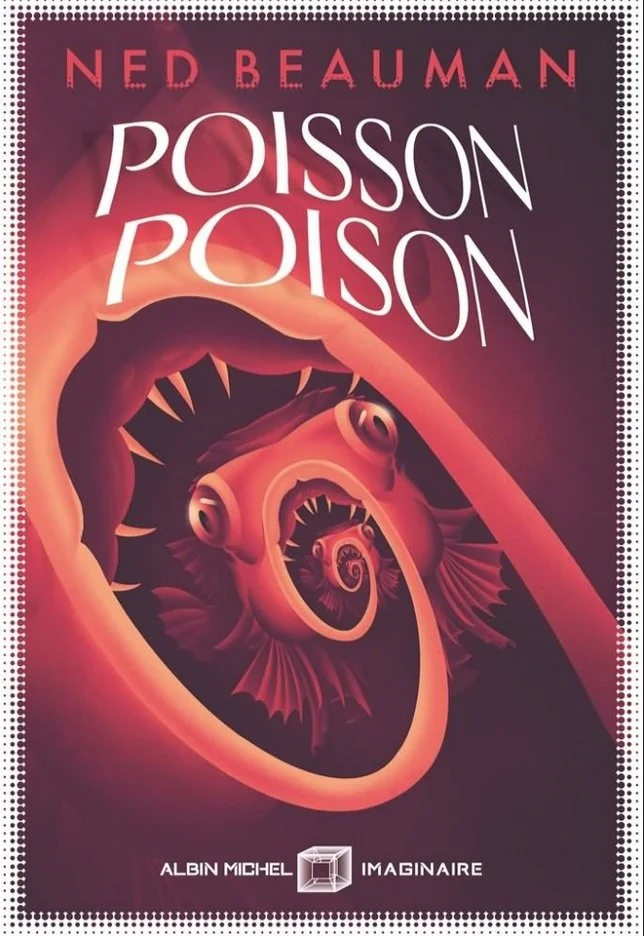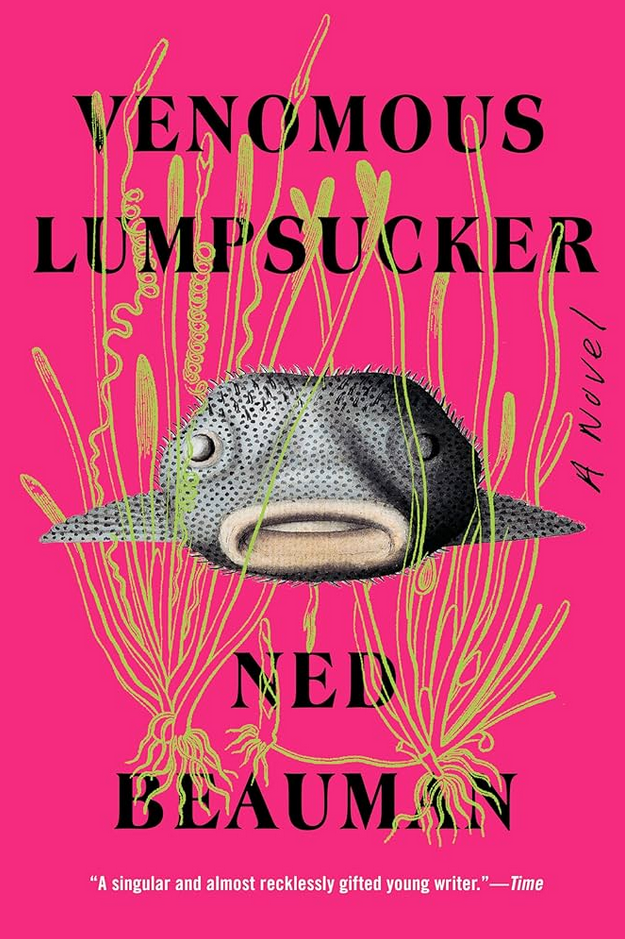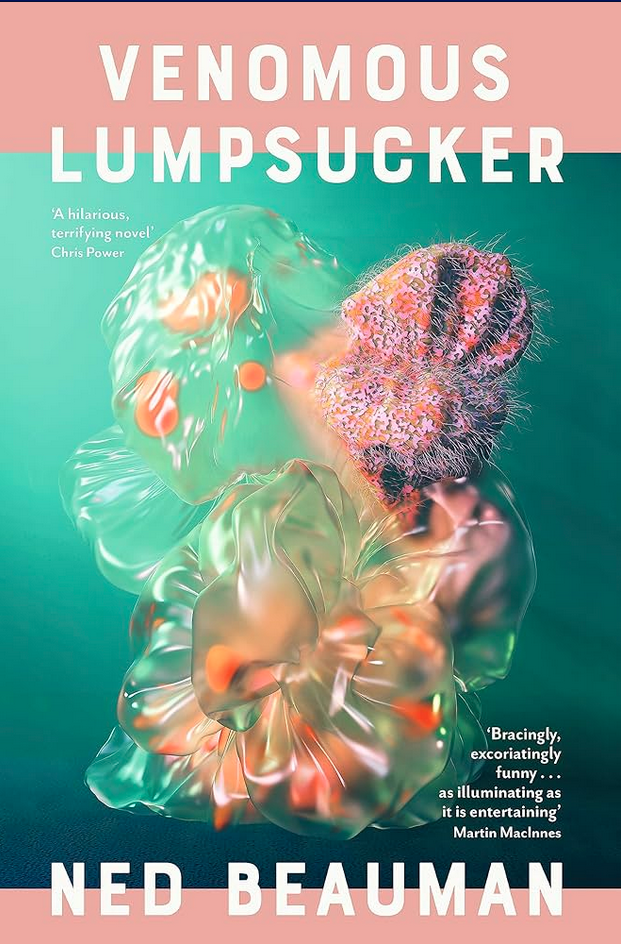Venez vous faire empoissonner par Ned Beauman
Autour d’un poisson baltique apparemment voué à l’extinction, structurelle et accidentelle, un thriller science-fictif échevelé questionne cruellement tout ce qui nous sert d’excuses pour laisser venir le désastre prévisible.
Pas de note de lecture proprement dite pour « Poisson poison », sixième roman de Ned Beauman, paru en 2022, couronné par le prix Arthur C. Clarke en 2023, et traduit en janvier 2025 par Gilles Goullet aux éditions Albin Michel, dans la collection Imaginaire : l’ouvrage fait en effet l’objet d’un petit article de ma part dans Le Monde des Livres daté du vendredi 28 février 2025 (à lire ici). Comme j’en ai pris l’habitude en pareil cas, ce billet de blog est donc davantage à prendre comme une sorte de note de bas de page de l’article lui-même (et l’occasion de quelques citations du texte, bien sûr).
Elle s’apprêtait à envoyer le dernier poisson dans les airs quand Abdi déboula sur le pont pour la prévenir. Il montra le nord dans le crépuscule. Peu auparavant, Resaint avait remarqué sur l’horizon ce qu’elle avait pris pour un nuage d’orage isolé, la brume, épaissie par la tombée de la nuit, donnant un temps localement plus lourd. Mais la distance s’étant réduite, elle distinguait à présent les trois grandes colonnes à la base du nuage, semblables à des cheminées qui évacuaient la houle de la mer. Un embrunisateur, qui naviguait cap sur eux. Le premier qu’elle voyait depuis son arrivée, un bon moment auparavant, sur la mer Baltique.
Son drone de transport était censé s’envoler vers le nord. Elle se rendit compte que cette trajectoire le mettrait en plein sur celle de l’embrunisateur et le propulserait donc aussitôt dans les flots. La tempête qui entourait un embrunisateur ne ressemblait à aucun phénomène naturel. Elle était prodigieuse non par sa force, mais par sa géométrie. Les guillemots et les goélands argentés, capables de supporter sans broncher les plus furieuses tempêtes hivernales, étaient ballottés comme de vieux papiers. C’était trop étranger pour leurs ailes. Et ce drone, auquel les grands vents posaient rarement problème, ne se rendrait même pas compte de ce qui lui tombait dessus.
Ayant toujours l’itinéraire de vol sur l’écran de son téléphone, Resaint ajouta la surcouche qui indiquait les autres navires à proximité. Abdi montra l’embrunisateur, simple point blanc anonyme sur la carte. Resaint modifia l’itinéraire du drone pour qu’il le contourne à distance prudente par l’est.
« Merci », dit-elle en posant la main sur le bras d’Abdi. Elle consulta une nouvelle fois la trajectoire de l’embrunisateur. « On dirait qu’il nous vient droit dessus, non ?
– Il ne nous touchera pas. Mais nous frôler ne le gênera pas non plus. Clairement, mieux vaudrait pour toi ne plus être dehors quand ça arrivera.
De toute manière, songea-t-elle, le Varuna ayant presque la taille d’un porte-avions, l’embrunisateur sortirait sans doute perdant d’une collision. Ce qui était dommage, quelque part, car elle aurait bien aimé voir le Varuna éventré. Peut-être pas pendant qu’elle se trouvait à son bord, mais ce navire méritait malgré tout qu’on le coule. Pour l’embrunisateur, ce serait une manière d’employer sa soirée bien plus utile que de faire perdre le nord à quelques oiseaux de mer.
Elle murmura un ordre à son téléphone et les rotors du drone se mirent à vrombir. L’appareil décolla du pont en soulevant quatre câbles fixés à son ventre, puis ceux-ci se tendirent et la cargaison s’éleva à son tour : un aquarium en plastique qui contenait dix lompes venimeux évoluant dans plus de deux cent cinquante litres d’eau de mer. Le drone continua à monter jusqu’à ce que l’aquarium soit assez haut pour franchir le bastingage. Quelques gouttes d’eau débordèrent à ce moment-là, que Resaint sentit lui tomber sur le front tel un sacrement. Une fois au-dessus des flots, il accéléra en douceur, comme une cigogne avec un bébé particulièrement précieux en écharpe, cap au nord.
Il parcourrait une vingtaine de kilomètres jusqu’aux récifs du Kvarken du Sud, où les lompes venimeux se rassemblaient à chaque période de reproduction et où il déverserait le contenu de l’aquarium. En théorie, une fois ses expériences menées à bien, Resaint aurait pu les relâcher dans la mer autour du Varuna en les laissant rentrer chez eux tout seuls. Ils se débrouillaient très bien en navigation. Mais elle refusait de prendre ce risque. Il en restait si peu. Chacun d’eux était très précieux. Aussi aurait-il été particulièrement déplorable et regrettable que, disons, l’embrunisateur percute le drone avec assez de violence pour que tous ces poissons se brisent l’épine dorsale en heurtant les flots.
Poisson poison », parmi les nombreux intérêts qu’il présente à la lecture, offre une jolie démonstration de ce qui peut se produire de particulièrement précieux à la frontière entre littératures de genre et littérature dite générale. Dans un registre plus proche de l’anticipation joueuse déployée par un Neal Stephenson dans son « Choc terminal », chez le même éditeur, Ned Beauman, qui n’est pas, lui, issu de l’univers science-fictif (il n’est pas né au sein du sérail ou du ghetto, selon le point de vue et le degré de radicalité d’un commentaire éventuel à ce sujet), mais bien de celui de la littérature ailleurs appelée « blanche » (ce qui ne veut rien dire en soi, nous sommes bien d’accord), réalise un tour de force digne de l’un des plus prometteurs jeunes auteurs britanniques signalés par Granta il y a déjà quelques années, mais digne aussi en tous points ou presque d’un auteur « spécialisé ».
Francis Berthelot, dont il faut lire et relire le toujours aussi précieux « Bibliothèque de l’Entre-Mondes », vingt ans après sa sortie, lorsqu’il analysait les transfictions, notion créée par lui pour désigner ces écrits prisés des lectrices et lecteurs qui sont aussi des coureurs de frontière et de marge, se gardait d’ailleurs bien de s’appuyer sur une poétique de la science-fiction dont les définitions risqueraient l’oscillation perpétuelle, impraticable, entre le trop vague et le trop restrictif. « Poisson poison » s’affranchit allègrement des barrières qui sépareraient le thriller de la science-fiction, le roman noir de l’anticipation, ou la satire socio-économique de la spéculation éco-financière.
Le pas de côté science-fictif, qui signe souvent la performance d’une expérience de pensée propre à ce genre littéraire (pris cette fois en son sens le plus large possible) se risque rarement sur le terrain du fonctionnement relativement détaillé de la finance mondiale, contemporaine ou à venir très bientôt. Kim Stanley Robinson, avec la puissance contenue dans ce domaine au sein de son « New York 2140 » et de son « Ministère du futur », y constitue l’une des rares exceptions. Il faudra désormais y ajouter Ned Beauman, dont la compréhension intime du détournement par l’absurde des « crédits carbone » (sans même parler des innombrables fraudes dont cet outil a été, encore récemment, la victime) emporte admiration et adhésion – à un certain cynisme vis-à-vis de ce « capitalisme de l’habillage ».
Au-delà du rusé cadre général créé par les crédits d’extinction, Ned Beauman a su imaginer plusieurs heureuses convergences inattendues (ou en tout cas relativement peu convenues), du côté du business de l’écologie (on songera par moments au formidable « Bleue comme une orange » de Norman Spinrad, par exemple, même si le titre français de son « Greenhouse Summer » fait à chaque fois un peu saigner le cerveau), comme du côté des intelligences de tous ordres, naturel et culturel, artificiel et animal, rejoignant par un détour digne de Georges Balandier les travaux d’un Philippe Descola ou d’un Baptiste Morizot – non pas directement en tant qu’anthropologues, voire éthologues, mais bien en tant qu’inventeurs de bribes salutaires de philosophies politiques nouvelles pour des temps particulièrement incertains.
Une autre fiction polie, enracinée plus profond, était indispensable au travail que Resaint menait à bord. Celle de son indépendance.
Ce n’était pas pour rien que la Brahmasamudram Mining Company l’avait installée dans un labo sur le Varuna alors que cette mission aurait pu tout aussi bien se mener depuis la côte suédoise. Il s’agissait là d’une de ces tactiques psychologiques, d’un de ces rites tribaux qui se glissaient si souvent à l’intérieur des transactions, même les plus impersonnelles, des multinationales qui l’employaient. Comme la majeure partie de ses clients, Brahmasamudram tenait à lui faire garder en permanence à l’esprit que, jusqu’à la fin de son contrat, elle leur appartenait. Elle vivait et travaillait dans le domaine de Brahmasamudram, en dehors duquel il n’y avait rien d’autre que l’eau glacée de la Baltique.
Sauf qu’il ne fallait pas le dire à voix haute. Oui, elle était dépendante, surveillée, confinée, elle n’était pas moins que les membres d’équipage une vassale du Varuna. Mais son travail partait du principe qu’une scientifique comme elle se livrerait à des jugements objectifs sans se laisser influencer par le client qui achetait son temps. Et toutes les parties impliquées bénéficiaient de ce principe… de son immaculée aura sacerdotale. Que Devi la traite ainsi – qu’elle révèle de manière aussi flagrante la coercition derrière leur hospitalité – souillait non seulement sa mission actuelle, mais toutes les précédentes.
Au moins la gêne de Devi ne semblait-elle pas moindre que sa propre indignation. De toute évidence, la décision ne venait pas d’elle. Quelque chose l’obligeait à agir ainsi. « Allons dans votre cabine, dit-elle. S’il vous plaît. »
Resaint savait qu’elle pouvait refuser. Devi n’allait pas la sortir de là en la traînant par les cheveux. Mais un baroud d’honneur à l’intérieur de la cabine d’Abdi ne ferait que compliquer grandement la situation pour lui, ce à quoi elle se refusait. « Si on retourne dans ma cabine, est-ce qu’on va régler ce foutoir auquel je ne comprends rien ?
– Oui, répondit Devi, soulagée de voir une ouverture. Oui, on va le régler. Promis. Quelqu’un vient vous parler.
Je suis toujours admiratif lorsque je lis une autrice ou un auteur capable de s’inscrire dans le rythme échevelé des meilleurs thrillers, tout en parvenant à convoyer sans lourdeur, ou même avec une certaine grâce, une information particulièrement dense sur un contexte inconnu a priori, en jouant de l’humour noir et de l’ellipse pour échapper aux diverses malédictions de l’exposition. Comme il nous l’avait prouvé, déjà très facétieusement, dans son « Glow » de 2014 (dont on vous parlera tôt ou tard sur ce blog), Ned Beauman maîtrise cette écriture-là quasiment à la perfection.
Plus tôt ce soir-là, dans un taxi qui l’emmenait dîner, Halyard vit une tumeur s’écraser sur le sol comme une météorite.
Ils se trouvaient à l’arrière du convoi, un minibus et trois taxis bondés qui transféraient tout le monde depuis le siège de Mosvatia Bioinformatics, à l’extérieur de Copenhague, jusqu’à un hôtel sur le front de mer. Halyard ne savait pas trop ce qui se serait passé si le taxi juste devant le sien n’avait pas quitté d’un coup la chaussée au tout dernier moment. Il s’agissait là d’une intéressante question à la papier-caillou-ciseaux, car la tumeur était faite de chair, traditionnellement perdante face à un pare-chocs, mais d’un autre côté, il savait qu’on pouvait se tuer en percutant une biche en voiture, et ce truc-là devait bien peser le triple d’une biche.
Son taxi à lui n’ayant pas fait d’embardée, mais seulement freiné – les précipitant, lui et les trois autres passagers, dans leurs ceintures de sécurité, tandis que son téléphone lui échappait des mains pour tomber sur le tapis de sol –, il bénéficiait à présent d’une vue dégagée par le pare-brise. La monstruosité, qui avait éclaté en percutant l’asphalte, gisait à présent en quatre fragments irréguliers, chacun au moins aussi volumineux qu’une caisse de transport. Le bruit de l’impact n’avait été qu’un coup de tambour sec, mais symphonique, d’une certaine manière – à la fois profond, humide, disruptif et bondissant, un effet sonore vraiment remarquable de la part de la tumeur –, et pourtant, en termes d’horreur texturale, l’image le dépassait. La viande, blanc rougeâtre, luisante, était ébouriffée et plissée, à part à certains endroits où elle était soit enveloppée comme du filet dans de l’épimysium translucide, soit recouverte d’un épais pelage blanc ou noir. Ici et là, un bout d’os dépassait.
Ce fut pour Halyard une expérience certes saisissante, mais pas tout à fait aussi cauchemardesque qu’elle aurait pu s’avérer s’il n’avait pas su de quoi il retournait. Et il le savait parce que les médias avaient parlé de la dernière fois où pareil événement s’était produit, pendant une conférence dans les environs de Madrid. Ce qui venait de tomber était un tératome, autrement dit une tumeur constituée de cellules germinales capables de devenir n’importe quel type de tissu (sans doute y avait-il donc là-dedans des dents, de la matière cérébrale, voire des globes oculaires, comme une anagramme d’un corps mammifère). Il avait été cultivé quelque part dans un laboratoire clandestin à partir d’ADN volé à Chiu Chiu, le « dernier » panda géant. Et catapulté pour protester contre la manière dont Halyard gagnait sa vie.
Chiu Chiu avait succombé à une infection respiratoire fongique, douze ans plus tôt, dans l’unité de soins intensifs du Centre de recherche sur le Panda géant de Chengdu. À l’époque, il était le dernier de son espèce. Il ne le resta pas longtemps, car on produisit ensuite une multitude de clones qu’on implanta dans l’utérus d’ourses noires. Il resterait toutefois à jamais le dernier d’une chaîne ininterrompue d’engendrements humides, le dernier panda né d’un panda né d’un panda né – ici, une ellipse – du tout premier panda.
Sur le pur plan du poids émotionnel, sa mort provoqua peut-être bien un bouleversement sans précédent dans l’histoire de l’humanité, le plus grand nombre de personnes multiplié par la plus grande sincérité de sentiments. On ne pouvait en temps normal se livrer à des généralisations sur une nation de 1,4 milliard d’habitants, mais presque tous les Chinois adoraient Chiu Chiu. Au point que dans les derniers jours de son existence, il avait été interdit au Centre de recherche de publier un bulletin de santé horaire, de crainte de déstabiliser les marchés boursiers. Cette mystérieuse infection fongique qui se riait même des plus strictes quarantaines avait déjà tué des centaines de pandas dans le monde, sauvages ou non. Et lorsqu’elle emporta Chiu Chiu à son tour, les Chinois sombrèrent dans de frénétiques lamentations et remords. Cet échec à sauvegarder leur propre animal national les remplissait d’une honte lancinante. Des jours durant, les rues furent bondées de ce qui ressemblait à des goules hurlantes libérées des enfers : il s’agissait en réalité d’enfants grimés en panda en hommage à ji mo de Chiu Chiu (Chiu Chiu sans personne), mais dont les pleurs incontrôlables avaient fait dégouliner le maquillage sur les joues. Un journaliste de Pékin ayant publié une chronique intitulée « Pourquoi je ne me soucie pas de Chiu Chiu » fut contraint de se cacher. Oui, il y aurait bientôt des clones de panda, mais une campagne du Parti communiste contre les « produits mensongers » battait son plein et les clones étaient souvent comparés à du boudin frauduleusement épaissi au formaldéhyde.
Pour le pays le plus puissant du monde, l’émotion trouva un exutoire dans l’action. Pendant la période que les cyniques présenteraient par la suite comme la grande aliénation nationale chinoise, cent quatre-vingt seize autres États, agissant à vrai dire sous la menace économique, adhérèrent à la toute nouvelle Commission mondiale sur l’extinction des espèces. « Il n’y aura plus de Chiu Chiu, proclama un représentant chinois lors de la création de cette CMEE. Chiu Chiu sera le dernier des derniers spécimens recensés. Car nous ne laisserons plus jamais se reproduire pareille tragédie. Le panda géant sera la dernière espèce dont les activités humaines ont provoqué la disparition. »
Bien entendu, ce ne fut pas du tout ce qui arriva. À la place, il arriva plutôt l’industrie de l’extinction.
Hugues Charybde, le 31/03/2025
Ned Beauman - Poisson poison - Albin Michel Imaginaire
l’acheter chez Charybde, ici