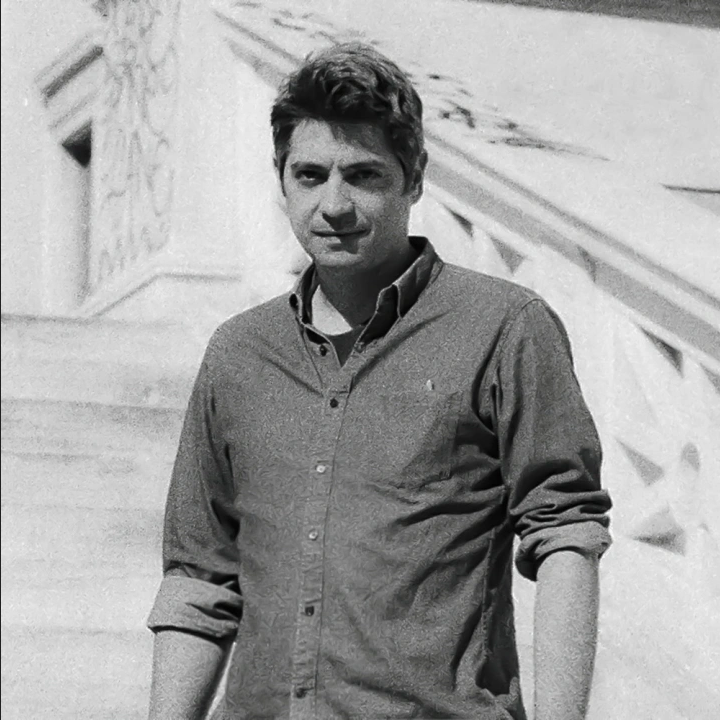Comment jazzer dans le noir à Athènes avec Makis Malafékas
En pleine méga-quinquennale d’art contemporain à Athènes, l’enquête déjantée, tragique et hilarante, d’un auteur spécialisé dans le jazz, détective malgré lui. Entre paillettes et euros, hype et art de vivre au soleil, un polar contemporain incisif pour déjouer conventions et attentes.
Moi, l’art contemporain, je n’y connaissais rien. J’avais bu mon deuxième café, le gobelet était dans le filet à magazines et la tablette relevée en position atterrissage. Mes tempes étaient prêtes à subir l’offensive. À côté, les deux Français n’avaient pas arrêté de jacter une seule seconde. Là, ils parlaient d’art. Différences et points d’accroche entre kitsch et surréalisme. A vrai dire, tout le monde n’avait que ça à la bouche, l’art. Sous toutes ses formes. Tout le monde, sauf les deux Suédoises de la rangée 8.
« Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers l’aéroport Elefthérios-Venizélos. Veuillez… »
Je n’aurais pas pu choisir meilleure période pour sortir un livre sur John Coltrane. Lancement d’un bouquin sur le jazz à Athènes au cœur de l’été et en pleine « Documenta 14 », cette grand-messe de l’art contemporain qui semblait concerner la terre entière… Ça sentait le fiasco à plein nez. Personne n’allait venir, pas même mon éditeur. Où est-ce que je foutais les pieds ?
« Tiens regarde, là, par exemple, tu vois la tour de contrôle ? Elle te fait pas penser à une colonne dorique ? a dit l’un des Français.
– C’est vrai ça, a répondu l’autre, c’est carrément une colonne dorique. Carrément.
– Oui et non. C’en est une, sans l’être. Maintenant, imagine que les Grecs l’aient recouverte de plaques de marbre, comme ça, de haut en bas, pour qu’elle évoque réellement une colonne dorique, disons en référence à leur patrimoine culturel et tout et tout : à ce moment-là, on serait sur du kitsch. Tu vois ce que je veux dire ? »
Mon véritable problème, à cet instant, ce n’était ni Coltrane ni la Documenta. C’était ces putains d’Airbus d’Aegean Airlines et leurs cabines en plastoc. La dépressurisation brutale à l’approche de l’atterissage. Chaque fois, je passais par toutes les teintes du bleu. J’ai commencé à me masser les tempes et les sinus, en prévision des dix prochaines minutes. Les Français ne facilitaient pas les choses.
« Tandis que si, par contre… euh, je voulais dire : si, en revanche, on prenait, telle quelle, une colonne antique, ou même néoclassique, et qu’on la recouvrait d’une couche vitrée, avec un tissu argenté…
– Comme Christo !
– Exactement, comme les Christo. À la différence qu’eux, ils emballent, alors que là, ce qu’on veut, c’est déguiser.
– Tout à fait.
– Donc mettons que tu déguises la colonne en tour de contrôle, avec des matériaux modernes, eh bien là, on parlerait de surréalisme. »
« Cabin crew ready for landing. »
J’ai arrêté de me masser, encore un peu et mon front se déchirait comme un sac plastique. Mes tympans battaient la mesure avec fracas, j’avais l’impression que mes yeux allaient me sortir des trous de nez. Les rayons du soleil traversaient la cabine à l’horizontale. Il n’y avait pas l’ombre d’un nuage. En dessous, des champs d’oliviers.
« Et si cette colonne, c’était celle de la place Vendôme, on pourrait presque faire enfiler à Napoléon une tenue de pilote !
– Ou de contrôleur aérien !
– C’est ça ! De contrôleur aérien ! Ah ah ah !
– Aha aha aha !
Atterrissage. Applaudissements. Ça commençait bien. J’ai attendu que tout le monde sorte pour me lever de mon siège. J’ai enfilé mes Ray-ban. Au moins, la canicule était au rendez-vous.
Athènes, été 2017. La Documenta 14, quinquennale comptant parmi les manifestations les plus prestigieuses et les plus courues du monde de l’art contemporain, bat son plein sous l’effrayante canicule à laquelle la Grèce essaie de s’habituer depuis quelques années. Tout juste débarqué de Paris où il réside une partie de l’année, Mikhalis Krokos est venu préparer la soirée de lancement de son nouveau livre, « Une traînée de cuivre », une biographie de John Coltrane, lorsque sa chère amie Kris se retrouve plus qu’impliquée dans la disparition d’un tableau, créé en happening lors d’une grosse soirée privée chez un vieil ami commun, le collectionneur d’art Harry Drummond.
Alors qu’il se prépare simplement à aller rendre le tableau « emprunté » du fait d’un pari d’ivrogne, le factotum improvisé voit les choses se compliquer à vive allure, et se retrouve bien malgré lui embringué dans une enquête à ramifications qui, très vite, n’ont plus rien de gentiment joueuses, surtout lorsque les premiers cadavres apparaissent. S’agit-il uniquement d’un canular ayant mal tourné, ou y a -t-il là quelque chose de beaucoup plus sombre, souterrainement à l’œuvre ? Dans les rues surchauffées d’Athènes ou dans les collines de l’île d’Hydra où l’on ne sent plus un seul souffle de vent, Mikhalis Krokos découvre au fil des nuits chaudes un univers âpre et sans merci à peine dissimulé derrière l’amour de l’art – et peut-être surtout, de ci de là, de la réputation et de l’argent qui l’accompagnent.
Les Suédoises ont attrapé la première navette pour Athènes, celle que j’ai ratée. Je les ai vues à travers la vitre alors que le bus s’éloignait. Des sportives. Sacs de rando, sandales anatomiques, bandana autour du cou, qu’elles ont desserré en sortant du terminal. Il y avait quelque chose de cool dans leur façon de marcher. Des jambes divines. Adieu la Suède.
Le bus suivant, plein à craquer du fait de l’arrivée simultanée de quatre vols internationaux, « parlait art » d’une seule et même voix : quel était le programme du lendemain, les lieux et les events à ne pas manquer, est-ce qu’on trouvait toujours des anarchistes dans le quartier d’Exarcheia et, si oui, était-il possible d’en voir, est-ce que la température retombait un peu la nuit, et les moustiques tigres, il y en avait ? Moi, je n’écoutais pas. J’avais encore les oreilles complètement bouchées. D’ici trois quarts d’heure, j’aurais remis les pieds dans mon deux-pièces rue Asklipiou, j’aurais téléphoné à mon éditeur pour les détails de la soirée de lancement, j’aurais récupéré ma Seat Ibiza et je me serais engouffré dans les rues vibrantes du centre-ville.
Nous avions déjà goûté à de somptueuses satires du milieu – ou plutôt DES milieux, dès que l’on y regarde de près – de l’art contemporain. Du redoutable « Rites sanglants de la bourgeoisie » (2010) de Stewart Home à l’halluciné « Block Party – Un roman à dix étages » (2009) de Richard Milward, du monstrueux et génialement décalé « Trash Vortex » (2024) de Mathieu Larnaudie au paradoxal et audacieux « Les tentacules » (2015) de Rita Indiana, en passant par le magnifiquement science-fictif « Les employés » (2018) d’Olga Ravn, le décapant « Basqu.IA.t » (2021) de Ian Soliane, le parfaitement vénitien « Black Bottom » (2018) de Philippe Curval, ou encore le subtilement ironique « Le dernier cri » (2017) de Pierre Terzian, nous avons pu saisir les tours et détours de ce creuset des grandeurs et des palinodies du contemporain, à l’âge du capitalisme tardif.
Le sel bien particulier répandu par Makis Malafékas avec ce « Dans les règles de l’art », publié en 2018 et traduit du grec en 2022 par Nicolas Pallier chez Asphalte, aura été de confronter brillamment cet univers-là à un registre tout droit issu du roman le plus noir, celui des détectives hardboiled à chapeau mou, réincarnés en un formidable amateur de free jazz et d’alcools nocturnes plus ou moins exotiques. Dans une Grèce bien contemporaine qui tient plus de Yannis Tsirbas ou de Chrìstos Ikonòmou (voire de la libre interprétation proposée par Cédric Klapisch dans sa récente série « Salade grecque ») qu’au pourtant robuste commissaire Kostas Charitos de Petros Markaris, on se délectera sans retenue de ce brio ravageur, où l’humour noir et le rêve éveillé tiennent la part belle.
« C’est toi qui as volé le tableau que t’a volé Kris ? »
Harry me regardait, les yeux écarquillés. Il essayait de comprendre ce que je lui racontais. Puis son menton est redescendu d’un cran, il a basculé la tête en arrière et s’est mis à glousser. De trois doigts, il m’a fait signe d’entrer, et a ri pendant tout le trajet jusqu’au salon.
« Frigo, ai-je dit en posant sur une table les deux bouteilles de vin que j’avais achetées au port en arrivant. Tu crois que je peux prendre une douche ? »
Je venais de grimper quatre cents marches.
« Fais comme chez toi, Mike. »
Harold Edgar Drummond. Écossais. Passeports britannique et français, à ce que je savais, mais plus grec qu’un Grec, sans une once d’accent. Juste un enrouement chronique. Né quelque part en Italie, de parents bohèmes lancés dans un tour du monde ; deux mois plus tard ils se séparaient, à Athènes. Sa mère, française, l’a gardé avec elle à Hydra, où elle venait d’acheter pour une bouchée de pain une maison de maître en ruines. Elle l’a retapée au fil des années, pièce par pièce, avec l’aide de ses frangins et autres cousins… Tous des artistes.
Enfance à Hydra, donc. À l’âge de dix ans, il commence à se rendre régulièrement à Glasgow, du côté de chez son père, puis à voyager un peu partout – et, à partir de quinze ans, seul. À sa majorité, il hérite d’une fortune colossale et devient collectionneur d’art. Il rencontre tout le milieu, tous les gens qu’il faut connaître. Après quelques séjours en Allemagne, il décide de tout plaquer, du jour au lendemain, et il revient à Hydra. Ce qu’il y fait exactement ? Aucune idée.
Harry était un peu plus jeune que moi, quarante piges, pas beaucoup plus, mais on lui en donnait facilement cinquante. Un grand roux dégarni au front immense, d’une lenteur extrême dans tous ses mouvements. Plutôt dysfonctionnel, socialement parlant. Mais un chouette gars. L’argent ne lui était pas monté à la tête. Il était avenant, lisait beaucoup, écrivait même, de temps en temps. Des trucs abscons, quasi incompréhensibles. Mais pas dégueulasses. Il y a quelques années de ça, on était très souvent fourrés ensemble. Ces derniers temps, il se faisait plus rare à Athènes, et moi encore davantage à Hydra. Aller à Hydra, pour y faire quoi ?
« Pour se payer une chemise Brooks Brothers, pardi, a proposé Harry. Quelle question !
– Oui, j’ai vu ça en bas. Ça a ouvert quand, cette saloperie ?
– Il y a trois mois. Et attention, s’il te plaît : juste en face du débarcadère des voiliers ! T’arrives avec ton mal de mer, tu t’offres une chemise, un plat de spaghetti al limone dans un resto du port, et t’es requinqué. « Brooks Brothers », rien qu’à la sonorité… tu sais que t’es arrivé à bon port. C’est l’ancre. L’assurance. T’es chez toi ! Bienvenue à la maison, mon Krokos ! » s’est-il exclamé en levant un verre à ma santé.
Je l’avais retrouvé sur la terrasse après ma douche. Il portait un bermuda kaki deux tailles trop grand, et rien au-dessus de la ceinture : un ventre à binouze, un grand coup de soleil dans le dos et un vieux tatouage d’ours en dessous de l’épaule. Sur la table, le service était digne d’un vrai bar : alcool et glaçons à volonté, cendriers, briquets. Magazines en vrac, livres, stylos. Vue panoramique sur tout le village. Le port, le golfe Argosaronique, en arrière-plan les montagnes du Péloponnèse et leur quarantaine d’éoliennes à l’arrêt. Je n’aurais pas été étonné d’apprendre qu’il faisait plus chaud qu’à Athènes. Je me suis servi du vin.
Hugues Charybde, le 17/03/2025
Makis Malafékas - Dans les règles de l’art - éditions Asphalte
l’acheter chez Charybde, ici