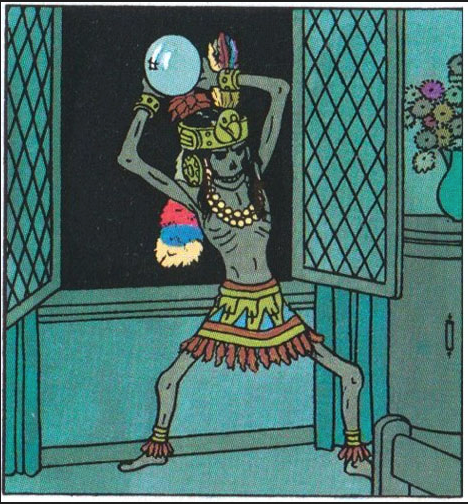Eviter la mélancolie aux confins avec Mathias Enard
Transformer l’art du cheminement fortuit et de la conversation érudite en célébration de l’accueil et de l’amitié – et en précieuse munition pour temps difficiles.
Beelitz-Heilstätten est un ensemble d’une cinquantaine de bâtiments perdus dans plusieurs centaines d’hectares de bois et dont seule une poignée (y compris la clinique, moderne, où se trouvait E.) fonctionne encore aujourd’hui. On s’y promène au milieu des ruines, des toits de tuiles rouges effondrés, des corniches brisées par le poids de la neige et de l’abandon ; de vieilles carcasses de Trabant sans moteur ni pneus y pourrissent gaiement derrière des hangars aux tôles défoncées, agrémentant le paysage d’une note de couleur bleue ou verte et rappelant, si d’aventure on l’oubliait, qu’on se trouve en ex-Allemagne de l’Est. La végétation a souvent pris le dessus sur les constructions et au milieu de l’immense parc on tombe sur des édicules grignotés par les rejets de sureau et les ronces, dissimulés derrière des haies sauvages – toute la science médicale et architecturale allemande du début du XXe siècle nous y apparaissait comme dans un tableau de Schinkel, un paysage imaginaire tristement réel, d’une beauté romantique qui, étant donné la fonction originelle du complexe, accueillir les tubards, avait doublement l’aspect de la Mort. Les nobles édifices de briques, aux encorbellements saillants, aux fiers chiens-assis, évoquaient tour à tour, selon leur taille, des villas de bord de mer ou de grands hôtels de montagne abandonnés et, associés dans l’esprit du promeneur au bacille de Koch et à sa maladie, la tuberculose, ils convoquaient La Montagne magique, la mort de Chopin ou celle de Kafka. Étrange à quel point cet ensemble éparpillé dans la végétation concentrait l’histoire tragique du Brandebourg – on y avait soigné les blessés pendant la Première Guerre mondiale ; Hitler lui-même s’y était remis de ses blessures. Après la Seconde, les Soviétiques y avaient installé leur plus grand hôpital militaire à l’ouest de la mère patrie, actif jusqu’au début des années 1990, et dont on retrouvait facilement l’emplacement : au milieu d’une grande cour, face à un de ces larges lazarets symétriques trônait la statue d’un infirmier de l’Armée rouge, modèle 1945, son brancard roulé à la main comme une lance ou une oriflamme, sa mitraillette Shpagin et sa musette en bandoulière. Couvert de graffitis bigarrés, ses bottes repeintes en rose électrique par un artiste inconnu, il posait hiératiquement, insensible à ces crachats colorés sur son vieil uniforme de pierre. L’ancien bol’nitsa qu’il gardait pieusement était à l’abandon depuis près de vingt-cinq ans. Une soixantaine de mètres de large, deux ailes saillantes, d’élégants bow-windows au rez-de-chaussée de la façade arrière, des attiques à colombages soutenant de hauts combles pentus surmontés de clochetons comme autant de petits phares, c’était un géant abandonné aux forces de la décrépitude. Les portes et fenêtres du rez-de-jardin étaient obstruées par des planches de contreplaqué qui n’empêchaient pas les curieux (photographes débutants, explorateurs urbains, jeunes à la recherche d’aventures) d’entrer pour visiter ce musée du Délabrement. Car il n’y avait rien d’autre à voir, dans l’ancienne clinique, que les effets du passage du temps. L’escalier monumental et les élégantes colonnades de l’entrée étaient toujours là, mais perdaient enduits et peintures en une mue écailleuse, dont les squames vertes ou blanches jonchaient les marches. Des rosaces de verre intactes surmontant des baies sans fenêtres paraissaient resplendir dans la débâcle générale. A l’étage, perdue au centre d’un noble palier à colonnades se trouvait une baignoire en fonte écaillée, à demi remplie de débris de plâtre, comme si les déménageurs russes fatigués avaient décidé, en dernière instance et après de longues hésitations, d’abandonner ce pesant machin à son sort pour ne pas avoir à descendre l’escalier avec. La lumière était magnifique. La générosité des ouvertures striait de rayons les amoncellements de merde. Les longs couloirs s’ouvraient sur des chambres vides inondées de soleil et d’ordures, vieux journaux à moitié brûlés, bouteilles de bière brisées, parfois des matelas défoncés et souillés ou des chaises sans assises évoquant les squelettiques penseurs robots d’un autre monde. Une vie clandestine s’était épanouie ici, aussi invisible pour nous que les médecins et infirmiers russes ; ces traces de passages s’effaçaient encore plus vite que les inscriptions en cyrillique çà et là sur les murs – la pièce la mieux conservée de l’ensemble était sans doute le grand gymnase qui occupait, en double hauteur, l’aile gauche du bâtiment : le plancher était encore là, la peinture verte (ce vert dense que, j’ignore pour quelle raison, j’ai toujours associé aux gymnases) aussi, tout comme les affiches et slogans vantant le sport militaire soviétique ainsi que le dessin d’un gymnaste sautant comme un chevreuil la haie d’un cheval.
Une amie chère hospitalisée dans une clinique de la grande banlieue berlinoise, sur les lieux mêmes où se trouvaient il n’y a pas si longtemps un fameux sanatorium et le grand plus hôpital soviétique situé hors des frontières de l’Union : cette occasion triste en soi constitue le point de départ, ou devrait-on dire le point d’insertion, de l’une de ces formidables plongées dans nos cultures et dans nos âmes, plongées dont Mathias Énard détient certainement certains des secrets majeurs, exprimés jusqu’ici avec une discrète flamboyance dans « Boussole », avec un machiavélisme certain – et finement englobant – dans « Zone », ou même avec une ferveur joyeusement rabelaisienne et passionnément agricole dans « Le banquet annuel de la Confrérie des Fossoyeurs », pour ne citer pour l’instant que ces trois joyaux antérieurs de la matière énardienne.
Publié en octobre 2024 chez Actes Sud, « Mélancolie des confins – Nord » se propose en premier volume d’une quadrilogie à venir, où les confins dont il est question épouseront les quatre points cardinaux. Pour transformer cette promenade et cette tristesse en tout autre chose – qui a discrètement trait à une exploration forcenée du melting pot par excellence que sont notre culture comme notre mémoire, toutes deux tamisées ici entre Kreuzberg, Tempelhof et Beelitz-Heilstätten -, Mathias Énard convoque, à chaque fois à point nommé – en usant du fil et de l’aiguille qui font muter le hasard apparent en nécessité intime -, des vivants et des morts, des fantômes ayant juste ce qu’il faut de diaphane et des amis en chair et en os, pour notre plus grand plaisir de découvrir tout ce qui entourait au fond certaine conférence-croisière mathématique sur la Spree et sur la Havel dans son « Déserter » de 2023, justement.
Beelitz-Heilstätten est un ensemble d’une cinquantaine de bâtiments perdus dans plusieurs centaines d’hectares de bois et dont seule une poignée (y compris la clinique, moderne, où se trouvait E.) fonctionne encore aujourd’hui. On s’y promène au milieu des ruines, des toits de tuiles rouges effondrés, des corniches brisées par le poids de la neige et de l’abandon ; de vieilles carcasses de Trabant sans moteur ni pneus y pourrissent gaiement derrière des hangars aux tôles défoncées, agrémentant le paysage d’une note de couleur bleue ou verte et rappelant, si d’aventure on l’oubliait, qu’on se trouve en ex-Allemagne de l’Est. La végétation a souvent pris le dessus sur les constructions et au milieu de l’immense parc on tombe sur des édicules grignotés par les rejets de sureau et les ronces, dissimulés derrière des haies sauvages – toute la science médicale et architecturale allemande du début du XXe siècle nous y apparaissait comme dans un tableau de Schinkel, un paysage imaginaire tristement réel, d’une beauté romantique qui, étant donné la fonction originelle du complexe, accueillir les tubards, avait doublement l’aspect de la Mort. Les nobles édifices de briques, aux encorbellements saillants, aux fiers chiens-assis, évoquaient tour à tour, selon leur taille, des villas de bord de mer ou de grands hôtels de montagne abandonnés et, associés dans l’esprit du promeneur au bacille de Koch et à sa maladie, la tuberculose, ils convoquaient La Montagne magique, la mort de Chopin ou celle de Kafka. Étrange à quel point cet ensemble éparpillé dans la végétation concentrait l’histoire tragique du Brandebourg – on y avait soigné les blessés pendant la Première Guerre mondiale ; Hitler lui-même s’y était remis de ses blessures. Après la Seconde, les Soviétiques y avaient installé leur plus grand hôpital militaire à l’ouest de la mère patrie, actif jusqu’au début des années 1990, et dont on retrouvait facilement l’emplacement : au milieu d’une grande cour, face à un de ces larges lazarets symétriques trônait la statue d’un infirmier de l’Armée rouge, modèle 1945, son brancard roulé à la main comme une lance ou une oriflamme, sa mitraillette Shpagin et sa musette en bandoulière. Couvert de graffitis bigarrés, ses bottes repeintes en rose électrique par un artiste inconnu, il posait hiératiquement, insensible à ces crachats colorés sur son vieil uniforme de pierre. L’ancien bol’nitsa qu’il gardait pieusement était à l’abandon depuis près de vingt-cinq ans. Une soixantaine de mètres de large, deux ailes saillantes, d’élégants bow-windows au rez-de-chaussée de la façade arrière, des attiques à colombages soutenant de hauts combles pentus surmontés de clochetons comme autant de petits phares, c’était un géant abandonné aux forces de la décrépitude. Les portes et fenêtres du rez-de-jardin étaient obstruées par des planches de contreplaqué qui n’empêchaient pas les curieux (photographes débutants, explorateurs urbains, jeunes à la recherche d’aventures) d’entrer pour visiter ce musée du Délabrement. Car il n’y avait rien d’autre à voir, dans l’ancienne clinique, que les effets du passage du temps. L’escalier monumental et les élégantes colonnades de l’entrée étaient toujours là, mais perdaient enduits et peintures en une mue écailleuse, dont les squames vertes ou blanches jonchaient les marches. Des rosaces de verre intactes surmontant des baies sans fenêtres paraissaient resplendir dans la débâcle générale. A l’étage, perdue au centre d’un noble palier à colonnades se trouvait une baignoire en fonte écaillée, à demi remplie de débris de plâtre, comme si les déménageurs russes fatigués avaient décidé, en dernière instance et après de longues hésitations, d’abandonner ce pesant machin à son sort pour ne pas avoir à descendre l’escalier avec. La lumière était magnifique. La générosité des ouvertures striait de rayons les amoncellements de merde. Les longs couloirs s’ouvraient sur des chambres vides inondées de soleil et d’ordures, vieux journaux à moitié brûlés, bouteilles de bière brisées, parfois des matelas défoncés et souillés ou des chaises sans assises évoquant les squelettiques penseurs robots d’un autre monde. Une vie clandestine s’était épanouie ici, aussi invisible pour nous que les médecins et infirmiers russes ; ces traces de passages s’effaçaient encore plus vite que les inscriptions en cyrillique çà et là sur les murs – la pièce la mieux conservée de l’ensemble était sans doute le grand gymnase qui occupait, en double hauteur, l’aile gauche du bâtiment : le plancher était encore là, la peinture verte (ce vert dense que, j’ignore pour quelle raison, j’ai toujours associé aux gymnases) aussi, tout comme les affiches et slogans vantant le sport militaire soviétique ainsi que le dessin d’un gymnaste sautant comme un chevreuil la haie d’un cheval.
Une amie chère hospitalisée dans une clinique de la grande banlieue berlinoise, sur les lieux mêmes où se trouvaient il n’y a pas si longtemps un fameux sanatorium et le grand plus hôpital soviétique situé hors des frontières de l’Union : cette occasion triste en soi constitue le point de départ, ou devrait-on dire le point d’insertion, de l’une de ces formidables plongées dans nos cultures et dans nos âmes, plongées dont Mathias Énard détient certainement certains des secrets majeurs, exprimés jusqu’ici avec une discrète flamboyance dans « Boussole », avec un machiavélisme certain – et finement englobant – dans « Zone », ou même avec une ferveur joyeusement rabelaisienne et passionnément agricole dans « Le banquet annuel de la Confrérie des Fossoyeurs », pour ne citer pour l’instant que ces trois joyaux antérieurs de la matière énardienne.
Publié en octobre 2024 chez Actes Sud, « Mélancolie des confins – Nord » se propose en premier volume d’une quadrilogie à venir, où les confins dont il est question épouseront les quatre points cardinaux. Pour transformer cette promenade et cette tristesse en tout autre chose – qui a discrètement trait à une exploration forcenée du melting pot par excellence que sont notre culture comme notre mémoire, toutes deux tamisées ici entre Kreuzberg, Tempelhof et Beelitz-Heilstätten -, Mathias Énard convoque, à chaque fois à point nommé – en usant du fil et de l’aiguille qui font muter le hasard apparent en nécessité intime -, des vivants et des morts, des fantômes ayant juste ce qu’il faut de diaphane et des amis en chair et en os, pour notre plus grand plaisir de découvrir tout ce qui entourait au fond certaine conférence-croisière mathématique sur la Spree et sur la Havel dans son « Déserter » de 2023, justement.
Sous le signe des ruines (mais aussi des banlieues) chères à Bruce Bégout, il sera question ici de guerre – avec Theodor Plievier et Heinrich Gerlach, comme avec Mario Rigoni Stern, très directement, mais Ernst Jünger et ses arpentages si spécifiques ne sont parfois pas si loin -, de destruction pure et pas si simple – avec W.G. Sebald, mais les « Dead Cities » de Mike Davis rôdent par intermittences -, de magnétisme et d’hypnose – avec Käthe Kollwitz comme avec Franz-Anton Mesmer, avec Maria Theresa von Paradis comme avec Robert Desnos et ses « Sommeils », mais peut-être les Wu Ming de « L’armata dei somnambuli » pointent-ils derrière l’horizon révolutionnaire implicite ? -, d’urbex et d’Östnostalgie (ni le Nicolas Offenstadt de « Le pays disparu » ni le Karsten Dümmel de « Le Dossier Robert » ne sont totalement absents du paysage lorsqu’il s’agit d’arpenter un pays disparu), et de nombre de figures fondatrices et consolidatrices, arrachées au classique, au romantique et au plus proche de nous encore, avec Heinrich Heine, Hector Berlioz ou Goethe, et surtout Georg Büchner ou Theodor Fontane, « le grand promeneur du Brandebourg ».
Les « jumeaux Hypnos et Thanatos » donnent tout au long de cette déambulation la direction souterraine d’une conversation en tous points (et au-delà) digne de celles de Gabriel Josipovici ou de Juan José Saer : si le Rascar Capac des « Sept Boules de Cristal » peut s’imposer ainsi à l’esprit, entre Albert Béguin et le Zénon de Marguerite Yourcenar, c’est bien que guettent partout les somnambules européens, ceux d’Hermann Broch comme ceux de Christopher Clark. Dans le fracas de la guerre qui fait rage désormais, un peu partout, même avec la si curieuse et si judicieuse intermédiation d’un Bernard de Clairvaux, et comme, par un rare jeu de correspondances de lieux berlinois, cela est aussi le cas dans « La Famille Müller » de Laurent Maindon, c’est l’importance cruciale, tout sauf vaine, de l’amitié qui prévaut face au chaos. Illustrée par les compères Claro (p 191 : « Il est tout de même étrange, notait Claro en avançant sur le chemin de la fontaine de Saint-Malachie, que l’auteur des Deux Étendards soit de nouveau lu, au point que le pamphlet Les Décombres et sa suite – intitulée L’Inédit de Clairvaux – aient été non seulement réédités, mais aussi aient presque immédiatement épuisé leur premier tirage. Clairvaux est un étrange endroit pour la littérature. ») et Mathieu Larnaudie (p 227 : « Il avait passé tout simplement soixante-douze heures au Berghain, un night-club mythique situé dans une ancienne centrale électrique de Berlin-Est, en face de Kreuzberg, de l’autre côté de la Spree. Il n’avait pas fait attention à l’heure, me dit-il. Trois jours, ça passe comme un rien, me dit-il. Il y a toutes sortes de gens à l’intérieur, me dit-il. Toutes sortes d’endroits, me dit-il. On n’a pas le temps de s’ennuyer une seconde, me dit-il. Sinon je serais parti, tu penses bien, me dit-il. »), et plus encore par la mystérieuse E., dont la maladie justifie l’ensemble du texte, l’accueil et l’amitié semblent bien ici les seuls véritables remèdes à l’inévitable – et peut-être nécessaire – mélancolie.
Je repensais à E., bien sûr, l’amie très chère ; E. avait longtemps travaillé dans l’édition, elle avait aussi été traductrice avant de rejoindre l’ambassade de France à Berlin en tant qu’attachée culturelle chargée du livre. Elle avait été la première personne, en France, à lire un de mes manuscrits. Peut-être les amitiés les plus profondes étaient les amitiés entre lecteurs, les écrivains étant, du moins pour ceux que je fréquente, avant tout des lecteurs, des passionnés de lecture.
Dans ce premier exercice de « Mélancolie des confins », Mathias Énard transfigure l’art du cheminement fortuit et de la conversation érudite en célébration de la rencontre de l’autre sous toutes ses formes, et en précieuse munition, pacifique combattante paradoxale, face à ce qui rôde aujourd’hui plus que jamais autour de nous, ici et ailleurs.
J’eus soudain la sensation, en grelottant dans la brume aux abords de la gare de Beelitz, que seules la promenade et la marche convenaient à la littérature, comme on rêve, l’automne venu, aux insectes dont le dernier vol erratique de fleur mourante en fleur morte et le bourdonnement terminal rappellent pour nous, sautant par-dessus l’hiver, le printemps qui viendra. L’errance était la seule façon d’explorer les bordures, les marches de la littérature et des empires, les sillons où reposent les guerriers, littérature des limites et poésie des confins.
« Là où tout s’achève, déploie tes ailes » ; Donde todo termina, abre las alas. C’est peut-être parce que E. avait, de tant de façons, consacré sa vie aux livres, que j’eus la sensation, au moment où le train Regional Express rouge et blanc approchait du quai, que toute la littérature était elle aussi une affaire d’acharnement, de persévérance, de marges et de combats perdus, à l’image de cette marche de Brandebourg pour nous maintenant si triste dans la nuit rendue encore plus opaque par les phares de la locomotive.
Hugues Charybde, le 17/02/2025
Mathias Enard - Mélancolie des confins - Nord - Actes Sud
l’acheter chez Charybde, ici