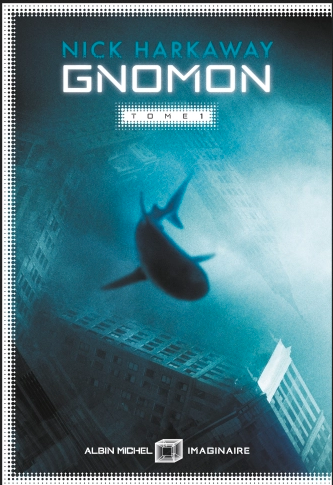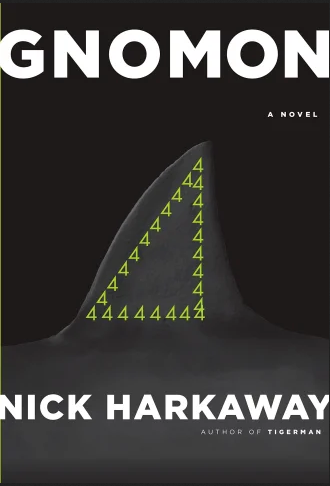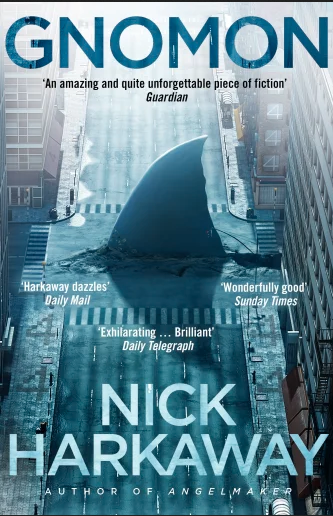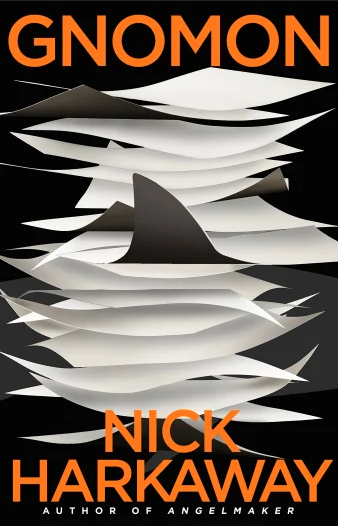Quand la réalité dépasse la science-fiction. "Gnomon", un grand roman flippant de Nick Harkaway
Ampleur et souffle d’un jeu de miroirs et de labyrinthes hors normes pour nous entraîner dans le coup d’après de la surveillance et de la transparence, et des failles démocratiques résistantes aux antibiotiques ordo-libéraux. Un très grand roman.
Lancée début octobre 2022 avec les éditions La Volte, la librairie Charybde et le journaliste Antoine Daer (St. Epondyle), « Planète B » est l’émission mensuelle de science-fiction et de politique de Blast. Chaque fois que nécessaire, les lectures ou relectures proposées pour un épisode donné figureront désormais dans cette rubrique partiellement dédiée.
« Gnomon » (2017) est l’un des livres-clé de l’épisode n°5, « Surveillance et contrôle : quand la réalité dépasse la science-fiction », à regarder ici.
« La mort d’un suspect en garde à vue, déclare l’inspectrice Neith, du Témoin, est un événement extrêmement grave. Nous qui participons au programme Témoin, nous éprouvons tous ce matin le sentiment d’un échec personnel. »
Elle regarde la caméra en face ; sa sincérité est palpable. Une bonne dizaine de logiciels spécialisés mesurent ses émotions en examinant les muscles périphériques de ses yeux et de sa bouche. Ses micro-expressions confirment ses dires. Comme d’habitude, les algorithmes les plus sophistiqués cherchent à détecter le Botox ou les stimulateurs bioélectriques qui permettent de feindre cette honnêteté douloureuse, mais nul ne s’attend vraiment à en trouver et nul n’en trouve.
Les données des sondages défilent sur l’écran : 89 % des spectateurs estiment que le Témoin n’a commis aucune erreur. Quant au reste de la population, une écrasante majorité pense que si culpabilité il y a, on découvrira qu’il faut en accuser la négligence plus qu’un dessein quelconque. Les chiffres de Mielikki Neith en personne sont encore meilleurs : à vrai dire, l’enquête lui a été confiée parce que, à les en croire, sa probité n’a jamais été égalée. Chacun tient sa bonne foi pour acquise, à part les groupes de discussion à la paranoïa la plus corrosive.
Ce sont de très bons scores, même si le Témoin remporte de toute manière en permanence une adhésion massive. On continue cependant à discuter le cas Diana Hunter dans la Sphère Publique – ce qui est une excellente chose -, jusqu’au jour où le meurtre suivant l’éclipsera.
Londres, dans quelques années : à la place de la vieille monarchie et de sa démocratie parlementaire associée, c’est désormais le règne du Système et du Témoin, réclamé par un raz-de-marée populaire il y a de cela quelques années. Le Système : démocratie directe par sollicitation civique (optionnelle dans une certaine mesure) constante ou presque des citoyennes et des citoyens, qui se doivent de débattre par groupes semi-affinitaires et de voter, chaque fois que nécessaire – donc souvent. Le Témoin : l’interconnexion généralisée et algorithmisée des dizaines de milliers de caméras de surveillance couvrant le territoire du Royaume-Uni et des centaines de millions de données numériques individuelles collectées en toute occasion. La transparence est totale, et garantit la sécurité de toutes et de tous, puisque les gens normaux n’ont rien à se reprocher – et que les délinquants et criminels ont fort peu de chances d’échapper à cette justice ubiquitaire. Le Témoin n’est pas entièrement automatisé : un corps d’inspecteurs assermentés, de haute volée technique et intellectuelle, assure par ses interventions méticuleuses au moindre doute que la contre-analyse et la décision humaines restent bien dans la boucle judiciaire et policière.
Pourtant, à l’occasion, quelques petits cailloux peuvent venir gripper les engrenages bien huilés de cette machine socio-politique. C’est le cas lorsque Diana Hunter, une autrice et professeure de lettres relativement peu connue, mais totalement culte dans les cercles littéraires, assurément rebelle vis-à-vis du Système et du Témoin – mais peut-être bien innocente de tout crime ou délit, qui plus est -, décède lors de sa garde à vue. Cela est évidemment inacceptable, et l’enquêtrice Mielikki Neith, très bien notée, est mandatée pour faire toute la lumière sur cet accident fort malencontreux. Mais lorsqu’elle lance son examen de la psyché désormais numériquement enregistrée de la victime (procédure « normale » ayant été effectuée lors de la garde à vue : la transparence totale et la police de la pensée sont prises très au sérieux, on le voit, par le Système et par le Témoin), elle a la surprise de découvrir non pas une mémoire, mais trois, parfaitement enchâssées à l’intérieur de celle de Diana Hunter : celles de trois personnes parfaitement distinctes nommées Constantin Kyriakos (un trader grec contemporain), Athenais Karthagonensis (une magicienne carthaginoise de l’Antiquité tardive) et Berihun Bekele (un artiste peintre éthiopien contemporain)
Nul besoin d’une analyse sophistiquée des premières pensées de l’enregistrement pour reconnaître en Diana Hunter une opposante au Témoin et, de fait, à la société dont il constitue la fondation. L’argument philosophique avancé par le Système en sa propre faveur – sécurité et autonomie, au prix d’une transparence personnelle totale – ne l’avait pas convaincue. De toute évidence, le droit de ne pas être surveillée présentait à ses yeux une vertu irréductible. Il existe évidemment des gens comme elles qui choisissent pourtant de rester en Grande-Bretagne, sous la gouvernance du Système, parce que, d’après eux, certaines exigences les y attachent. La plupart ne posent pas de problème. Ils manifestent, ils votent, ils créent de petits réseaux locaux qui, inévitablement, laissent fuiter de l’information de partout et ne gardent aucun secret inquiétant. Le problème des vrais refuzniks – lesquels utilisent des techniques analogiques et des méthodes discrètes pour transmettre l’information entre paramilitaires motivés – n’a rien à voir. Il est pour tout dire inexistant.
Constantin Kyriakos était un trader grec « ordinaire », jusqu’à ce qu’un grand requin blanc, frôlé contre toutes attentes rationnelles lors d’une baignade en mer Égée, ne se mette à le hanter, voire le pourchasser, tout en lui glissant dans certains interstices numériques improbables d’incroyables « tuyaux » boursiers qui le font entrer rapidement dans la confrérie (sans aucune fraternité) restreinte des véritables faiseurs financiers de pluie et de beau temps du monde.
Quatre jours plus tard, rebelote : la traînée de 4 révélatrice. Le moniteur de Harrison a disparu à jamais, Dieu merci, après avoir émis en mourant un gaz apparemment toxique qui interdit à son ex-propriétaire de s’en offrir un autre. Restent, hélas, les émulateurs, ces programmes malins qui, appliqués à un matériel coûteux, l’obligent à se comporter en vieillerie à deux euros. Il est possible de se procurer un stock ticker pour iPad qui fait ça et, allez savoir pourquoi, j’ai été contaminé, je me suis mis à utiliser l’engin. Mes autres appareils tournent toujours, mais ma tablette, posée sur son petit support, ne montre plus que des chiffres d’un vert froid à la dérive – on se croirait dans ce film, là, avec Keanu Reeves.
Les 4 traversent la liste des cours dans un sens, puis dans l’autre, jusqu’à un prix sur lequel ils s’attardent, comme s’ils réfléchissaient. Puis ils disparaissent. Une entreprise tout ce qu’il y a de bien, en bonne santé, apparemment.
Je passe un coup de fil à un laquais.
« Vends Couper-Seidel.
– Hein ?
– Vends, je te dis. Je n’y crois plus. Allez. Tout de suite. »
Il obtempère.
« Nom de Dieu, Constantin, ça a coûté bonbon. »
Je réfléchis à la question. Couper-Seidel a trois concurrents.
« Achète un max de Juarez Industrial Copper et d’Ardhew Metallic. » Le troisième ne me plaît pas ; trop fluctuant. « Qui détient la dette de Couper ? »
Tout le monde est endetté. Tout le monde est soumis d’une manière ou d’une autre à un effet de levier. Il me répond. Je vends les détenteurs à découvert.
Quatre minutes plus tard, ça y est. Brunner et De Vries regardent par-dessus mon épaule. Le seul fait de nous débarrasser de Couper-Seidel nous a évité de perdre dix millions d’euros. Les ventes à découvert nous en ont fait gagner quarante millions de plus. Si on liquide maintenant, les gains sur Juarez et Ardhew porteront le total à quelque chose comme cent millions.
Par la grâce de la connerie suprême d’une industrie fondée sur la connerie, le genre de choses que je viens de faire lance une carrière. Ce matin, j’étais un très bon trader. Là, je touche aux frontières de la divinité financière. Je suis entré dans la zone réservée aux prophètes et aux experts qui savent où va le monde de l’argent avant qu’il n’y arrive, à Michael Burry, George Soros et d’autres, peu désireux de se faire connaître du grand public. Joignez-vous au club, et vous vous joignez quasi automatiquement à celui des Mille Cinq Cents qui ont collectivement plus de pouvoir que n’importe quelle autre force sur terre. Il n’est pas question de conspiration ; ils concentrent juste une telle capacité d’accès et de telles ressources qu’ils ne peuvent que peser énormément. Nul besoin de prêter allégeance – ça, c’est implicite. Il suffit d’être riche, mais à un niveau équivalent, dans les faits, à une étape de l’évolution.
Athenais Karthagonensis est une lettrée, érudite, occultiste, herboriste et magicienne, vivant à Carthage à la charnière des IVème et Vème siècles après J.C. (dont la mention n’est pas innocente, puisque le père de son fils Adéodat – tragiquement disparu -, rencontré lors de leurs études universitaires communes et dont elle aura été la concubine très officielle treize ans durant, n’est nul autre qu’un certain Augustin d’Hippone – à 300 kilomètres de Carthage par la route -, plus connu sous son nom catholique consacré : saint Augustin). En tant qu’experte en arts occultes et en impossibilités rationnelles, elle est chargée discrètement d’enquêter sur un étrange meurtre en chambre close aux fort troublantes implications.
Eh bien, je n’ai pas peur. Lorsque le sac me libère la tête, je suis très occupée à infliger à je-ne-sais-qui la plus belle engueulade de sa courte vie de jeune Romain. Je ne suis pas une petite traînée qu’on emporte, gloussante et protestant sans conviction – d’ailleurs, aucune femme, quelle qu’elle soit, ne devrait rire de telles balivernes ! Moi, j’ai quarante-deux ans et je suis une putain de lettrée, nom de Dieu !
Oh, bien sûr, j’aurais sans doute trouvé ça drôle à l’époque de mes études. Et ce putain d’Aurelius Augustinus aurait aussi été partant, à l’époque de ses frasques. S’il y avait pensé, il m’aurait jetée sur son épaule et portée jusqu’à quelque repaire adéquatement meublé pour la fornication pastorale, où tout le monde aurait eu droit à de la bonne huile d’olive et de la piquette, dont une grande partie aurait terminé à des endroits qu’aucune olive levantine digne de ce nom n’aurait reconnus. À vrai dire, puisqu’on en parle, je suis à peu près sûre qu’il y a pensé – si ce n’est lui, alors un des prédécesseurs dont l’existence lui inspirait une telle fureur.
Seulement voilà : mon fils mort, j’incline à une manière moins exubérante d’être au monde. Une femme privée de son mari est une veuve, une fille de ses parents une orpheline, mais il n’existe pas de mot pour dire ce que je suis parce que je ne devrais pas être ou, peut-être, parce que ce genre de choses arrive si souvent que ça ne vaut pas la peine d’en parler. C’était mon fils : je n’ai pas besoin de mot pour définir ce que je suis à présent. Cela ne me quitte jamais.
Je vis donc mon après-vie. Je suis sérieuse ; je lis beaucoup et je bois peu. J’enseigne, je mène des recherches, je prends des avis. Mes élèves me paient bien – ceux qui ont sondé le mystère de Carthage et peu à peu compris qu’ils vont avoir besoin de connaissances véritables, outre celles dispensées ici. Je me conduis avec la dignité de l’érudite et vais connaître un âge mûr confortable puis une longue vieillesse très respectée. J’appartiens à présent au corps enseignant ; il nous arrive toujours de trouver à l’occasion entre nous quelque consolation physique, mais, professeurs que nous sommes, c’est en général avec beaucoup de modération. Des dîners aux chandelles auxquels les autres convives ne se présentent pas, une proximité décontractée, voire, peut-être, une coupe de vin pour laisser tomber la toge : séduction mutuelle complice, d’une élégance et d’une discrétion toutes romaines. Ce genre de mise en scène ne sert pas à grand-chose.
Par tous les dieux et tous les saints, j’espère qu’aucun de mes collègues ne s’est senti pousser des ailes. Si jamais un vieux bouc costumé en Dionysos a décidé de me courtiser pendant qu’un quartet de charmantes petites choses du marché aux esclaves joue du crincrin les yeux bandés, je vais sans doute le poignarder, et ça va faire tout un foin. Oui, le poignarder, comme la petite provinciale que j’étais en arrivant ici. J’ai toujours ma novacula sur moi. Je m’en sers pour mes préparations aux plantes, mais je n’ai pas oublié qu’elle me permet au besoin de m’affirmer. Une lame est une lame ; la petite garde en croix de la mienne évite aux doigts de glisser, au cas où.
Berihun Bekele est un artiste peintre éthiopien, recruté à sa grande surprise et à son corps presque défendant par sa petite-fille, sérial-entrepreneuse bienveillante du numérique contemporain, pour contribuer à un révolutionnaire environnement de jeu, propulsant les ébauches d’univers virtuels dans une dimension ludique et politique où toutes les expérimentations sociales, individuelles et collectives, pourraient être conduites en réalité augmentée, à l’intérieur d’un univers clos mais en expansion, pour tester in vitro leur pertinence et leurs implications – en toute transparence, sous les yeux du public intéressé, voire partie prenante. C’est également grâce à lui que nous en apprendrons ainsi davantage, le moment venu, sur la curieuse généalogie du Système et du Témoin.
L’image ci-contre, inspirée par la lecture de « Gnomon », est due au talent de Griffin Mauser (dessin proposé sur le blog Bookpeople).
Lorsque je me suis retourné vers l’immeuble, Annabel Sophia Bekele attendait sur le perron, professionnellement accueillante, la main tendue.
« Bienvenue chez les Juges du Feu ! »
Je l’ai serrée.
Ce nom-là, je n’arrive pas à m’en souvenir. Une référence historique, semble-t-il. Après le grand incendie de 1666, vingt-deux juges ont été chargés de délimiter les propriétés disparues de Londres. Il le fallait, vu l’étendue de la destruction : les points de repère qui avaient servi à tracer les contours grossiers des parcelles faisaient partie du champ de ruines. Les juges ont donc pour moitié dessiné des traits en l’air et, ce faisant, il n’est pas impossible qu’ils aient parfois saisi l’occasion d’améliorer un tantinet les flux de la cité, de déraciner impasses et coupe-gorges, de les replier totalement sur eux-mêmes.
« Des géographes fantômes bienfaisants », m’a dit Annabel, juste après m’avoir précisé que c’était Annie, parce que personne ne l’appelait plus Annabel à part son ancienne proviseure et moi.
Le nom convenait bien à son entreprise, qui créait des mondes à partir de rien – ou, plus exactement, de chiffres. La société avait d’autres sources de revenus : elle testait la voiture magique sur le terrain pour son fabricant et ajustait son programme, en phase d’apprentissage ; elle réalisait aussi, grâce au temps machine inutilisé de sa prodigieuse infrastructure, divers calculs requis par des institutions qui manquaient de cycles propres. Toutefois, elle travaillait pour l’essentiel à des créations.
L’immeuble lui appartenait – encore un revenu potentiel -, mais cinquante pour cent de ses locataires échappaient à un loyer vertigineux au motif qu’elle tenait au « bénéfice de la sérendipité ». J’en ai déduit que les jeunes programmeurs à la dérive dans les couloirs et les espaces détente, très occupés à papoter en considérant de haut les créateurs de mode aux marques balbutiantes, les concepteurs de jeux, les microbrasseurs et les architectes, composaient avec eux une version miniature du ragoût culturo-commercial qui avait si bien réussi dans la Silicon Valley. Annabel – Annie – a reconnu que oui, c’était exactement ça. Cette année, les Juges du Feu avaient participé au succès d’une nouvelle chaise ergonomique et d’un système de suivi d’enfant en réseau maillé. J’ignorais ce que pouvait bien être la seconde de ces merveilles, mais d’après ma petite-fille, c’était à la fois simple et très malin – combinaison de qualités que je trouvais aussi agréable qu’elle l’appréciait visiblement. Elle a jeté un coup d’œil à Bobby qui, planté derrière moi, dévissait joyeusement une chose d’où partaient des tas de fils, sans interrompre sa conversation avec un très jeune homme en salopette. Elle l’appréciait évidemment pour les mêmes raisons. Simple mais malin : une bonne combinaison chez un amant. Les auteurs de fictions romantiques aiment la complication lardée d’angoisse, façon Byron ou Tolstoï, mais la simplicité est souvent bienvenue dans la vie réelle, ainsi que la gentillesse. Il fallait transmettre cette immense sagesse à Annie, me suis-je dit, avant d’admettre que si Bobby lui plaisait, elle la possédait déjà.
Nous avons erré dans de vastes couloirs où couraient des tuyaux en métal et traversé des espaces de travail aux murs de brique nue, éclairés par des lampes d’architecte à échelle industrielle. Il s’y trouvait notamment l’inventeur d’un nouvel instrument de musique et un type qui mettait au point une souris améliorée. J’ai failli lui demander s’il ne pensait pas plutôt à une souricière, mais j’ai compris à temps qu’il avait dit exactement ce qu’il voulait dire, même si je ne voyais pas en quoi un rongeur amélioré allait se révéler utile. Le locataire s’est expliqué. Le système digestif des vautours éliminant les maladies, leurs excrétions constituaient un pur fertilisant, car leur féroce chimie interne brûlait jusqu’aux microbes les plus révoltants. Le massacre mondial dont ils étaient victimes représentait de ce fait un danger sans précédent pour la santé publique générale. Leur extinction en de nombreuses régions du globe s’accompagnait de la renaissance de graves infections. Mon interlocuteur voulait introduire l’heureuse caractéristique du vautour dans les populations de rongeurs urbains : nous ferions un bond gigantesque vers l’éradication de maladies problématiques – avancée cruciale dans un monde qui perdait rapidement la partie face aux bactéries résistantes.
« Il est docteur en médecine, alors ? » ai-je demandé quand nous avons continué notre chemin, Annie et moi. « Il a un diplôme de scénographie, m’a-t-elle répondu en riant. Au départ, il s’est lancé dans la biotechnologie pour fabriquer un poisson rouge aux couleurs de son équipe de foot. Il met ses plans au point ici, sur nos ordinateurs, et il externalise les trucs expérimentaux. » Je l’ignorais totalement, mais tout cela était possible, semblait-il. Quant à savoir depuis quand… Je souffrais peut-être du « choc du futur ». Cette remarque a éveillé l’ironie d’Annie, qui m’a signalé que l’expression avait près de cinquante ans « quoique Rousseau se soit plaint de quelque chose de très semblable en 1778 ». Ce ton absent m’était familier : elle parlait souvent comme ça dans les réunions et conférences où les journalistes lui demandaient si le monde ne changeait pas trop vite.
Publié en 2017, traduit en français en 2021 chez Albin Michel Imaginaire par Michelle Charrier, « Gnomon » (en grec, un instrument astronomique remontant à l’Antiquité, voisin de cadran solaire, et ici un projet et une métaphore qui seront révélés en temps utile) est le quatrième roman de Nick Harkaway, pseudonyme littéraire de Nicholas Cornwell, par ailleurs fils de feu David Cornwell (plus connu sous son propre pseudonyme de John Le Carré).
Mêlant une réflexion politique de fond, qui fait beaucoup plus que, comme cela a parfois été écrit, « actualiser le « 1984 » de George Orwell, « Gnomon » plonge au cœur de l’échange philosophique sécurité / liberté, bien entendu, échange qui travaille nos sociétés au moins depuis Thomas Hobbes et son « Léviathan » de 1651, échange qui résonne avec encore plus d’acuité aujourd’hui, à « L’Âge du capitalisme de surveillance » analysé par Shoshana Zuboff et de l’application à toute une chacune et tout un chacun, par les États et / ou leurs relais privatisés, de tout l’arsenal technologique conçu pour l’espionnage à grande échelle des puissances étrangères et pour la lutte anti-terroriste, échange qui prend aussi un sel tout particulier lorsque le lectorat britannique relit certaines des professions de foi des Brexiters les plus acharnés de 2016.
Mais si l’analyse philosophique et politique est ici particulièrement remarquable, à aucun moment « Gnomon » ne se laisse aller sur la pente de l’essai déguisé, bien au contraire, puisqu’il place au cœur de son récit une véritable réflexion en action, machiavéliquement romanesque, autour de la place de l’imaginaire et du récit dans la construction politique, intime comme collective.
Les quartiers mal famés ne sont plus guère à Londres qu’un souvenir, mais la maison qu’elle cherche se trouve à la limite de l’un d’eux : une vallée hideuse, un lotissement aux bâtisses brutalistes aussi sales que des molaires pourrissantes, disposées autour de cours centrales qui n’ont jamais servi que de champs de bataille. Aux yeux de Mielikki, ces constructions posent plus de problèmes à cause du but dans lequel elles ont été conçues que par leur disposition : il s’agit de boîtes où stocker les Londoniens excédentaires. Le message d’inutilité qu’elles charrient n’est pas difficile à leur arracher, et leurs habitants l’ont déchiffré dès qu’ils ont vu où on les envoyait. À partir de là, le projet s’est échoué dans un marécage d’attentes médiocres et de fureur rentrée. Le siècle précédent a produit nombre de ces mijoteuses à colère, dont la chaleur a imbibé si profondément la terre et les gens que le Système lui-même est incapable de l’en extraire rapidement. Ses détracteurs – le sujet de la présente enquête, par exemple – y voient la preuve qu’il n’est pas tout ce qu’il est censé être, mais Mielikki peut interpréter l’histoire, elle aussi ; elle veut bien qu’on lui cite une société qui a fait mieux avec ce qu’elle avait hérité du passé. Le remède n’est évidemment pas d’en revenir aux itérations de la démocratie théoriquement représentative qui a provoqué ce gâchis, pour commencer.
C’est toutefois la façade arrière de la maison qui domine la vallée des dents. L’inspectrice descend du tram puis le regarde disparaître. Un instinct capricieux la pousse une seconde à se lancer à sa poursuite, à y remonter puis à y rester jusqu’au terminus. Un tram en mouvement matérialise une bulle spatiale nettement séparée de ce qui l’entoure. Le temps y passe à une vitesse légèrement différente ; ses occupants sont incapables d’interaction physique avec la population de l’extérieur. Ses rails représentent l’intrusion dans l’espace normal d’un autre plan physique – d’une banalité si confortable, pourtant, que peu de gens sont conscients de ce qu’ils voient. Son terminus est un carrefour au même titre qu’un aéroport, un endroit où une réalité temporaire se fond dans la réalité consensuelle permanente – où les rails s’interrompent -, un pont entre deux pouvoirs : une transition en transition. Un lieu aussi enserré recèle certainement des indices relatifs à presque tous les mystères, crachés dans la plaine littorale du mouvement humain.
Mielikki grogne en reconnaissant cet état de flux persistant – le dialogue entre fugue et logique qui appartient à son arsenal professionnel.
Elle regarde autour d’elle, repère les caméras des façades et des réverbères, cherche les angles morts – créés ou inattendus -, les endroits où elle s’installerait en tant que gamine pour jouer à cache-cache et la murette depuis laquelle les adolescentes suivent les concours de frime des jeunes mâles. Elle cherche les emballages de fast-food et les bouteilles plastique, les mégots, les aiguilles, les téléphones jetés, le moindre détail racontant une histoire. Ça ne risque pas d’être celle qui l’intéresse, mais toutes les histoires ont des points communs. Toutes les histoires sont une, au bout du compte.
Travaillant en guise de matériaux bruts des questions aussi brûlantes que celles de la transparence sociale (et l’on songera au passionnant « La transparence selon Irina » de Benjamin Fogel, par exemple) ou celles de la présence humaine dans la boucle algorithmique bienveillante (comme le pratique le Stéphane Beauverger de « Collisions par temps calme »), celles de la validité juridique du rêve (Christopher Nolan et son « Inception » ne sont pas très loin, mais sans la puissance pure développée ici) ou celles de la police prédictive (allant conceptuellement beaucoup plus loin que le traitement de choc infligé à Philip K. Dick par le Steven Spielberg de « Minority Report »), celles de la persistance d’une culture analogique aussi nostalgique que rusée (pensons alors à la Sabrina Calvo de « Toxoplasma » et de « Melmoth furieux », voire au Nicolas Rozier de « L’île batailleuse ») ou celles du rôle des environnements créatifs décentralisés et autre fablabs (conduisant cette mise en scène avec un brio digne du Cory Doctorow de « Dans la dèche au Royaume Enchanté » ou de « Makers »), celles de la solution hypothétique de cet oxymore apparent que serait la finance éthique (avec une acuité rappelant le Thomas Pynchon de « Fonds perdus » comme le Kim Stanley Robinson de « New York 2140 ») ou celles de la politique sous-jacente à certaines esthétiques du jeu vidéo (croisant ainsi le chemin de McKenzie Wark et de sa « Théorie du gamer »), glissant une petite foule de délicats clins d’œil à des autrices et auteurs aussi divers que Jorge Luis Borges (Regno Lönnrot, figure apparaissant rapidement comme la némésis de l’enquêtrice Mielikki Neith, ne partage-t-il pas son rare nom de famille avec le protagoniste de « La mort et la boussole » ?), Heinrich Steinfest (« Attaque de requin, lui répond-on. À soixante-sept kilomètres de la mer. Puis, presque d’un ton d’excuse : Anomalie. »), Walter Tevis et son « Jeu de la dame » (« Mielikki dispose toujours d’un mur du crime, mais il s’agit d’une projection sur le mur de son appartement »), Daniel F. Galouye et son « Simulacron 3 » (ou peut-être la version longue qu’en donnait Rainer Werner Fassbinder dans « Le monde sur le fil »), Bryan Singer et son « Usual Suspects » (à travers le joli démarquage de la pratique créative à chaud de Verbal Kint) ou Frederik Forsyth (dont les méthodes de création d’agents dormants décrites dans « Le Quatrième Protocole » feront une apparition à point nommé), Nick Harkaway a pris le pari du vertige littéraire de grande ampleur pour nous faire vivre ceux de la surveillance politique institutionnalisée et de la démocratie algorithmique idéalisée.
Par son ampleur et par son souffle, ce roman a tout pour devenir d’ores et déjà un classique de la littérature de science-fiction comme de la littérature en général. Proposant un jeu subtil de miroirs et de labyrinthes, organisant une convergence extrêmement rusée des trois récits mémoriels et d’une enquête « principale » (avec un sous-marin nucléaire lanceur d’engins en guise de suprême joker) que l’on aurait pourtant pu d’abord jurer parfaitement disjoints, alors que l’on assiste à leur inexorable enchâssement, son brio narratif et sa capacité à varier les registres de langue soulève l’admiration. En se penchant avec une folle inventivité, avec un respect fondamental et rusé de l’art du feuilleton (et même du « roman de gare ») et avec une somptueuse mise en abîme des arts occultes de la stéganographie et de la cryptographie, sur les moments de bascule et sur le cheminement insidieux qui habite les fondations philosophiques de l’ordo-libéralisme contemporain et des start-up nations qui lui sont associées de facto, « Gnomon » constitue une véritable révélation littéraire et politique.
Mes interrogateurs sont frustrés parce que, pour l’instant, ils n’obtiennent pas les informations qui les intéressent. Ils n’obtiennent pas ma vie, mon moi intérieur secret, gonflé de rage contre la machine. Ils obtiennent la vie de Constantin Kyriakos, d’Athenais Karthagonensis et de Berihun Bekele. Ça ne leur plaît pas, et les raisons du problème leur échappent, ce qui leur plaît encore moins. Ils maintiennent ouvertes les alimentations des narrations non originales – le nom qu’ils donnent à mes personnages -, chacune sur son écran dédié, pour se les passer et repasser. À quoi ça rime ? Si je pouvais regarder par mes propres yeux, là, maintenant, je les verrais qui me regardent, mes créations, soldats fantômes enfouis dans mon cerveau, livrant bataille pour empêcher la mise à mort de mon vrai moi.
Hugues Charybde
Nick Harkaway - Gnomon - Albin Michel / Imaginaire
Pour acheter le tome 1 chez Charybde, c’est ici.
Pour acheter le tome 2 chez Charybde, c’est là.